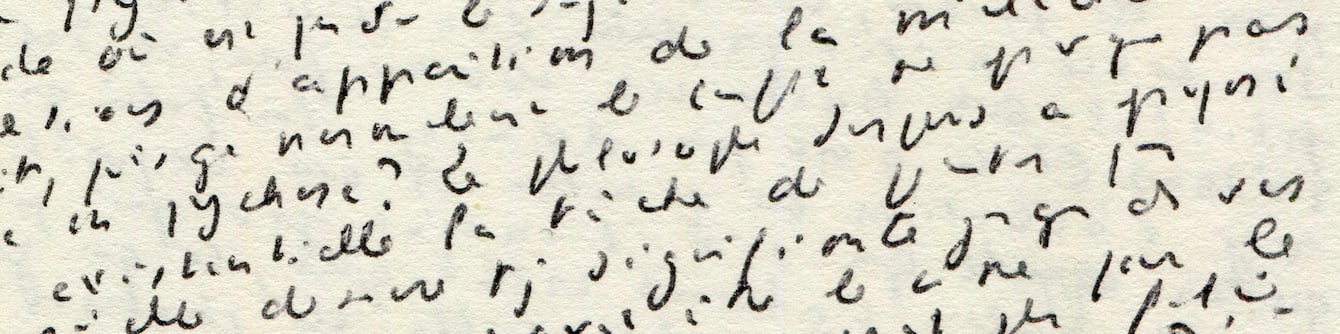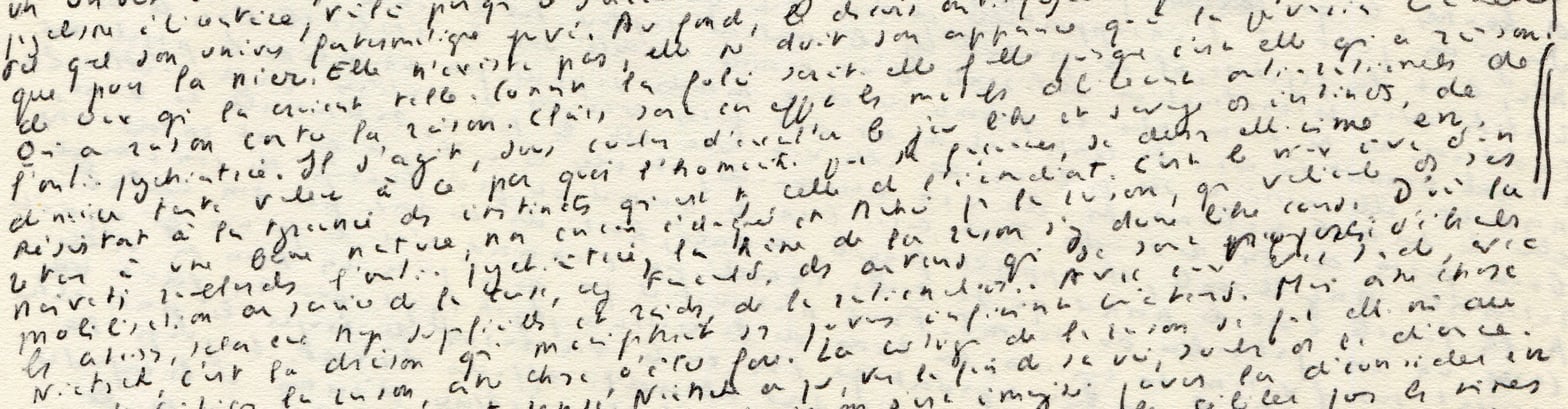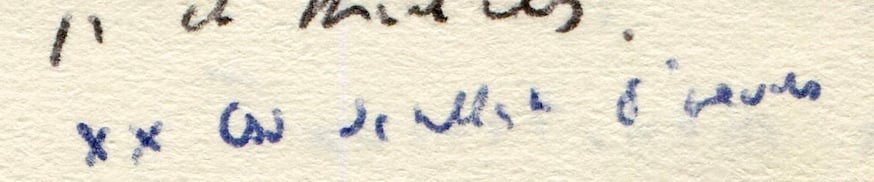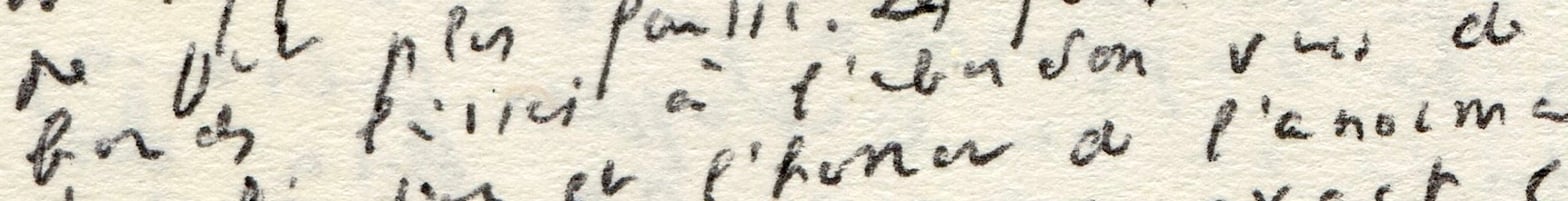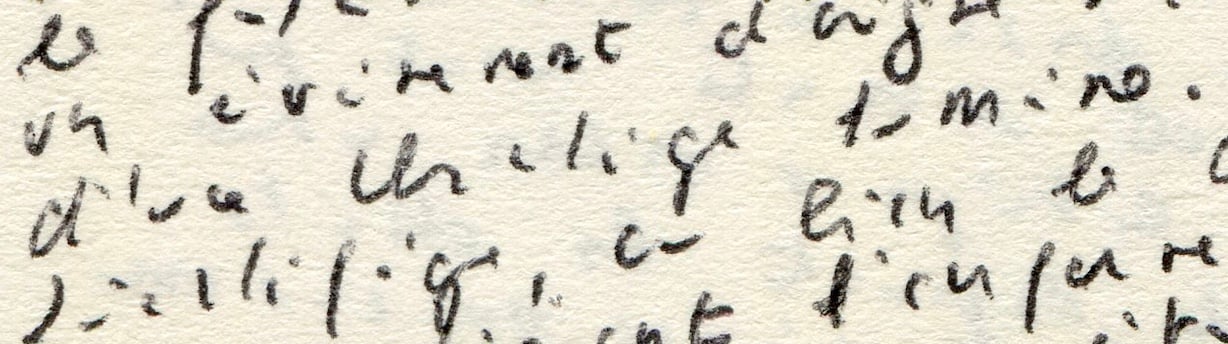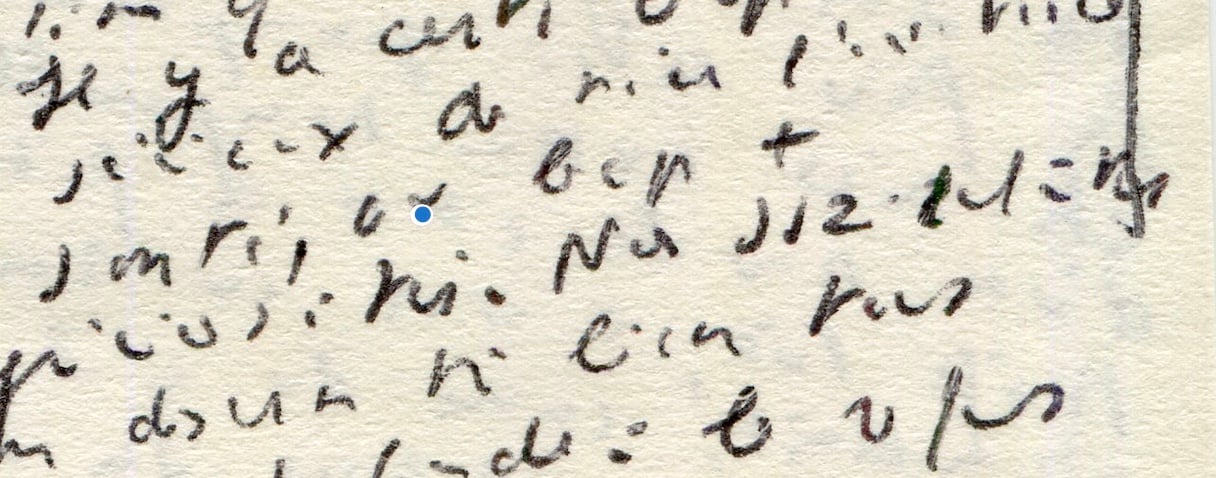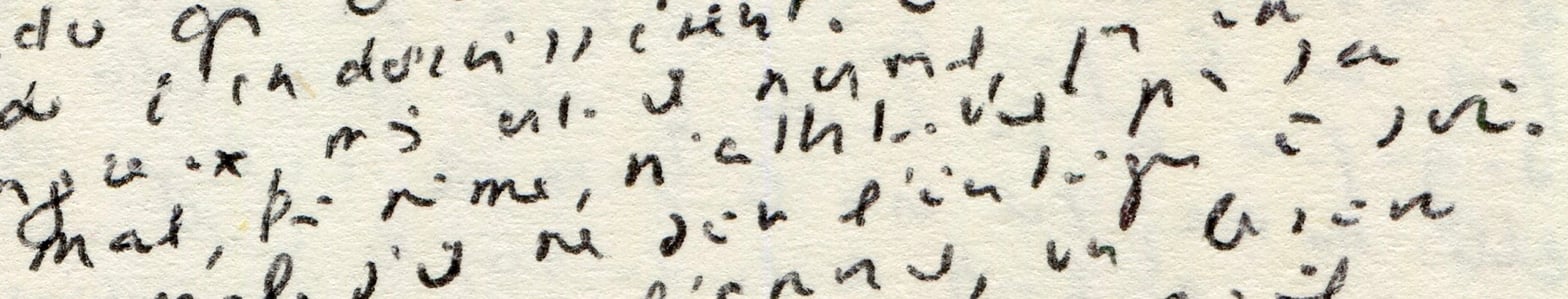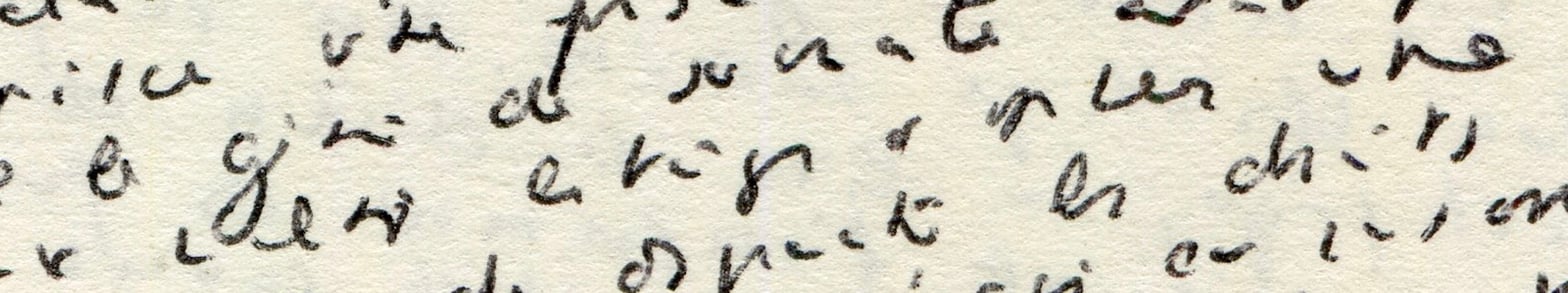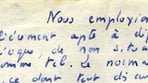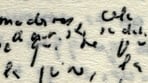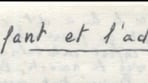Le normal (notes v2 p12-15)
Notes revues en atelier mars-10 avril 2025


Ces notes concernent le sujet “Le normal et le pathologique” mais ne sont pas encore attribuées à un texte repéré. On les déchiffre justement dans le but de pouvoir les resituer. Les passages pris en photo sont offerts à votre sagacité, et concernent les mots ou passages laissés en gras, ou notés “illisible” dans la transcription.
1. On rappellera d’abord que ce n’est qu’à une date relativement récente que l’étude de l’anormal, du pathologique – identifions pour l’instant ces deux termes – a été sérieusement abordée et qu’on s’est avisé de sa portée capitale. La maladie ne paraissant qu’un phénomène négatif, une perturbation, un simple désordre, n’était-il pas évident que sa science est toute subordonnée à celle de la santé, à celle des processus assurant les équilibres du bon état de l’organisme ? Comment reconnaître l’anormal, si ce n’est par la connaissance de ce qui est normal ? Et s’il faut s’occuper de la maladie, n’est-ce pas dans l’unique but de la guérir, donc de la supprimer ? Et là où sa guérison ne semble pas possible, comme dans le cas de la folie, de quel intérêt pourrait donc bien être son étude ? Est-il sensé de s’occuper de l’insensé, de tenter d’élucider l’inélucidable ? C’est ainsi que longtemps on a estimé que tout ne pouvait qu’être fou dans un fou. Quand nous disons, c’est normal, synonyme de c’est naturel, n’entendons-nous pas : c’est explicable ? Anormal à l’état pur, monstrueux ce qui échapperait aux normes de l’intelligibilité. En biologie, il appartenait à Claude Bernard de montrer que l’approche scientifique du normal passe par le pathologique, que c’est celui-ci qui fournit la clef de la compréhension de celui-là. C’est souvent lorsqu’un organe se trouvée lésé, endommagé, que l’on peut s’aviser, de par sa disparition ou son dérèglement, de telle ou telle de ses fonctions, jusque-là inaperçue. L’étude psychologique du langage doit tout à l’examen des aphasies. En règle générale, le moins identifiable, le moins repérable, parce que trop présent, trop constant, trop familier, c’est le normal. C’est son évidence même qui le rend inévident. Il s’absente entièrement dans sa propre présence. Si l’anormal, en revanche, est le plus révélateur, il n’est plus permis de le définir brutalement, comme le contraire du normal, l’autre que le normal repousse hors de soi. Il reste du normal dans l’anormal. L’anormal n’est jamais aussi anormal qu’on voulait bien le croire. La psychiatrie moderne a mis en continuité le normal et le pathologique. La conscience malade n’a pas cessé de donner un sens, même brouillé, opaque, à ce qu’elle vit. Si le névrosé éprouve par exemple le conflit de l’amour et de la haine qu’il porte à telle personne comme une contradiction indépassable et angoissante, c’est que son conflit a bien lieu, en tout psychisme, il prend son origine dans la première enfance, ainsi le petit garçon aime son père mais veut tout aussi bien l’éliminer. La névrose commence quand l’ambivalence propre à nos sentiments est éprouvée de façon absolument intolérable. Des mécanismes de défense psychologique s’y contrarient sans compromis possible. D’où l’absurdité dans quoi sont pris les pensées et les actes du malade. Comme l’explique Foucault, il n’y a rien d’anormal à vivre une situation contradictoire, c’est le propre de la plupart des hommes, ce qui est pathologique, c’est de vivre contradictoirement une situation. Jusqu’au point où l’insupportable devient tel qu’il doit être purement et simplement nié, c’est la psychose, il se produit donc chez le malade rupture totale entre le moi et la réalité avec reconstruction délirante d’un monde modelé sur les instincts. Mais, dans ces conditions, nous ne sommes plus en présence de deux mondes séparés par un abîme. Le psychisme normal connaît lui aussi la contradiction, est aux prises avec des situations conflictuelles. La normalité elle aussi a ses problèmes, elle vit avec, elle les tolère, rarement elle les vainc, elle les surmonte réellement, mais elle s’en accommode, et elle les oublie, ce qui est encore une bonne façon de les résoudre. Tout aussi bien, le normal en perd beaucoup de son image rassurante, tranquillisante, il apparaît fragile, menacé, hanté du dedans par son autre. À la limite, c’est le normal qui se trouve encerclé par l’anormal, c’est le premier qui apparaît comme un cas particulier du second. Freud n’assure-t-il pas qu’à peine un homme sur mille parvient, sans fixation ou régression, au terme de la croissance psychologique qui en ferait un véritable adulte ? Pour autant cependant que l’on évite avec raison de couper les ponts entre le normal et le pathologique, on ne saurait sans absurdité effacer l’écart. Longtemps la folie fut désignée comme l’inintelligible, la psychiatrie s’efforce désormais de la comprendre. Mais autre chose est de pouvoir décrire le monde où est perdu le sujet malade qui ne le maîtrise plus, autre chose de rendre raison des conditions d’apparition de la maladie. On ne saurait expliquer l’angoisse névrotique par le conflit, puisque normalement le conflit ne provoque pas cette angoisse. Et pourquoi le désastre de la névrose en psychose ?
Le philosophe Jaspers a proposé à la psychiatrie qu’il appelle compréhensive ou encore existentielle la tâche de [pénétrer] par intuition dans la conscience malade. Il est vrai qu’elle demeure toujours signifiante jusque dans ses égarements et que ses non-sens sont encore sens. Mais si ce sens pouvait être le même pour le psychologue et pour le malade, il n’y aurait plus précisément folie ; il n’y aurait plus folie si le discours sur le fou pouvait correspondre exactement au discours du fou, lui-même. D’où la question sans nulle réponse satisfaisante : qui parlera de la folie ? Que sait au juste du fou le non-fou ? Et que sait le fou de lui-même ? S’il parle lui-même de sa folie, c’est, capable de la désigner, qu’il n’en est pas encore le prisonnier. L’anormal qui se saisit comme anormal est encore retenu au normal dont il n’a pas complètement décroché.
Si, en préliminaires, je développe ces considérations d’ordre épistémologique, c’est qu’elles n’ont pas le plus souvent retenu votre attention, et cette négligence rendait vos textes insuffisamment réflexifs. Réfléchir, c’est réfléchir sur ce dont on parle, se demander dans quelle mesure on est en droit d’en parler. Ayant à traiter de l’anormal, vous vous êtes donc docilement interrogés sur lui mais sans vous interroger sur les modalités de son propre traitement, sans qu’aucun discours de la méthode n’apporte quelque validité à votre propos. Revenons à la folie qui est la forme extrême de l’anormal. Comme on a pu le dire, parler de la folie, c’est à la limite n’en pas parler. Parler de la folie, c’est parler contre la folie. C’était parler contre la folie que de l’identifier, comme on l’a fait longtemps, avec une déraison, théoriquement inexplicable et pratiquement incurable. Mais, selon M. Foucault, ce sera parler encore plus contre la folie que de faire le projet de la soigner et de la guérir. Le fou jadis vivait en liberté, considéré comme aliéné, il va être enfermé. Sous couvert de s’occuper de lui, on le met à l’écart. Cet autre à l’état brut qu’il est devenu, on le met à l’écart des autres mais tout autant de lui-même, car il n’est plus un homme différent, ce n’est plus un homme du tout. Il est à la fois au dehors de l’humain et au dehors de lui-même, car sa vérité lui est étrangère, elle a pris la forme des catégories mises au point par la psychiatrie. Qu’est-ce que la folie, rien par elle-même, c’est ce que le psychiatre nomme folie, c’est ce qu’il dit de la folie, au gré d’un discours variable, du reste, car l’énoncé de ce qui est maladie mentale et de ce qui ne l’est pas différera selon les époques, et l’histoire de la folie ne sera plus rien d’autre que celle de la psychiatrie qui l’a investie jusqu’au plus profond d’elle -même et parle d’elle pour l’empêcher elle-même de parler ; à moins que chez un Sade, un Goya, un Van Gogh la déraison, créatrice d’œuvre, ne retire son bâillon et ne retrouve cette puissante voix devant laquelle un instant tremble le monde qui avait voulu se fermer à son écoute. De ce cri d’alarme de Foucault est né le mouvement de l’anti-psychiatrie actuelle dont on s’étonne que si peu d’entre vous aient dit le moindre mot, comme si on ne sait quelle prudence vous avait commandé de passer vous-mêmes sous silence tous les rapports que le sujet proposé pouvait entretenir avec l’actualité. Le prétendu malade mental n’est qu’une victime de [notre] société répressive, la preuve, c’est que ce n’est pas lui qui demande à être interné. On l’incarcère, parce qu’il dérange, il n’est pas comme les autres, parce qu’il proteste lui contre un monde humain rendu tout à fait inhumain. Ainsi les rôles doivent être inversés. C’est l’homme dit normal, à l’aise dans la décence sociale, l’aliéné qui aliène les autres, tous ceux qui refusent les instruments de pression, de coercition, famille, école, par lesquels l’homme se voit privé de l’ensemble de ses possibilités. « Lorsque, écrit un des maîtres de l’anti-psychiatrie, Laing, ce nouvel être, c’est-à-dire l’homme nouveau, dénaturé, artificiellement formé, atteint sa quinzième année environ, il est pareil à nous, un être à demi dément, c’est cela que l’on appelle aujourd’hui être normal. » L’on voit facilement sous quelle ambiguïté se protègent de tels propos. S’il est exact que la maladie a l’être d’un rapport, elle est inséparable de la relation médecin-malade, si la maladie est définie par le médecin, en suit-il qu’il la crée de toutes pièces, qu’il l’invente, qu’il décide absolument si elle est nuisible ou pas. Il est exact que sans les malades il n’y aurait pas de médecin, ce qui serait fâcheux pour la profession, faut-il en conclure intrépidement que sans les médecins, il n’y aurait pas de malades ? S’il est vrai qu’il n’y a pas d’être en soi de la folie, que le fou n’existe que par rapport aux autres, il est précisément cet homme qui, pour telle ou telle cause, ne parvient plus à vivre dans un univers commun, s’est isolé dans son monde symbolique où ne s’exprime plus que son psychisme élémentaire, voilà pourquoi il s’accommode en général parfaitement de l’asile où il a transporté tel quel son univers fantasmatique privé. Au fond, le discours anti-psychiatrique ne parle de la folie que pour la nier. Elle n’existe pas, elle ne doit son apparence qu’à la perversion criminelle de ceux qui la croient telle. Comment la folie serait-elle folle puisque c’est elle qui a raison ? Qui a raison contre la raison.
Clairs sont en effet les [modèles/motifs] délibérément anti-rationnels de l’anti-psychiatrie. Il s’agit, sous couleur d’exalter le jeu libre et sauvage des instincts, de dénier toute valeur à ce par quoi l’humanité peut se façonner, se [dessiner/dresser] elle-même en résistant à la tyrannie des instincts qui est toujours celle de l’immédiat. C’est le vieux rêve d’un retour à une bonne nature, non encore [éduquée et trahie] par la raison, que véhicule dans ses naïvetés roublardes l’anti-psychiatrie, la haine de la raison s’y donne libre cours. D’où la mobilisation au service de la cause, chez Foucault, des auteurs qui se sont proposés d’ébranler les assises, selon eux trop superficielles et raides, de la rationalisation. Avec eux, avec Sade, avec Nietzsche, c’est la déraison qui manifesterait ses pouvoirs infiniment créateurs. Mais autre chose est de critiquer la raison, autre chose d’être fou. La critique de la raison se fait elle-même au nom de raisons, elle se veut sensée. Nietzsche a pu, vers la fin de sa vie, sombrer dans la démence. Son œuvre n’était pas celle d’un dément. Longtemps on s’est imaginé pouvoir la déconsidérer en prétextant : cet homme est devenu fou, il serait aussi absurde de la célébrer pour les mêmes raisons. Et ce n’est pas davantage la folie qui conduisait le pinceau de Van Gogh. Si vous avez l’occasion de pénétrer dans une exposition de peinture de schizophrènes, vous observez que quel que soit l’intérêt provoqué par la bizarrerie de ces tableaux, ils n’ont pas de valeur réellement esthétique, ce qui gêne en eux, empêche toute impression de beauté, c’est l’étalage trop ostensible de phantasmes strictement privés, individuels. On a le sentiment embarrassé, le malaise d’entrer comme par effraction dans une intimité close.
Ces semblants d’œuvres, ce sont des révélateurs sur l’état de trouble mental de leurs auteurs. Les tableaux de Van Gogh ne sont en aucun cas des documents psychiatriques ; Van Gogh ne peignait pas ses divins tournesols et son soleil comme il les voyait. Il ne projetait pas sur sa toile un délire vécu. Il a créé un monde dont il nous a fait cadeau, qui est beau pour tous, qui n’est pas le simple reflet d’une subjectivité dont l’admirateur de Van Gogh a le droit de tout ignorer. Van Gogh a peint pour peindre, pour ajouter au réel quelque chose dont il manquait, le schizophrène ne peint pas, il ne sait pas ce que c’est que peindre, même si par ailleurs la peinture est pour lui un excellent moyen de se distancier quelque peu de ses hallucinations en les objectivant, mais c’est du subjectif qu’il objective ainsi. De ce point de vue, la vieille définition d’A. Comte reste la meilleure. La folie est l’excès de subjectivité. La raison, c’est l’universel. Rationnel, non l’esprit qui pense forcément comme les autres, mais celui qui entend donner figure d’universalité à ce qu’il pense. Faute de quoi de Galilée aussi on pourrait dire qu’il était fou et que la physique ne progresse que grâce à quelques esprits particulièrement anormaux. C’est l’impossibilité de communiquer avec un monde commun qui caractérise la folie. Sartre faisait il y a déjà longtemps cette remarque où l’anti-psychiatrie pouvait se trouver en germe qu’il existe des sociétés dont la structure oppressive pour la plupart de leurs membres, est si objectivement difficile à vivre, pénible qu’il est normal qu’elle conduise certains, tout simplement plus lucides que d’autres, à la maladie mentale. On rectifiera : à la détresse, peut-être, avec toutes ses séquelles, non pas à la folie. On peut être désespéré de voir s’effondrer toutes les valeurs auxquelles on croyait et qu’on juge irremplaçables, sans pour autant être fou. La folie commence, comme le rappelle R. Ruyer, lorsque l’activité symbolique de l’homme, faute de pouvoir trouver dans un monde idéal comme dans le monde réel, une demeure solide et vivable, devient subjective, tourne à vide, et constitue un faux monde à l’aide de matériaux empruntés aux sensations organiques et au psychisme sur son aspect le plus individuel et le moins intentionnel. Il faut donc s’y prendre à deux fois pour oser déclarer, avec un de ses thuriféraires actuels, que la schizophrénie est révolutionnaire. Le révolutionnaire se révolte, milite pour un ordre humain à venir, le schizophrène se réfugie dans l’isolement où il se mure, on ne l’en blâmera certes pas, c’est une victime, mais il serait tout aussi indécent de le citer en modèle. Au demeurant, les statistiques montrent que les malades mentaux se rencontrent le plus fréquemment parmi les couches privilégiées du système social et plus spécialement chez les oisifs.
Ajoutons encore ceci : suivant Michel Foucault, avec beaucoup trop de zèle, certains d’entre vous ont opposé à notre époque moderne où la démence serait si injustement stigmatisée, des périodes heureuses, avant le grand enfermement du 17e siècle, où les fous auraient été parfaitement intégrés à la vie collective. En somme, l’anormal y aurait été tenu pour normal à sa manière. Il avait, par une bonne économie des choses humaines, son rôle à tenir. Cette reconstitution historique est on ne peut plus fausse.
Les fous au Moyen Âge sont rejetés, exclus des villes, envoyés de force par [bandes/hordes], laissés à l’abandon vers de lointains buts de pèlerinage. Le Moyen Âge a vécu, au contraire, dans la peur et l’horreur de l’anormalité, il la voit partout, il la pourchasse. Lisez donc La sorcière de Michelet. Ce qui est exact, c’est que le fou alors impressionne, il intimide, il serait dangereux, impie de le maltraiter trop ouvertement. En effet, cet homme n’appartient plus aux hommes, il ne relève que de Dieu qui l’a déjà frappé sur cette terre pour ses péchés abominables, ou plutôt, l’a, pour ses crimes, laissé en pâture au démon qui a pris possession de lui. C’est en quoi il est sacré, objet à la fois d’horreur et de fascination. Foucault nous dit que pendant longtemps la raison avait eu la sagesse d’accepter de coexister avec la déraison, qui serait comme sa moitié nocturne. En fait, l’exploitation du thème de la folie, encore si présent chez Pascal, tourne toujours à l’humiliation de la raison et de l’homme. C’est le péché originel qui a affolé l’humanité entière, au point que, dans cet embrouillement indissoluble, cette corruption universelle, il n’est plus si aisé de distinguer entre la sagesse et la folie. Est-ce l’homme raisonnable qui est le plus grand des fous ou le fou qui serait, à sa manière, le plus raisonnable ? La folie sera donc là pour signifier à la raison qu’elle doit être prudente en ses jugements, ne pas trop s’illusionner sur elle -même ; tel est le sens de l’Éloge de la folie d’Érasme. Il permettra à son auteur de dénoncer les limites de la science, le ridicule des pédants, l’infatuation des érudits, et des théologiens, la malfaisance des moralistes qui, au nom de règles rigides et arbitraires de sagesse, se plaisent à gâcher notre vie. Finalement, l’errance du fou, de ville en ville, symbolise celle de l’homme en cette existence où il s’est éloigné de Dieu et de ses directives. Foucault explique que la dégradation de l’image de la folie, l’incarcération des malades mentaux sont dus au triomphe d’une raison, confortée par ses progrès scientifiques, philosophiques dans sa confiance en elle-même. De la folie la raison n’a dès lors plus rien à apprendre sur son propre compte, elle peut la mépriser. Si le fou était un être initialement doué de raison, c’est par sa faute qu’il s’en privé, par sa faute que cet homme s’est rendu indigne de son humanité. Il y a de nombreuses années, on avait posé au Concours Général ce très beau sujet : si l’homme est défini comme un animal raisonnable, que signifiera l’expression « perdre la raison » ? Le voici transformé en coupable. Soit. Mais [n’avait-il] pas toujours passé pour tel ? Toujours il avait été réputé pour quelqu’un de foncièrement mauvais. Mais, au Moyen Âge, ce qui prenait une forme paroxystique chez lui était à renvoyer à un mal latent chez tous les hommes et d’avoir été châtié par Dieu le faisait échapper aux punitions humaines. De fait, tant que la folie fut considérée comme un évènement d’origine surnaturelle, ainsi chez les Grecs, Zeus l’a perdu, le fou fut soustrait aux rigueurs d’une [illisible] humaine.
Mais la question se pose : sont-ce les progrès d’un certain esprit scientifique, ou bien le déclin de la foi religieuse, qui n’en est nullement une conséquence directe, qui expliquent l’enfermement des fous ? Au 18e siècle, effectivement, la condition dans les asiles était atroce. On y était couvert de chaînes, en butte à de continuels sévices. Mais Foucault fait-il preuve de justice lorsqu’il associe à la même idéologie malfaisante les efforts humanitaires d’un Pinel et d’un Esquirol, œuvrant du reste contre l’inertie, si ce n’est l’hostilité des pouvoirs publics et de l’opinion ?
Qu’on comprenne bien le sens de ces remarques. Elles ne sont pas destinées à justifier les pratiques de l’asile ou à cacher que dans une certaine conception qu’il se fait de la folie ne se répande la mauvaise conscience des hommes tels qu’ils sont devenus. Il y a certes beaucoup à méditer dans les travaux de Foucault. On demandera seulement s’il est sérieux de nier l’existence de la folie ou d’y voir, somme toute, comme les anti-psychiatres, un réflexe de santé, ou beaucoup plus gravement encore de la transformer en un thème littéraire, orné de préciosités.
Nos [schizolâtres/nietzscholâtres] actuels n’ont jamais visité une salle de Sainte-Anne. Au demeurant, l’on discerne très bien tous les articles qu’à l’occasion du pamphlet anti- psychiatrique on glisse en contrebande : le refus de toute culture, dès lors qu’elle oblige à une quelconque discipline, l’exaltation d’une nature mythique, sans obligations ni sanctions, les revendications du libertinage dont les intellectuels qui ne le pratiquent guère aiment à se faire les champions. D’où le thème du plaisir fou, du désir fou, de l’amour fou. Mais il est clair que le terme de folie n’a là plus rien à voir ici avec son acception commune, il permet le double jeu auquel se livrent des apologies de la folie qui seraient risibles si elles n’étaient odieuses. Cette mise au point était requise pour gommer certaines outrances étalées un peu candidement par quelques copies. On la laissera donc là. Du reste, je ne suis pas sûr que la maladie mentale soit du ressort du philosophe, si ce n’est pour alerter contre les exploitations pseudo-philosophiques que l’on peut en tirer. Le sujet portait sur l’anormal, or la folie, cette situation limite, est au-delà de l’anormal. On peut refuser les normes auxquelles se plient les autres, se complaire dans l’excentricité, sans être fou. La folie n’est pas impliquée dans une dialectique du normal et de l’anormal qui invitait à assouplir la conception de leurs rapports. L’anormal n’est-il que désordre ou n’a-t-il pas son ordre à lui ? Si l’anormal résulte de l’infraction à une norme, n’est-ce pas la norme elle-même qui appelle sa propre transgression ? Ce qui distingue l’anormal du fou, c’est qu’il revendique sa propre normalité. Ainsi les personnages de Sade se réclament de la nature donnant l’exemple du vice et de la malfaisance. Découverte de Sade, en plein optimisme des Lumières, la bonne nature, c’est la mauvaise. Et quoi de plus naturel après tout qu’une maladie ? N’est-il pas normal de tomber malade, et ne sont-ce point, au contraire, certains états apparents de santé qui sont artificiels et malsains ? L’anthropologue Goldstein, l’auteur de La structure de l’organisme qui a exercé une influence capitale dans le développement des sciences de l’homme contemporaines, a attiré l’attention sur ce point. Il est, note-t-il, certaines personnes âgées, paraissant jouir d’une très robuste santé, c’est d’elles qu’on dit qu’elles nous enterreront tous. Effectivement, elles ne sont sujettes qu’à de légers bobos. Mais c’est parce qu’elles vivent d’une vie prudente, diminuée, emmitouflées et au coin du feu. Aussi, à la première atteinte sérieuse, seront-elles rapidement emportées. Inversement, l’organisme solide peut affronter les intempéries, les fatigues, il en sera éprouvé le cas échéant mais sans trop graves dommages. Être en bonne santé, dit Goldstein qu’on ne soupçonnera pas d’être un émule du docteur Knock, c’est pouvoir tomber malade, sous-entendu et en réchapper. Goldstein, par cet exemple, critique de trop hâtives conclusions de la médecine clinique. On dira, les lésions de tel organe, ou son ablation, n’empêchent pas un organisme de survivre, c’est qu’il ne lui était pas indispensable. Oui, s’il s’agit précisément d’un vivant placé lui-même dans des situations anormales, comme un homme dans une chambre d’hôpital, ou l’animal dans un zoo qui n’a plus aucune dépense d’énergie à fournir pour subsister. De cette analyse de Goldstein se tire la très importante conclusion que la normalité, loin d’être un fait objectif, dépend de l’appréciation que l’on forme des véritables normes. Qu’est-ce qu’un organisme en bonne santé, celui qui a besoin d’une douillette sécurité ou celui qui est en mesure de prendre des risques ? Comme un ordre peut porter en lui-même les germes du désordre qui le décomposera, il peut y avoir une mauvaise sécurité du normal, celle de la routine, de l’endormissement. L’anormal sera toujours en revanche revêtu des traits du nouveau, du dangereux, mais est-il normal, pour un individu ou une société, que de se fermer à eux ?
Le normal, lui-même, n’atteste-t-il pas sa chétivité si, recroquevillé sur soi, il ne fait droit à l’anormal, s’il ne sait l’intégrer à soi. L’anormal n’est pas forcément le pathologique. Il existe une fonction de l’anormal, un besoin tout à fait normal de l’anormal, cf. le succès constant de la littérature fantastique, qu’il s’agisse du bizarre, de l’insolite ou du miraculeux. Est-il normal par exemple de considérer la vie comme quelque chose de tout à fait normal, de devenir insensible à tout ce qu’elle peut avoir de merveilleux ? Est-il normal d’être complètement normal ; qui se réjouirait de dire, le Français moyen, Monsieur Dupont, c’est moi ? Un homme sans singularité ne serait-il pas le plus singulier des hommes ? Une question dès lors se pose que vous n’avez pas toujours très nettement dégagée.
2. Le cas historique de Socrate a du reste considérablement embarrassé Durkheim. On sent très bien qu’en sociologue il se serait volontiers rangé au verdict du peuple athénien. Sa formation morale l’empêche d’applaudir à la condamnation. Il usera donc d’expédients, alléguant entre Socrate et ses concitoyens un malencontreux malentendu. En réalité, les institutions d’Athènes ne lui étaient plus adaptées. Elles avaient fait leur temps, elles étaient déjà elles-mêmes condamnées, elles ne correspondaient plus à l’Athènes nouvelle. Encore fallait-il pour s’en aviser une prise de conscience qui ne saurait jamais être immédiate, demande du temps. Seul le génie de Socrate avait pu la faire aussi promptement.
Socrate n’opposait donc pas aux réalités [civiques/historiques et XXX] une chimère extra-temporelle. Il signifiait à une réalité en passe de disparaître les droits d’un nouvel état de fait en train de se préparer. Son unique tort fut d’avoir eu raison trop tôt, d’avoir eu raison le premier. C’est ainsi qu’au mépris de l’idéal, positivement éconduit, comme du réel, le civisme à Athènes n’allait cesser de s’affaiblir, Durkheim tente en vain de mobiliser sa science à la rescousse de la moralité socratique.
3. Le philosophe [illisible] ne connaît pas les hommes, il ignore nous dit-on [ses vérités], c’est que ce qui compte pour lui c’est l’idée de l’homme, l’intelligence de l’essence de l’humain. Puisque cette idée n’avait aucune portée scientifique, puisque l’homme de science, allègue-t-on, ne doit considérer que des comportements réels,