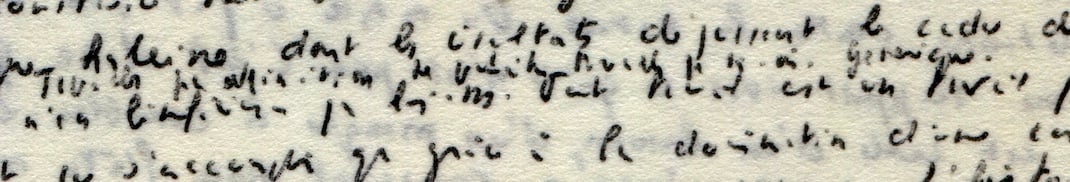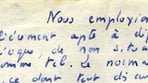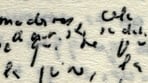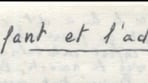matière et matérialisme (suite p 8-9-10-11)
Vérification en atelier du 16 janvier 2025


Faisons le point : l’idéalisme isolait le sujet de l’objet. Il opposait la spontanéité de la conscience à l’inertie du réel. C’était là un reflet idéologique de la division maître-esclave. Dans un premier temps, le matérialisme fait rentrer le sujet dans l’univers des choses. Cependant, le déterminisme ne saurait composer la vérité de la praxis révolutionnaire. Le déterminisme, en effet, ignore, contredit toute nouveauté. L’effet d’avance était contenu dans sa cause, tout n’y existe qu’au passé. Or c’est bien là le propre de toute idéologie que de s’employer à justifier, donc à perpétuer un état de choses, c’est-à-dire, par définition, une situation passée. Toute idéologie est donc rétrograde dans la mesure même où toute justification est seconde. L’idéologie s’étend, s’établit comme système quand la classe dominante a besoin d’elle, c’est-à-dire quand des contradictions se font jour dans sa propre pratique, contradictions que l’idéologie a pour but d’étouffer, de réduire. L’idéologie est donc toujours une erreur puisque la réalité qu’elle essaie de transformer en vérité universelle et éternelle est une réalité déjà compromise, ébranlée, condamnée. Inversement, pourquoi la praxis révolutionnaire engendre seule une connaissance vraie : parce que toute situation ne surgit dans sa vérité que pour ceux qui peuvent décoller d’elle et prendre ainsi un point de vue sur elle. C’est dire que la vérité de cette situation n’est accessible qu’à ceux qui la dépassent, c’est-à-dire qui la saisissent dans la perspective du futur dans quoi elle s’abolira. Mais qu’est-ce que ce mouvement par quoi la vérité d’une situation, d’un moment donné, au lieu d’être contenu analytiquement dans ce qui la précédait, ne se constitue que par l’acte même qui la domine et la nie, c’est un mouvement dialectique. Seulement, cette dialectique ne saurait, comme le voulait Hegel, se passer uniquement entre des idées. Au fond, ce n’est que par une formule très inexacte que l’on peut parler d’un mouvement d’idées, d’un mouvement entre idées. Une idée n’est vraie que par les rapports qu’elle entretient avec toutes les idées vraies. Sur ce point, Spinoza a raison : dans la moindre idée vraie est déjà présent l’ensemble, le système des idées vraies qui la soutient. Sans doute, la déduction d’une idée à l’autre demandera du temps et laissera ainsi croire à une fécondité, à une créativité du mouvement de pensée qui a permis de passer de l’une à l’autre, mais en réalité nous n’avons fait que retrouver avec du temps un système d’implications lui-même intemporel. C’est pourquoi Hegel a enfermé le devenir lui-même dans un cercle immobile, où l’absolu est à la fois au début et à la fin, et où les différents moments coexistent finalement dans la totalité où ils s’éternisent en vérités.
Il n’y a donc qu’une activité, une action réelle pour être dialectique. Voilà le premier et principal reproche que Marx adresse à Feuerbach, d’avoir conçu l’homme comme être sensible, c’est-à-dire nature biologique, isolée, passive. Thèse 1 : « Le défaut principal de tout le matérialisme passé (y compris celui de Feuerbach) est que l’objet, la réalité, la matérialité n’y sont considérés que sous la forme de l’intuition, mais non comme activité sensible de l’homme. Chez Feuerbach, l’objet se donne comme objet d’intuition, ce qui suppose qu’il a sa nature en lui-même, de toute éternité. Feuerbach néglige qu’il n’y a pas d’objet pour nous qui ne soit le produit d’une industrie. Feuerbach continue à mettre l’homme d’un côté, la nature de l’autre, une nature qui serait antérieure à l’homme et qui, excepté peut-être, dit Marx, dans L’Idéologie allemande, sur quelques îlots coralliens d’Australie nouvellement apparus, n’existe plus nulle part, n’existe plus donc pour Feuerbach. » Ce que Feuerbach n’a pas vu, c’est que l’homme n’est pas sensation, il est besoin. Ce que Hegel n’a pas vu de son côté, c’est que toute dialectique est mouvement d’un besoin. Le besoin, c’est le contraire d’un état. S’il est vrai qu’est dialectique tout mouvement dont chacun des moments n’est ce qu’il est que par tout ce qu’il n’est pas encore, c’est-à-dire n’existe qu’en sortant de soi en s’appelant dans l’avenir, en ce cas il n’y a pas mouvement plus dialectique que celui d’un besoin. C’est pourquoi, dans le besoin, le biologique se pose comme conflit, contradiction. Le besoin est dans le biologique ce qui dépasse le biologique. Comme l’écrit Sartre, dans l’Etre et le néant : « la soif comme phénomène organique n’existe pas. L’organisme privé d’eau présente certains phénomènes positifs, par exemple un certain épaississement du liquide sanguin, lequel provoque à son tour certains autres phénomènes. L’ensemble est un état positif de l’organisme qui ne renvoie qu’à lui-même, tout juste comme l’épaississement d’une solution dont l’eau s’évapore ne peut être considéré en lui-même comme un désir d’eau de la solution. » Autrement dit, ce n’est pas extérieurement, pour quelque observateur, que le besoin est manque, le besoin est à lui-même son propre manque de. Il est hanté en son être le plus intime par l’être absent dont il est besoin. Le besoin ne se réduit donc pas à un état purement objectif, conditionné par tout ce qui l’a précédé ; ce n’est pas quelque chose mais qui manque encore de ceci ou de cela, il n’est de part en part que manque, échappement vers. C’est ce que veut dire Marx quand il définit l’homme comme scission dans la nature de la nature avec soi. L’homme est ainsi cette nature qui a sa nature hors de lui, qui ne participe à la nature qu’en se séparant d’elle. L’homme, être de la nature, se retourne contre la nature. Du monde il fait son monde. L’être de besoin dépassera donc la nature, mais il ne pourra le faire que dans la nature elle-même. Le besoin établit donc l’être qu’il qualifie comme rapport avec ce qu’il n’est pas. C’est dire que le besoin est l’origine de la conscience. Toute conscience est celle d’un besoin, d’un manque à combler. La conscience trouve ainsi son origine dans la nature, c’est d’elle qu’elle émerge. Conscient sera l’être nécessiteux, l’être qui souffre, l’être qui n’est pas englobé dans la nature, ajusté à elle, l’être pour qui la nature n’a pas de présence immédiate, positive. Le besoin est désaccord, rupture. La nature ne lui apparaît d’abord que comme ce qui ne le satisfait pas directement, le refuse, le nie. Le besoin éprouve la négativité de l’objet. Marx s’oppose donc à la fois à un idéalisme qui réaliserait la conscience hors de la nature, comme substance indépendante, et à un matérialisme qui ferait de la conscience une formation seconde, superflue, un épiphénomène. En ce sens il n’y a pas d’explication de la conscience, pas plus que d’explication de l’homme. La pertinence du marxisme, c’est de remplacer une genèse par une histoire. D’emblée, parce qu’il est besoin, l’homme est histoire, l’homme est capable d’histoire. Le besoin s’ouvre à l’histoire et ouvre l’histoire. Donc l’homme, Marx dit qu’il est l’origine de l’homme. Cela signifie que ce qui fait l’homme ne se définit toujours que par son rapport à l’homme. L’animal, dit encore Marx, est mêlé à la vie humaine mais il n’y participe pas. L’animal est insusceptible d’être atteint, frappé par une négation. La bête de somme ne mène pas une existence inanimale. C’est que la vie animale n’est qu’un fait ; or un fait ne se nie pas, il est simplement remplacé par un autre, détruit. Or une négation est bien davantage qu’une suppression, une disparition. Etre nié, c’est être lésé. Ce n’est pas seulement subir un dégât, c’est être l’objet d’un tort. L’animal, comme le chien frappé, peut avoir le sens du douloureux, nullement celui de l’injuste. Etre nié, c’est être atteint dans son être le plus intime, c’est-à-dire dans son droit. La négation divise, rend l’homme extérieur à soi. Le besoin demeure, mais vide, inerte, coupé de sa vérité, de ce dont il est le besoin. L’homme vit alors son activité sous forme de passivité, d’impuissance. Toute conscience est d’abord celle d’une impuissance. Et c’est pourquoi la conscience sera passion. « La passion, écrira Marx, est la force essentielle de l’homme tendant vers son objet. » L’essence de l’homme, c’est donc son inessentialité. C’est pourquoi l’homme ne peut s’éprouver que dans l’inhumain. L’inhumain est la manifestation même de l’humain, son ressort dialectique. Il n’y a que l’homme à subir l’inhumain. Et travail sera dialectiquement ce par quoi l’homme nie ce qui le nie, le transforme, et du même coup l’humanise en s’humanisant lui-même. La synthèse est toujours donc travail. En quoi le besoin humain se distingue-t-il du besoin animal ? Dans une thèse d’inspiration marxiste, intitulée L’être et le travail, Jules Vuillemin en rend compte de la manière suivante : « « Comme l’animal, l’homme mène une vie naturelle, limitée, incomplète, et doit rechercher au dehors ses conditions de vie. Toutefois… si le besoin animal vise un ensemble de fins complémentaires bien définies et relativement fixes, le besoin humain possède le privilège d’aspirer non plus à se stupéfier dans un « environnement » qui l’hallucine, mais à se recréer à partir de lui-même, à se servir de ses propres limites pour les briser et à se déterminer relativement non pas à un espace figé dans l’instinct, mais à un monde transformé et créé continûment dans le travail. » Tandis par conséquent que l’animal reste dans la nature comme un arbre dans une forêt, tandis qu’il ne parvient pas à reculer les bornes de son environnement mais simplement à s’y ajuster le mieux qu’il peut, grâce à d’uniques détours, et c’est pourquoi le comportement de l’animal n’est certes pas si rigide que le décrétait la psychologie de l’instinct, il est malléable, plastique, capable de variations, mais ces variations ne font que broder sur un thème unique, car la gamme des réponses de l’animal est limitée par la constance de ses excitations, de ses stimuli, l’homme ne s’adapte pas seulement à la nature, il l’adapte à lui, c’est-à-dire que son action crée des stimuli nouveaux. Ainsi les sens se cultivent et s’affinent, ils deviennent humains en considérant un environnement humain, c’est-à-dire un environnement œuvré, travaillé, non plus choisis mais produits. Dès lors, ce que la conscience découvre dans la nature, c’est non plus une réalité étrangère mais son œuvre, sa création, la concrétisation de sa présence, son identité mais conquise, victorieuse avec l’objet. Alors que le besoin animal ne tendait qu’à sa dissipation, il se satisfaisait par la nature et mourait en elle qui était son tombeau, comme une force simplement naturelle naît d’une rupture d’équilibre qu’elle tente d’abolir, le besoin de l’homme se réalise dans la nature, il ne s’y liquide pas, il s’y accomplit. Il ne se détruit pas dans l’objet qu’il détruit lui-même, il se parfait en le façonnant. Le besoin, par le travail, prend conscience de sa positivité, il se prend à lui-même pour objet. Tandis que l’animal n’était que besoin, l’homme sera, comme dit Marx, besoin de besoin. Non seulement l’homme complète sa nature, il se donne des besoins nouveaux, mais c’est le travail lui-même, cette activité en soi contre-nature, qui devient pour lui un besoin qui s’incorpore à sa nature. Dès lors l’histoire de l’homme n’est rien d’autre que celle de la production, de la production de l’homme par le travail humain.
Cette production s’inscrit dans une dimension sociale. Là encore se révèle la nature dialectique du travail. De même que le travail permet de dépasser, de surmonter la distinction du biologique et du spirituel, il unit synthétiquement la société et l’homme. Il interdit toute explication – à la manière durkheimienne – de l’homme par la société, comme toute genèse de la société à partir d’éléments proprement individuels et par conséquent a-sociaux. En fait, l’homme et la société s’engendrent réciproquement. Marx écrit dans Economie politique et philosophie : « De la même façon que la société produit elle-même l’homme comme homme, elle est produite par lui. » De même donc que le besoin était dans la nature ce à partir de quoi elle se rendait humaine, de même le travail est ce par quoi un groupe se structurera en société. La division technique se constitue en effet en une division sociale. Si les sociétés que l’on disait jadis sauvages, si les sociétés primitives sont non oppressives, tout au moins, car le politique y est déjà présent, fort peu oppressives, c’est que la technique n’y a pas encore fait son apparition. Ces sociétés vivent des ressources immédiates de la nature, chasse, pêche, cueillette, c’est-à-dire qu’elles sont soumises à ses rythmes, elles dépendent de son présent. Le travail réel commence avec la production, c’est-à-dire l’œuvre, le façonnement. Le travail commence quand l’effort ne vise plus à une satisfaction, à une consommation immédiate. Le travail, c’est demain dans aujourd’hui, c’est aujourd’hui sacrifié à demain. Le travail, c’est la longue vue. Le travail requiert donc une société, dans la mesure où l’individu ne suffit pas à le réaliser. Le chasseur peut et préfère chasser seul, mais le paysan est incapable de construire tout seul une digue suffisante au bord du fleuve. Le travail exige en outre une construction de longue haleine, dont les résultats dépassent le cadre de la vie individuelle. Travailler, par définition, ne peut être travailler pour soi-même. Générique.
Le travail doit donc être imposé à l’individu qui n’en bénéficiera pas lui-même. Tout travail est un travail forcé. Ainsi les grands, les immenses travaux égyptiens n’ont pu s’accomplir que grâce à la domination d’une caste puissante, guerrière. Mais inversement, ils ne profitent qu’à cette caste, ils fortifient sa puissance. L’histoire du travail devient dès lors l’histoire de l’asservissement, de l’aliénation du travail. La production et le produit se dissocient. Non seulement le producteur n’est plus le maître de son produit, il ne lui appartient pas, mais le producteur n’a même pas vendu son travail ; il n’a vendu que sa force de travail, en échange de quoi il ne recevra que le salaire qui lui permettra de la restaurer en régénérant ses forces. Telle est l’origine de la plus-value. En effet, le capitaliste vend la marchandise selon la valeur totale du travail qui a été mis en œuvre, or de ce travail il n’a payé qu’une partie, simplement ce qui assurera à l’ouvrier de continuer à travailler. Tandis donc que celui qui travaille voit l’objet produit par son travail s’opposer à lui comme un être étranger, comme une puissance indépendante, tandis que sa vie productrice, loin de l’humaniser, de le parfaire, lui apporte seulement de quoi assurer le besoin le plus élémentaire, le plus biologique : celui de la conservation, tout au contraire les activités purement intellectuelles, non manuelles, de la classe dominante se voient parées de toute l’excellence humaine. A elles sont accordées l’inspiration, la spontanéité générale. La contemplation, le désintéressement deviennent les vertus cardinales de l’homme. La théorie de la pensée, c’est-à-dire de la pensée de la classe dominante, s’imagine, comme le dit Henri Lefebvre, pouvoir se libérer du réel et construire de l’abstraction, des représentations pures. La conscience croit pouvoir se réaliser hors de la réalité, s’affirmer comme puissance autonome et souveraine, comme essence à part. C’est le règne de l’idéologie. C’est à partir de ce moment, écrit Marx, dans l’Idéologie allemande, c’est-à-dire à partir de la division du travail que la conscience peut réellement croire qu’elle est autre chose que la conscience de la praxis existante, qu’elle devient capable de s’émanciper du monde, et d’entreprendre l’élaboration de la « théorie pure », de la théologie, de la philosophie, de la morale, etc. Il nous reste à déterminer quel est chez Marx le statut de la conscience.
On ne dira pas que Marx fait de la conscience une formation dérivée, accessoire, un épiphénomène. D’emblée la conscience est présente, mais engagée dans une pratique, insérée dans une activité réelle, c’est-à-dire matérialisée. « L’homme, écrit Marx, a une conscience, mais elle n’existe pas tout d’abord comme pure conscience. L’Esprit porte d’abord la malédiction d’être accablé par la matière, qui se présente ici sous forme de couches d’air, de sons, bref, sous forme de langage. Le langage, c’est la conscience pratique, il résulte du besoin, de la nécessité du commerce avec d’autres hommes. » Cette conscience est d’abord conscience de limites. C’est de l’éprouvé. « La conscience est naturellement d’abord simple conscience sensible de l’environnement sensible, conscience du lien borné avec d’autres personnes et d’autres choses extérieures. » Cette conscience s’aiguise avec le besoin, elle s’affine avec le travail. Travailler, c’est anticiper, prévoir, projeter. Mais la conscience, dans la classe dominante, après la division du travail, se détachera de la praxis, elle pensera qu’elle se pose elle-même, qu’elle est l’origine de ses idées qui sont en réalité déterminées par la production matérielle, par les conditions de vie. Un retournement s’opère : tout est mis à l’envers. A la conscience de l’homme se substitue l’homme de la conscience. La conscience qui est inséparable de l’être conscient, réel, sentant, agissant s’établit imaginairement comme être total. Marx compare l’idéologie à une chambre noire : il faut comprendre quelle est la vocation de la conscience pour l’idéologie, en qui la conscience est non pas irréelle – elle a au contraire un pouvoir terriblement réel, celui de réfléchir le réel et de le percevoir autrement qu’il n’est – non pas irréelle, mais irréalisante. La conscience s’illusionne sur les choses parce qu’elle s’illusionne sur elle-même, parce qu’elle est tout entière illusion, parce qu’elle est différence d’avec l’être réel dont elle est la conscience. Une activité pure, qui se développerait sans rencontrer aucun obstacle, serait totalement inconsciente. Avoir conscience, c’est d’abord avoir conscience de ses limites. Avoir conscience, c’est subir, non pas directement le monde lui-même, mais le contre-coup, la répercussion de l’action. Nietzsche l’avait vu : il est de la nature de la conscience d’être réactive. La conscience sera donc portée à loger dans le réel, en tant que force positive, spontanée, ce qui n’est que résistance à la propre force de l’activité humaine. C’est pourquoi, comme Marx le remarque dans l’Idéologie allemande, dès ses plus humbles moments, alors qu’elle est encore empêtrée dans la sensibilité, la conscience est déjà religieuse, fétichiste, surnaturalisante. C’est le culte de la Nature comme puissance terrible, comme force adverse. Déjà la conscience projette l’activité dans les choses et l’aliène en elle. Mais, d’autre part, comme la conscience n’est pas ce dont elle est conscience, sinon elle s’absorberait en lui, et c’est là la vérité de l’idéalisme, l’idéalisme est vrai en tant que théorie de la conscience, faux en tant qu’il lui échappe que la conscience est erreur – c’est là donc la vérité de l’idéalisme, au sens où Lachelier pouvait dire que la conscience d’une douleur n’est pas douloureuse, elle est vraie, et de même la conscience d’un travail ne suppose nul travail de la conscience, la conscience devenue conscience d’un être actif, où le besoin s’est fait besogne, cette conscience en tant qu’existence séparée va inverser le réel, c’est-à-dire que la conscience de l’activité va se poser en activité — mais feinte, imaginée, de la conscience. Faire la théorie réelle de la conscience, c’est-à-dire étudier comment dans une conscience la pratique se transforme en théorie, l’activité s’efface dans l’idée de l’activité, c’est faire, au sens kantien du terme, la théorie de l’apparence. Marx l’a souligné : si l’apparence était le réel, si l’être était l’être perçu, comme le croit un matérialisme trivial, la science n’aurait plus aucune raison d’être. On peut voir dans ce point de vue dans l’idéologie allemande l’équivalent, sur de toutes autres bases bien sûr, de la Dialectique transcendantale de Kant. L’idéologie allemande, c’est la Critique de la raison pure. Ou, si l’on préfère, il y a chez Marx un mouvement que l’on pourrait rapprocher de la démarche spinoziste. Nul moins que Spinoza n’a été, au sens banal en philosophie de cette expression, un philosophe de la conscience. La conscience, telle qu’elle s’exerce en chacun, c’est la connaissance du premier genre, la fausse connaissance imaginative. Rappelons la définition spinoziste de l’imagination : c’est l’idée d’une affection du corps humain, en tant qu’elle enveloppe à la fois la nature du corps humain, affecté, et la nature du corps extérieur qui l’affecte. Cette idée est nécessairement confuse, en tant qu’elle semble nous révéler la nature de l’objet extérieur ; il est brûlant, rugueux, etc., alors qu’elle nous renseigne surtout sur l’état de notre corps. La simple conscience, empiriquement déterminée, est erronée, parce qu’elle perçoit des effets, et les causes elles-mêmes, simplement à travers les effets que nous en subissons. De cette conscience, Spinoza dit qu’elle est la science des conséquences séparées de leurs prémisses. Et c’est pourquoi la principale illusion de la conscience est bien, pour Spinoza aussi, celle de l’indépendance, de la liberté. L’enfant croirait lui aussi se porter librement vers le sein de sa mère. On n’a conscience de la liberté que dans la mesure où on ignore les causes réelles qui déterminent l’activité. Et de même que pour Spinoza la connaissance vraie ne pourra s’établir à partir des données vécues de la conscience, mais il lui faudra, déductivement, partir des notions communes, c’est-à-dire de l’idée des réalités qui se retrouvent intégralement dans le tout comme dans les parties, c’est-à-dire qui constituent l’essence du corps humain comme celle des corps qui l’environnent, ce qui permettra une physique où l’ordre des faits sera saisi dans son enchaînement réel et logique, et non pas selon la succession arbitraire, décousue, incohérente que la conscience éprouve, de la même manière l’explication marxiste ne part pas de la conscience pour retrouver la démarche réelle de la pratique, elle part du développement de la praxis pour expliquer les formations erronées de la conscience. (La critique de l’économie politique chez Marx se présentera donc elle aussi sous une forme copernicienne). Marx écrit, Capital, I : « l’analyse économique de la concurrence n’est possible que lorsque la nature interne du capital est comprise, exactement de la même façon que le mouvement apparent des corps célestes n’est intelligible que lorsque leur mouvement réel, mais insaisissable par les sens, est connu. » « Si, reprendra Marx en Capital, III, comme le lecteur a malheureusement pu s’en rendre compte, l’analyse des rapports réels, internes – cela veut dire qu’ils obéissent à une logique dialectique et que cette logique n’est pas observable –, si l’analyse des rapports du processus de production capitaliste est une chose fort complexe et un travail fort long, si la tâche de la science consiste à réduire le mouvement visible, purement apparent, au mouvement interne et réel, on comprend aisément que dans la tête des agents de la production et de la circulation capitalistes doivent se former des représentations fort éloignées de ces lois, qui sont simplement les expressions conscientes de ce mouvement apparent. Les représentations d’un marchand, d’un boursier, d’un banquier sont nécessairement fausses. » note illisible (conscience /science vraie)
C’est pourquoi une simple critique psychologisante de ce qui se passe dans la tête des oppresseurs, c’est-à-dire le procédé du socialisme non scientifique, serait vaine et sans intérêt. La critique ne se réduit pas aux dimensions pseudo-vertueuses d’une dénonciation. Expliquer le capitalisme en se contentant de décrire de sombres desseins, de noires intentions, c’est toujours être dupe de l’apparence et accorder à la conscience un primat qu’elle n’a pas, car s’il est vrai que l’homme fait l’histoire, il ne sait pas l’histoire qu’il fait.