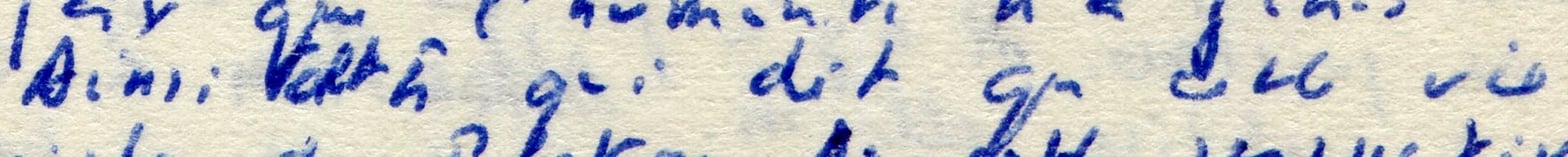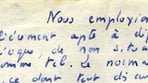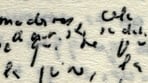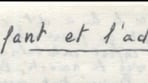Le normal (v2 p7-11)
corrigé en atelier en mars-avril 2025


Il bafouait la théorie alors en vigueur, selon quoi quand un corps brûle, une substance s’échappe de lui sous forme de flamme que l’on appelait le phlogistique. Il aurait dû par conséquent en résulter une diminution de poids de la chaux calcinée. Aussi bien, les auteurs de l’époque s’évertuaient à camoufler le scandale, et en étaient venus à l’explication suivante, modèle de tour de passe-passe verbal : la conclusion à tirer de ce fait, c’est que le phlogistique est doté d’une pesanteur négative. Mais Lavoisier, pour sa part, en dégagea l’idée que brûler pour un corps n’était pas recevoir une déperdition de substance mais fixer de l’oxygène, et il fonda ainsi la chimie. Seulement, si la science s’intéresse à l’anormal, ce n’est pas par goût de l’anormal : un tel intérêt frivole et impur serait bien plutôt la marque du sens commun, pour qui tout est normal, tout va de soi, y compris l’anormal lui-même. C’est pourquoi le sens commun se plait tellement aux tours de prestidigitation, aux tables qui tournent, à toutes les fausses données des fausses sciences. Si le sens commun s’extasie aux étrangetés des fausses sciences qui le séduisent, c’est parce qu’elles ne font appel à l’effort d’aucune compréhension mais qu’elles lui demandent à rebours d’agréer paresseusement l’incompréhensible. Si le sens commun se passionne pour les fausses sciences, c’est par aversion pour la science vraie et l’ascèse intellectuelle qu’elle exige. De là, par exemple, l’esprit de ressentiment qui caractérise une revue comme Planète, si sarcastique à l’égard de la science officielle, si avide d’humilier ce que nous savons au regard de ce que nous ne savons pas. Si la science donc est toujours alertée par l’anormal, ce n’est pas pour détruire le normal, mais pour se former une idée plus rigoureuse de la normalité. De l’expérience de Michelson et de Morley, qui ne mettait en évidence aucun mouvement de la terre, Einstein ne s’avisa quand même pas de conclure que Copernic et Galilée s’étaient trompés. Mais en apparence seulement tout est normal pour la science, comme tout est normal pour le sens commun. Le Tout est normal est pour le sens commun une évidence creuse et subie, pour la science une exigence, et le point de départ d’une rationalisation sans fin. Normal, donc, est, au terme d’une recherche, le résultat d’une opération par quoi ce qui est se trouve rattaché à une structure, à un ordre, à un réseau intelligible de conditions d’existence. N’est normal que ce qui est parfaitement expliqué, en ajoutant que cet ordre, cette structure, ne s’imposent jamais comme tels mais sont le produit des constructions et des initiatives de la raison. Tant il est vrai que nous n’avons que deux façons d’entrer en relation avec l’ordre : ou on s’y soumet, c’est le sens commun, ou on le met, c’est la raison.
Si nous avions par là épuisé la définition du normal, la science suffirait pleinement à l’homme, elle le comblerait, et il n’aurait jamais été tourmenté par un autre souci que celui de connaître ce qui est. Or la science ne satisfait pas entièrement l’homme, et la philosophie, car enfin il faut en venir à elle, en est la preuve irrécusable. Non point parce que la science ne dispenserait à l’homme qu’un savoir incomplet, lacunaire, qui aurait à être complété par la connaissance philosophique. Ce sont les mauvaises philosophies qui s’évertuent à démontrer le fiasco, la faillite de la science, comme on disait à la fin du XIXe siècle, de façon si négligente et désinvolte, puisqu’au même temps de toutes parts, en mathématiques, en physique, en biologie, si les concepts classiques étaient soumis à la crise d’une refonte, c’était pour permettre une rationalité beaucoup plus fine et conquérante ; mauvaises philosophies, puisqu’elles ne comptent pour assurer les succès de la philosophie que sur les échecs de la science, puisque la validité du savoir philosophique demeure en ce cas toujours provisoire, en suspens, étant entendu que plus la science qui a toujours l’avenir pour elle accroîtra son domaine, plus s’amincira celui de la philosophie. Mais ce n’est pas dans les trous de la science que se loge la philosophie. C’est la perfection même de l’entreprise scientifique, non pas ses insuffisances, qui marque ses limites. Quand bien même, en effet, la science serait venue à bout de sa tâche, elle ne contenterait encore pas l’esprit. Ayant rattaché chaque fait à tous les faits, ayant constitué le système total des faits, elle resterait toujours au niveau des faits, c’est-à-dire de la facticité, le pourquoi de tout cela lui serait toujours aussi opaque. Schopenhauer : « Plus les progrès de la physique seront grands, plus vivement ils feront sentir le besoin d’une métaphysique. » Autrement dit, il ne suffit pas à l’homme de connaître, d’expliquer, il lui faut encore comprendre, c’est-à-dire justifier, c’est-à-dire se rendre raison non pas seulement de ce qui est, mais du sens de ce qui est. Telle est bien la singularité de la démarche métaphysique. Il est superficiel, comme le montre Schopenhauer, de caractériser l’investigation philosophique en disant qu’elle est en quête du pourquoi, car la science aussi s’enquiert du pourquoi. Mais ce pourquoi elle le cherche dans l’expérience, tandis que ce qui est en question dans la philosophie c’est le pourquoi même de l’expérience. Aussi là où s’arrêtent les sciences, là commence la philosophie. Aussi le savoir que nous fournit la science n’est d’aucun secours pour le philosophe. Ce savoir élimine tout mystère, or, dit Schopenhauer, plus un homme est inférieur par l’intelligence, moins l’existence a pour lui de mystère. Toute chose lui paraît porter en elle-même l’explication de son pourquoi et de son comment. « Le propre de la philosophie, dit encore Schopenhauer, c’est qu’elle ne suppose rien de connu, mais qu’au contraire tout lui est également étrange(r) et problématique. »
De là que le moteur de la philosophie est bien l’étonnement, à condition de bien distinguer l’étonnement philosophique des autres formes d’étonnement qui ne sont jamais que des surprises, des déconvenues. Le propre du philosophe est de s’étonner là où les autres ne s’étonnent pas. C’est pourquoi il n’est pire fausse profondeur que de comparer comme on ne craint pas souvent de le faire l’étonnement philosophique à la naïveté de l’enfant. Le philosophe, dit-on, est l’homme chez qui les réponses de l’adulte n’ont pas étouffé les questions de l’enfant. Mais, à vrai dire, l’enfant se comporte déjà comme un petit adulte. Quand il agace ses parents, avec ses pourquoi intarissables, c’est simplement que ne disposant pas de critères d’intelligibilité affinés, rien de ce qu’on lui dit ne saurait apaiser un besoin de compréhension qui, faute d’instruments régulateurs, tourne encore à vide. Aussi bien, l’enfant ne veut que savoir, il cherche des causes, et la cause des causes, il n’a aucunement l’idée du métaphysique. L’étonnement de l’enfant est naturel, l’étonnement philosophique n’est pas naturel. L’étonnement philosophique est, lui-même étonnant. Le philosophe en effet ne s’étonne pas d’ignorer, mais au contraire de savoir. C’est ce qui satisfait les autres qui intrigue le philosophe. Que le monde soit compréhensible, voilà précisément, pour reprendre le mot célèbre d’Einstein, qui lui est incompréhensible. Ce qui est surprenant pour le philosophe, ce ne sont pas les faits, mais justement qu’il y ait des faits. Qu’il y ait de l’empirie, voilà qui est métempirique. Ainsi, ce n’est pas l’anormal qui est le gibier de la philosophie, c’est le normal lui-même, c’est le normal même qui apparaît anormal au philosophe. Comment se fait-il que nous puissions penser ce que nous pensons, là est, explicitée par Kant, la véritable question philosophique, là est le problème proprement critique. Cela signifie que ce dont la philosophie doit rendre compte ce n’est pas de l’erreur, c’est de la vérité. Ainsi les cartésiens s’occupaient essentiellement du problème de l’erreur. L’entendement humain étant œuvre de Dieu, c’est l’erreur qui leur apparaissait comme scandaleuse. La vérité, elle, va de soi, chacun en a l’idée. C’est une semence mise en nous par Dieu. Il est absurde, selon Descartes, de s’interroger sur la définition de la vérité, car toute recherche du vrai ne peut que la présupposer. Citons encore Schopenhauer : « Avoir l’esprit philosophique, c’est être capable de s’étonner des évènements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d’étude ce qu’il y a de plus général et de plus ordinaire ; tandis que l’étonnement du savant ne se produit qu’à propos de phénomènes rares et choisis, et que tout son problème se réduit à ramener ce phénomène à un autre plus connu ». Ce qui occupe donc le philosophe n’est pas la connaissance de ceci ou de cela, mais c’est le fait même de la connaissance qu’il tente d’élucider. Tel est le sens de la formule husserlienne : « Ce dont Descartes doute, nous le mettons en question. » Ce qui signifie que la philosophie n’a pas à douter de l’existence des choses, mais à s’interroger pour savoir comment il se fait qu’elles nous sont présentes. Dans la réduction phénoménologique, l’époché, le philosophe s’intéresse non pas à ce qui intéresse les autres hommes, dans l’attitude naturelle, mondaine, c’est-à-dire à tel ou tel objet, mais au fait même qu’il y a des objets. Il ne s’intéresse pas à telle ou telle perception, mais à l’acte même de percevoir. Bref, il s’intéresse à ce qui n’est pas naturellement intéressant. S’intéresser à ce qui n’est pas intéressant, à ce qui ne sollicite en nous aucune tendance, n’est-ce pas la marque même de la liberté ? En ce sens, la philosophie n’a pas à démontrer la liberté de l’homme, son existence même de philosophie constitue à elle seule la preuve de cette liberté. Faire de la philosophie la fille de l’étonnement, c’est évidemment être un disciple de Platon. Les prisonniers de la caverne, dit Lagneau, sont les prisonniers de l’évidence. Dans la caverne, en effet, il y a une science, des arts, des techniques, on y est à l’aise, ce n’est pas un enfer, on y vit bien, tout y est normal, seul le philosophe a le sentiment de l’anormal, seul le philosophe a le sentiment de vivre dans une caverne, ce qui n’est pas une façon de vivre quand on est un homme et un esprit.
L’analogie de la caverne, ne parlons surtout pas selon une expression reçue du mythe de la caverne, la caverne hélas ! n’a rien d’un mythe. Elle ne fait qu’un avec notre énigmatique réalité, l’analogie de la caverne va nous permettre de mieux mettre en forme les relations du normal et de l’anormal.
L’anormal, c’était donc le normal. Ce qui est anormal, c’est de trouver tout normal, d’être, comme dit Jankélévitch, un beau cadavre content d’avoir si bien déjeuné dans une si belle caverne. Ce qui est n’apaise donc pas le philosophe. Aussi philosopher, est-ce sortir de la caverne. Mais celui qui sort de la caverne rompt avec ses habitudes, son confort intellectuel, ses évidences tranquilles. Il prend un risque, il sait ce qu’il a perdu, il ignore ce qu’il trouvera. De là, d’une part, que le philosophe, l’homme qui ne se satisfait pas de notre normalité, passera lui-même pour un anormal. Chaque fois, dans le Théétète, la République, que Platon fait le portrait du philosophe, c’est un tableau terrible qu’il dessine. Le philosophe n’est pas de plain-pied avec le réel, il n’est pas dans la société comme un poisson dans l’eau, il ne se soucie guère de ce qui occupe les autres, il ne sait pas ajuster sa tunique, dans une conversation, c’est un lourdaud, il est toujours en retard d’une réplique. Bref, il vit mal. C’est vivre mal que de réfléchir sur la vie, de mettre en cause la vie, de ne plus s’en remettre aux puissantes évidences vitales, de contester cette normalité. Le philosophe est donc bien l’animal malade, comme dit Rousseau, l’être dénaturé, comme dit Hegel, la philosophie, c’est bien l’inquiétude, le ver dans le fruit, la vie qui se scinde de soi, qui ne coïncide plus avec elle-même, c’est-à-dire la négativité. « La conscience, dit Hegel, est donc immédiatement (philosopher, en effet, c’est prendre conscience), l’acte d’outrepasser le limité (philosopher, c’est sortir des limites du normal, de cette limite plutôt qu’est le normal)… La conscience subit donc cette violence venant d’elle -même, violence par laquelle elle se gâte toute satisfaction limitée. Dans le sentiment de cette violence, l’angoisse peut bien reculer devant la vérité, aspirer et tendre à conserver cela même dont la perte menace, mais cette angoisse ne peut s’apaiser : en vain elle veut se fixer dans une inertie sans pensée. » « Toute conscience est donc, dit Merleau-Ponty, commentant Hegel, malheureuse, puisqu’elle se sait vie seconde et regrette l’innocence dont elle se sent issue. Mais la vie n’est pensable que comme offerte à une conscience de la vie qui la nie. C’est pourquoi l’idée de l’homme sain est un mythe, proche parent des mythes nazis. » « Pour qu’il y ait conscience de la vie, il faut qu’il y ait rupture avec cette dispersion, il faut qu’elle se totalise et s’aperçoive, et cela par principe est impossible à la vie elle-même. Il faut que vienne au monde une absence d’être d’où l’être sera visible comme un néant. De sorte que la conscience de la vie est radicalement conscience de la mort. » Pour reprendre les termes de notre débat, nous dirions de notre côté que pour qu’il y ait conscience du normal, il faut décoller de cette normalité, s’absenter d’elle, et la saisir donc d’abord comme de l’anormal. » Mais dans ce monde où chacun est si bien, le philosophe ne passe pas du dehors seulement, c’est-à-dire aux yeux des autres, pour un anormal, puisqu’il a quitté la terre ferme du normal, où tout va de soi, puisqu’il ne peut plus s’appuyer sur les normes mêmes que toute pensée spontanément implique, puisqu’il a à inventer d’autres normes, sa démarche même ne peut suivre aucun chemin familier, il lui faut inventer sa propre route, et c’est pourquoi, comme le dit Platon, il est ébloui, au sortir de la caverne, l’éclat même du vrai l’aveugle, il n’a qu’une envie, c’est de rebrousser chemin. « [Mais comme] un homme, dit également Descartes dans le Discours, qui marche seul et dans les ténèbres ». L’homme qui s’est dépris du raisonnable, du familier, du bien connu, n’a plus la faculté de s’en remettre aux ressources faciles de cette normalité, de ce sens commun dont il vient de s’exiler. Il a quitté le raisonnable, il doit inventer, construire le rationnel. Voilà pourquoi il ne peut s’appuyer sur les idées, sur le langage même de tout le monde.
Kant, à la fin des Prolégomènes, souligne bien cette difficulté, quand il déclare : « On ne peut donc user du sens commun que dans la mesure où il peut voir ses règles confirmées par l’expérience (quoiqu’il les possède véritablement a priori) ; comprendre donc ces règles a priori et indépendamment de l’expérience relève de l’entendement spéculatif et dépasse ainsi tout à fait l’horizon du sens commun. Mais la métaphysique n’a pour objet que cette dernière espèce de connaissance et c’est assurément un mauvais signe de bon sens que de se réclamer d’un garant qui n’a point à juger ici et que d’ordinaire on regarde par-dessus l’épaule, sauf, ajoute Kant ironiquement, quand on est dans l’embarras et qu’on ne sait comment se tirer d’affaire dans sa spéculation. » Voilà pourquoi le philosophe, désireux d’une certitude absolue, qui résiste à tout doute, même le plus léger, à tout soupçon, même le plus ténu, est tenu de ne pas se confier au probable, même s’il est infiniment probable. Aussi lui arrive-t-il de douter de ce dont personne ne doute, de l’existence du monde extérieur par exemple, de la réalité d’autrui, ce qui assurément est considéré par les habitants de la caverne comme le summum de l’extravagance. N’est-ce point le fait d’un malade mental, d’un schizophrène que de remettre en question l’existence des choses ? Le métaphysicien perdu dans son solipsisme ne ressemblerait-il pas à ces psychasthéniques étudiés par Janet à qui fait défaut la fonction du réel ? Il n’en est rien, car le philosophe, en tant qu’homme, croit comme un autre à la réalité de ce qui l’entoure, seulement il se refuse à confondre avec une certitude logique une croyance psychologique même irrésistible. Rappelons-nous ce que nous dit Descartes, dans le Discours, évoquant semblable question : « Car encore qu’on ait une assurance morale de ces choses, qui est telle qu’il semble qu’à moins que d’être extravagant on n’en peut douter, toutefois aussi, à moins que d’être déraisonnable, lorsqu’il est question d’une certitude métaphysique, on ne peut nier que ce ne soit assez de sujet, pour n’en être pas entièrement assuré, que d’avoir pris garde qu’on peut en même façon s’imaginer, étant endormi, qu’on a un autre corps et qu’on voit d’autres astres et une autre terre, sans qu’il en soit rien. » Le doute de Descartes n’est donc pas le fait d’un esprit vacillant et chancelant, c’est un doute volontaire, c’est-à-dire que Descartes s’oblige, se force à douter. Pour confirmer la validité de la pensée, Descartes n’essaie pas, dans une fausse sécurité, de la mettre à l’abri de toute suspicion, il la confronte, au contraire, aux hypothèses les plus étranges, il forge la fiction d’un malin génie tout employé à nous tromper, il émet l’hypothèse que notre esprit pourrait être tel que, vicié, il prenne toujours le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. « Et même, comme je juge quelquefois que les autres se méprennent, même dans les choses qu’ils pensent savoir avec le plus de certitude, il se peut faire qu’il ait voulu que je me trompe, toutes les fois que je fais l’addition de deux et de trois, ou que je nombre les côtés d’un carré, ou que je juge de quelque chose encore plus facile, si l’on se peut imaginer rien de plus facile que cela. » Le philosophe de la sorte pour assurer les triomphes de l’esprit ne craint pas de se placer en pleine détresse intellectuelle, il affronte lui-même la folie pour en sortir définitivement vainqueur, il conduit le sens commun dans la nuit de la démence pour retrouver la lumière d’un sens enfin devenu bon. Mais ce risque délibéré, cette épreuve de l’anormal, le philosophe ne se les inflige que parce qu’il a en vue une normalité enfin claire à soi-même. Et c’est à présent le vrai sens du mot normal qui doit être récupéré. Si normal veut dire ce qui est conforme à une norme, la norme n’est pas – l’approximation : une moyenne, elle n’est pas non plus simplement un ordre de fait, elle est une valeur. Ce qui est normal, c’est ce qui est fondé, ce qui tire son être d’une valeur, ce qui répond à une exigence. Voilà la raison pour laquelle Platon voit dans l’idée du Bien la source même de toutes nos idées. Nous n’aurions aucune idée, si nous n’avions l’idée du Bien. Elle est, dit Platon, supérieure à l’être en dignité et en puissance. Il n’y pas de pensée, si elle n’essaie de justifier ce qu’elle pense, si elle n’essaie de se justifier elle-même. Attention à ceci que l’idée du Bien, en Platon, n’invite à aucun moralisme. Elle n’invite pas à croire que tout doit être justifié par la morale, mais que tout doit être justifié, y compris la morale. Platon ne se serait donc pas satisfait d’une science comme la nôtre qui se borne à dire ce que sont les choses, mais elle les enchaîne à une nécessité de fait. Dans son article sur la métaphysique, Lagneau écrit : « Ce que sont les choses ou plutôt ce qu’elles ont l’air d’être, dans leur devenir extérieur, c’est affaire au physicien de le chercher ; Platon ne s’en soucie pas. Il dédaigne cette science où l’esprit n’apprend pas ce qui l’intéresse, le rapport des êtres, ou plutôt des idées, avec lui-même, avec son principe, le bien, c’est-à-dire leur explication, leur réalité vraie, leur valeur. Car les choses ont deux sortes d’existence, l’une sensible, c’est-à-dire obscure, opaque, impénétrable, sur laquelle la pensée est sans prise, l’autre intelligible, qui ne consiste pas dans ce qu’elles sont, mais dans ce qu’elles valent, c’est-à-dire dans ce qu’elles sont pour l’esprit. » Le philosophe n’aura le sentiment de vivre dans un monde normal, puisqu’alors, comme dit Rimbaud, ce platonicien, la vraie vie sera absente, que lorsque ce qui est aura été reconnu conforme à ce qui doit être. Philosopher, c’est sortir de la caverne, c’est aussi y revenir. Le monde, en effet, qu’il me faut penser est le monde où je vis. La philosophie serait en effet démentielle si elle s’expatriait de cet univers pour s’établir dans un monde imaginaire. Il n’y a pas, chez Platon, de monde intelligible, d’univers des pures idées. Toute la réalité de l’idée est de donner réalité aux choses. Les idées, chez Platon, ne sont pas réalisées, elles sont réalisantes. L’illusion serait de croire que l’on peut changer de vie, l’exigence est de comprendre, pour citer encore Rimbaud, qu’il faut changer la vie. Être normal ne revient donc pas à s’accepter, mais à se construire. Il n’y a pas, c’est le sens de l’analogie de la caverne, d’autre vie, mais c’est de cette vie même que je dois faire une autre vie, comme c’est de ce monde que je dois faire un autre monde. Tout le platonisme est pour nous montrer que le philosophe, ce rêveur, ce fou, voilà précisément l’homme qui a le sens de la réalité. Qui prend les choses comme elles sont vit dans une sorte de songe éveillé. La réalité n’est jamais ce dans quoi nous sommes, c’est dans le rêve qu’on est de plain-pied avec ce que l’on rêve, on y est englouti, la réalité, c’est toujours ce de quoi l’on se dégage. Il n’y a de réalité que pour qui la domine. Il n’y a de réalité que pour qui ne consent pas à ce qu’elle ne soit que ce qu’elle est. Si le réel est ce qui résiste, pour qu’il résiste, encore faut-il qu’on s’applique à l’ébranler. Il n’ya donc de réalité que pour qui fait l’effort de la transformer. L’objet, disons encore, ne prend forme que par rapport à un projet, et le réel n’est rien d’autre qu’une réalisation. C’est pourquoi, si l’homme ne se formait pas des idées, s’il ne se faisait pas, comme on dit dédaigneusement, des idées, il ne serait même pas pour lui de choses, car qu’est-ce qui peut bien être réalisé, sinon justement une idée ? La fonction du réel dont parlent les psychologues, son nom est volonté. Si tout paraît étrange, irréel au psychasthénique, si le plus familier lui semble déconcertant, c’est parce qu’il a perdu le sens même de l’effort. Et ce qui est vrai de nos relations avec les choses est vrai également de notre relation avec cette chose qui est nous-même. S’accepter, c’est se nier. L’homme qui dit : ça m’est égal, l’homme qui ne fait pas de différences dans ce qu’il fait devient tout à fait indifférent à lui-même. Il s’absente de soi. Nous n’avons qu’une façon d’être nous-même, qui est de ne jamais nous identifier à nous-même. Être soi, pour l’homme, signifie être au-dessus de soi. Ne pas coïncider avec ce que l’on est, n’est-ce pas la définition même de la liberté ? L’homme normal, celui qui fait de soi une exigence, c’est tout simplement l’homme libre.
Pas de réalité pour l’homme, si elle n’est rattachée à quelque valeur. Au niveau le plus bas le normal était déjà imprégné de valeurs. Ainsi les choses pour l’homme normal ne sont jamais de simples choses, des il y a, mais elles renvoient à un sens humain, ce sont des symboles. Ainsi tel monument n’est pas un bloc de pierre, mais il rappelle un passé, il évoque la continuité humaine, la présence des morts parmi les vivants, ainsi un coucher de soleil n’est pas simplement un certain mélange et une certaine intensité de couleur, mais il signifie toute une paix, toute une harmonie, tout un bonheur. Voilà pourquoi, parce qu’il est le seul animal à être normal, l’homme est le seul aussi à pouvoir devenir fou. « On peut, nous rappelle un psychologue, Ruyer, constater, ou provoquer chez les animaux des états pathologiques, psycho-physiologiques, analogues aux états correspondants dans la folie humaine. On peut provoquer des névroses ou des catatonies expérimentales sur les chiens, les chats ou les singes. Les psycho-chimistes essaient sur les animaux les substances à action neuro-psychologique : tranquillisantes, agitantes, hallucinantes. Ils peuvent faire tisser par des araignées traitées par mescaline des toiles aberrantes. Mais l’animal ne subit jamais qu’un état organique. Il n’a pas de super-structure symbolique, où le trouble organique puisse retentir ou se projeter. » Lecture de Ruyer : p 224.
Seulement, s’il est exact que la folie consiste à ne plus trouver sens aux symboles collectifs, il est une autre forme d’anormalité, une autre folie qui nous guette, moins voyante, aussi redoutable sans doute, qui consiste à trop trouver de sens à ce qui est. Il n’est pas normal, nous rappelle le philosophe, de voir partout du normal. Aussi le philosophe qui pour être davantage présent aux autres ne pensera pas comme eux est-il toujours mal vu, taxé de folie par tous ceux qui logent dans une parfaite adaptation aux normes réalisées par la cité l’unique idéal humain. Pour être normal, il ne suffit pas d’obéir à des normes, il ne suffit même pas de juger le réel par la référence à des normes, il faut encore juger ces normes elles-mêmes, ne pas se contenter de l’idée que l’on se fait de la valeur. Un homme, comme une civilisation meurent dès lors qu’ils ne sont plus capables de se fixer des tâches nouvelles.
La normalité/mortalité, c’est la normativité. Qui ne soumet plus à la critique ses propres idéaux perd le sens même de l’idéal. L’idéal, c’est de ne jamais rien tenir pour idéal. Ainsi il entre dans l’exigence même de l’idée de justice que nous ne <nous> reposions jamais sur les concepts que nous pouvons concevoir de la justice. La vraie valeur signifie, Nietzsche nous l’a appris : tout cela encore ne vaut rien. Avoir le sens de la norme, c’est critiquer ce qui est, non point le vénérer. Pour le sens commun tout est normal, la guerre, la douleur, l’injustice. La vie, que voulez-vous, c’est la vie. Et à la guerre comme à la guerre. Telle est l’inertie de la fausse normalité, dont les jugements sentencieux prennent toujours la forme d’une tautologie. Pour l’homme normal, ce n’est pas la guerre qui est normale, mais la paix, cette paix que l’humanité n’a jamais encore connue, ce n’est pas la douleur, c’est la joie.
Ainsi tout homme qui dit que cette vie n’est pas une vie est à sa manière un lointain disciple de Platon. Dans cette perspective, le vrai représentant de la normalité philosophique n’est pas Hegel qui s’évertue à justifier tout ce qui est, se prosternant devant l’ordre du monde et ne voyant de valeur que dans l’unique réalité, mais Marx qui nous montre au contraire que notre histoire n’est qu’une fausse histoire, une histoire entravée, aliénée, parce que nous ne la faisons qu’en la subissant. Mais ici le naturalisme marxiste se dépasse lui-même, car c’est bien au nom d’une idée de l’homme, dont nul scientisme ne pourra rendre compte, que le marxisme est en droit de juger inhumaine l’histoire qui est notre lot. Si donc il est exact qu’il n’y a pas de nature humaine, si la norme n’est pas un modèle, un archétype, qu’est-ce que l’homme, nul ne le sait, et l’homme n’est homme que s’il s’interroge sur lui, et de même est foncièrement injuste celui qui croit savoir ce qu’est la justice, il n’en reste pas moins qu’il y a bien quelque chose de commun à tous les hommes, quelque chose qui les rend normaux, et c’est la volonté de ne jamais borner leur être à ce qu’ils sont. L’homme a pour essence de ne pas se limiter à une essence. Ce qu’est l’humain, l’homme l’ignore, mais il sait ce qu’est l’inhumain, tout ce qui bride l’homme. Notre normalité, ce sont nos aspirations. Un homme n’est donc pas normal s’il n’y a pas en lui plus <que> ce qu’il est. Qu’il y a en l’homme plus que l’homme, n’est-ce pas ce que nous révèle, poète, romancier, ou philosophe, celui que nous appelons le génie. Mais il nous révèle aussi que ce par quoi nous nous élevons au-dessus de notre réalité fait déjà partie de notre réalité. L’écrivain de génie n’invente pas des hommes qui n’auraient aucun rapport avec les hommes réels. Auquel cas il ne fabriquerait que de l’anormal. Il ne fabrique pas non plus des êtres faussement idéalisés, car rien ne sonnerait plus faux, et rien finalement ne discrédite plus l’idéal que la littérature dite édifiante. « Quant à vouloir, dit Kant (in RP), réaliser l’idéal dans un exemple, c’est-à-dire dans le phénomène, comme en quelque sorte le sage dans un roman, cela demeure impraticable et cela semble peu sensé et peu édifiant en soi (rien n’est plus crispant que la petite fille modèle), parce les bornes naturelles battant continuellement en brèche la perfection existant dans l’idée, rendent impossible toute illusion dans une telle tentative, et, par là, nous conduisent même à suspecter le bien qui est dans l’idée et à le regarder comme une simple fiction. »
L’écrivain de génie nous prend tels que nous sommes et pourtant ce qu’il nous dit de nous jamais nous ne l’avions entendu. Voilà pourquoi le génie nous révèle à nous-mêmes. Voilà pourquoi il est comme tout le monde, mais d’une façon inimitable. Voilà pourquoi l’homme de génie est à la fois si loin et si proche de nous. « Le génie, dit Balzac, a cela de bon qu’il ressemble à tout le monde et que personne ne lui ressemble. » Ce qu’il nous apprend, il nous semble que nous aurions dû <le> savoir depuis toujours. Ainsi il éveille un écho en nous. Ce qu’il nous apprend, c’est qu’il n’y a rien de plus simple que d’être un homme, et rien de plus mystérieux. C’est en quoi tout génie est révélateur, toute révélation est géniale. Révéler, c’est un terme religieux, c’est montrer que ce qui est est bien davantage que ce qu’il est, c’est en tout être dévoiler un surplus d’être. La révélation ne change pas, elle illumine, elle n’est pas métaphore, mais métamorphose. Être normal pour un homme, il n’est donc rien de plus profond. Être un homme normal, cet être qui est tout et qui n’est rien, toujours en débat avec soi, portant, roulant son bien et son mal, de toutes ses contradictions faisant son unité vivante, toujours en deçà et en même temps au-delà de lui-même, jamais neutre, jamais moyen, là est bien le génie humain. Pour la philosophie clairvoyante, l’homme de génie, c’est l’homme tout court.