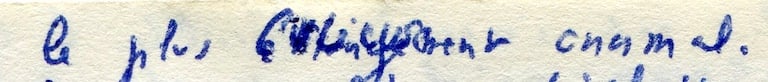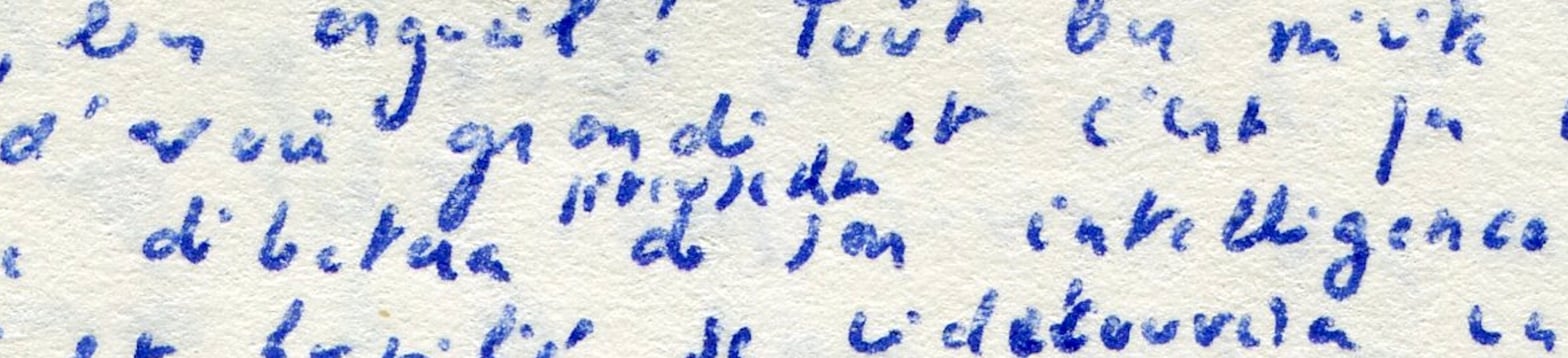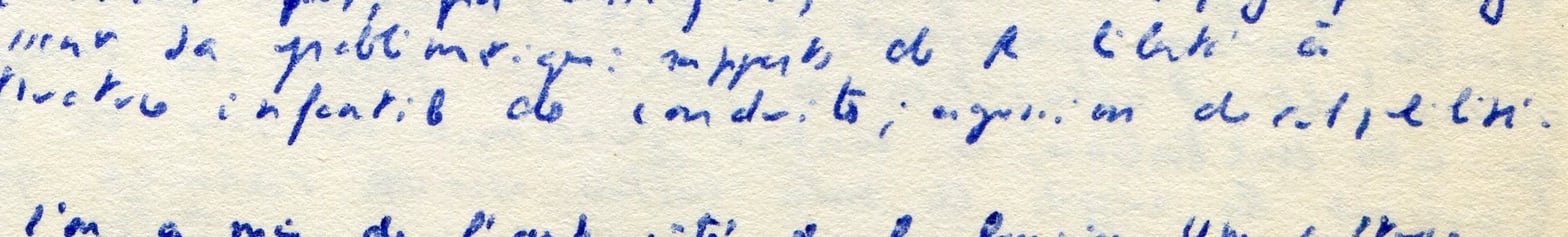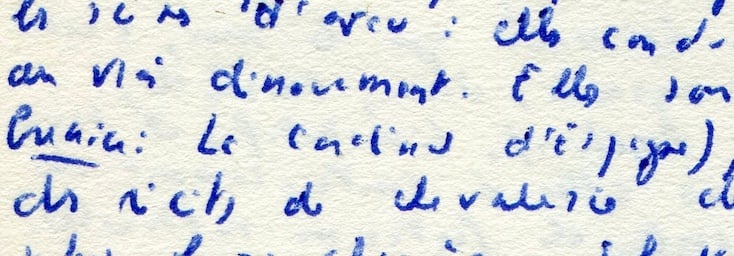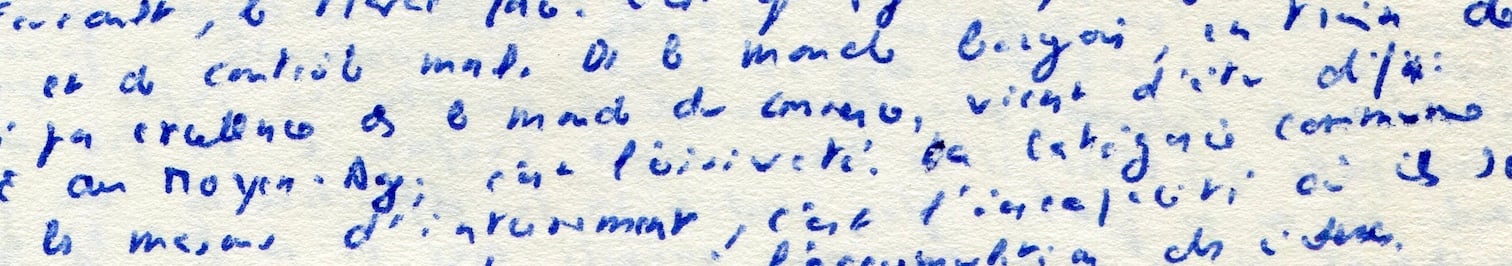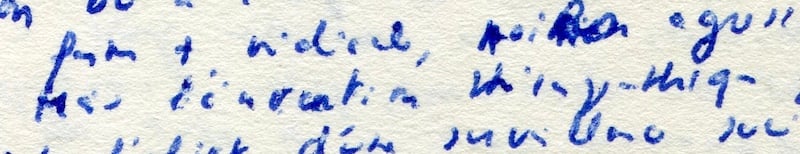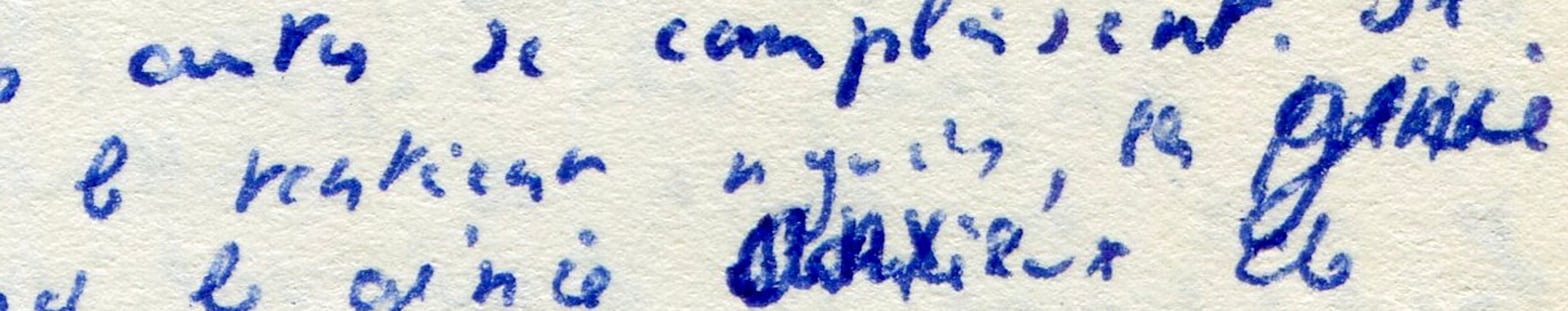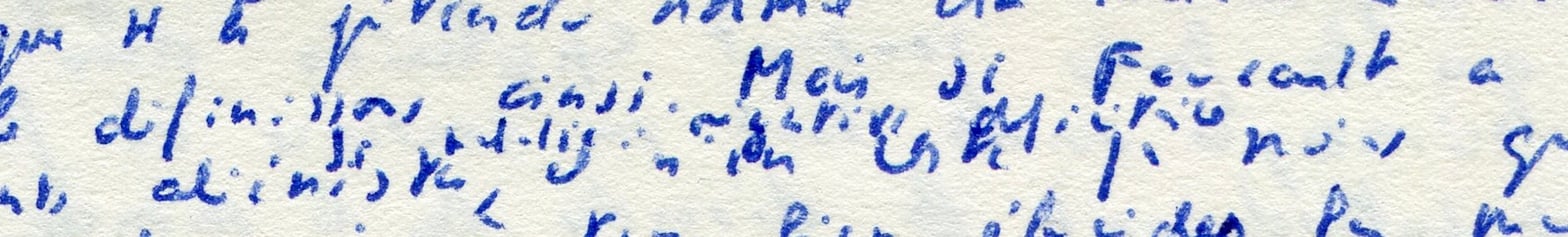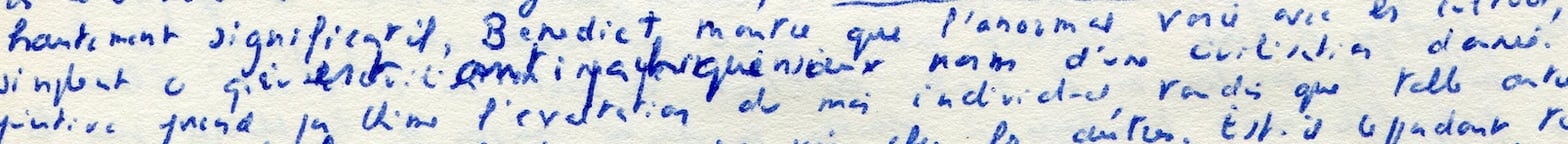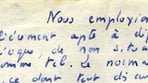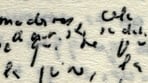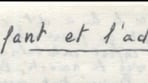Le normal v2 p. 4, 5, 6
"Le normal" (version 2, pages 4, 5, 6) vérifié en atelier le 6 mars 2025


Mais ne nous y trompons pas : cette curiosité, comme toute curiosité, va en sens inverse de la compréhension. Une culture, trop à l’étroit en elle-même, éprouve le besoin de s’aérer en s’ouvrant délicieusement à ce qui n’est pas elle. L’anormal reçoit alors les traits de l’insolite, du bizarre, il flatte les nostalgies d’une culture en mal d’étouffement. Le civilisé se fait ethnologue, il voyage, mais il emporte dans ses bagages sa supériorité et sa condescendance. L’exotique le charme, mais comme on est séduit par une tentation, l’anormal ne passe tout au plus que pour le piquant, l’amusant. De la même manière que l’enfant, cet autre autre, pour la psychologie classique rien n’étant plus anormal que l’enfance, et éduquer signifiant hâter, accélérer une croissance intellectuelle, inviter l’enfant à se débarrasser le plus vite possible de son étrangeté et de ses différences, de la même manière donc que l’enfant sollicite aussi la curiosité de l’adulte, fier sans doute de ne plus être un enfant, n’est-il pas vrai que beaucoup d’adultes limitent là, à peu de frais, leur orgueil ? Tout leur mérite ils le tirent d’avoir fait ce qu’ils n’ont eu aucun mérite à faire, c’est à dire d’avoir grandi, et c’est par rapport à l’unique enfant qu’ils exercent leur supériorité : ainsi un professeur se délectera [piteusement]
de son intelligence par le seul spectacle réconfortant de la bêtise de ses élèves, ainsi tel subordonné aigri et humilié se redécouvrira une puissance en rentrant chez lui et en distribuant des taloches, mais heureux de ne plus être un enfant l’adulte a néanmoins le vague sentiment d’avoir perdu quelque chose, il se trouve devant l’enfance comme en face d’un monde où il ne pénètrera plus, un monde où on ne pénètrera plus, n’est-ce pas la définition même du paradis ? alors l’adulte essaie gauchement de se mêler aux jeux puérils, mais il ne fait toujours que se pencher sur l’enfant qu’aux meilleurs moments il ne considère guère, comme le civilisé le primitif, que comme un charmant petit être déconcertant. Au demeurant, poser l’exotique comme exotique suffit d’avance à en désamorcer les maléfices. L’anormal dont on se plait à la vision ne se découvre que derrière des barreaux, un peu comme des indiens que l’on parque dans des réserves. Et ces musées anthropologiques où une civilisation entasse les insolites productions des arts et des techniques anormales ressemblent bien eux-mêmes à des sortes de zoos culturels. Cette opération donc, par quoi le normal s’affirme comme normal en délimitant de l’anormal, pour lui donner son vrai nom, cette opération de la raison ne s’apparenterait -elle pas de fort près à une opération de police ? La police a bien pour rôle d’encercler, d’enfermer, de mettre à l’abri. Car dans le dedans aussi il y a du dehors, un dehors qu’il faut soigneusement mettre à l’écart, pour éviter toute contagion, toute contamination, un dehors que l’on met dans le dedans en résidence surveillée. Comme il est un ministère de l’extérieur qui s’occupe des affaires étrangères, il est un ministère de l’intérieur auquel est confiée la charge des affaires étranges. Du soupçon à l’accusation, il n’y a qu’un pas, et l’anormal sera traité comme du coupable. Ce n’est pas un hasard si rien ne ressemble plus à une prison qu’un asile, et si une raison qui se referme ne sait faire autre chose qu’enfermer. De là cet aspect répressif, intimidant, justicier qu’en toute bonne conscience s’est donnée la psychiatrie. Le malade mental est pour elle un taré, quelqu’un qui s’est écarté du droit chemin. Les fous, ce ne seraient donc que des méchants. Comme l’écrit un philosophe de la psycho-pathologie, Michel Foucault : « Dans le nouveau monde asilaire, dans ce monde de la morale qui châtie, la folie est devenue un fait qui concerne essentiellement l’âme humaine, sa culpabilité et sa liberté ; elle s’inscrit désormais dans la dimension de l’intériorité. » Elle est enclose dans un système punitif où le fou, minorisé, se trouve apparenté de plein droit à l’enfant, et où la folie, culpabilisée, se trouve originairement reliée à la faute. Ne nous étonnons pas, par conséquent, si toute la psychopathologie est commandée par ces trois thèmes qui définissent sa problématique : rapports de la liberté à l’automatisme ; phénomènes de régression et structure infantile des conduites ; agression ou/de culpabilité.
Ce que l’on découvre à titre de psychologie de la folie n’est que le résultat des opérations par lesquelles on l’a investie. Toute cette psychologie n’existerait pas sans le sadisme moralisateur dans lequel la philanthropie du XIXe siècle l’a enclose, sous les espèces hypocrites d’une libération » (?). Foucault s’est proposé en effet de montrer que la définition de la folie comme folie s’est faite à une date récente de l’histoire culturelle, la folie est historique, dit-il, elle est neuve aussi, précisément aux alentours du XVIIe siècle. Jusque-là, contrairement à une opinion reçue, le fou avait droit de cité socialement comme intellectuellement. Il n’était nullement traité comme un réprouvé ou un possédé. « À la danse macabre figurée au cimetière des innocents, au Triomphe de la mort chanté sur les murs du Campo Santo de Pise, font suite les innombrables danses et fêtes des Fous que l’Europe célèbrera si volontiers tout au long de la Renaissance. Il y a les réjouissances populaires autour des spectacles donnés par les « associations de fous » comme le Navire Bleu, en Flandre ; il y a toute une iconographie qui va de La Nef des fous de Bosch, à Bruegel et à Margot la Folle ; il y a aussi les textes savants, les ouvrages de philosophie ou de critique morale, comme la Stultifera Navis de Brant ou l’Éloge de la folie d’Érasme. Il y aura, enfin, toute la littérature de la folie : les scènes de démence dans le théâtre élisabéthain et dans le théâtre français préclassique font partie de l’architecture dramatique, comme les songes et un peu plus tard les scènes d’aveu : elles conduisent le drame de l’illusion à la vérité, de la fausse solution au vrai dénouement.
Elles sont un des ressorts essentiels de ce théâtre baroque (cf. Montherlant [XXX] Le Cardinal d’Espagne), comme des romans qui lui sont contemporains : les grandes aventures des récits de chevalerie deviennent volontiers les extravagances d’esprits qui ne maîtrisent plus leurs chimères. Shakespeare et Cervantès à la fin de la Renaissance témoignent des grands prestiges de cette folie dont Brant et Jérôme Bosch, cent ans plus tôt, avaient annoncé le prochain règne. C’est vers le milieu du XVIIe que tout se met à changer. La Raison classique ne veut plus reconnaître les pouvoirs, les lumières troubles et puissantes de la folie, l’insensé ne lui apparaît plus comme surcroît et excès de sens. La Raison de la Renaissance était sage qui se mettait à l’écoute de la folie et en tirait une puissance, une inquiétude. La folie obligeait alors la Raison à procéder à son examen de conscience. Celui qui se croit sage, pouvait-on se demander, n’est-il pas plus fou que le fou ? Qui se croit droit ne délire-t-il pas ? Qui croit savoir n’est-il pas victime de la pire ignorance ? La folie était cette ombre qui permettait à la raison de se dédoubler et de considérer la trace de ses propres aliénations. La folie offrait à la raison le spectacle de ce monde de ténèbres qui était comme la rançon de sa propre lumière. Mais au XVIIe siècle, une raison arrogante, sûre de soi, dévalorise la folie. Elle n’est plus que déficit, faute, maladie mentale. Elle n’en appelle plus à une interrogation, mais à un simple diagnostic. C’est alors que l’on crée de vastes maisons d’internement qui, comme l’observe Foucault, ne sont pas simplement destinées à recevoir les fous, on y enferme pêle-mêle les pauvres invalides, les vieillards dans la misère, les mendiants, les chômeurs opiniâtres, des libertins de toutes sortes, des pères de famille dissipateurs, des ecclésiastiques en rupture de ban, bref tous ceux qui, par rapport à l’ordre de la raison, de la morale et de la société, donnent des signes de « dérangement ». Tout ce qui est dérangeant, autrement dit, va être, par un choc en retour, taxé de dérangé. Sont mis à l’asile tous ceux que la Société n’assimile plus. Dans ces prisons, va régner, note encore Foucault, le travail forcé. C’est que, je cite, l’obligation du travail a aussi un rôle de sanctions et de contrôle moral. Dans le monde bourgeois, en train de se constituer, un vice majeur, le péché par excellence dans le monde du commerce, vient d’être défini :
ce n’est plus l’orgueil ni l’avidité comme au Moyen Age ; c’est l’oisiveté. La catégorie commune qui groupe tous ceux qui résident dans les maisons d’internement, c’est l’incapacité où ils se trouvent de prendre part à la production, à la circulation ou à l’accumulation des richesses. Bien sûr, au XVIIIe siècle, l’internement va revêtir une forme plus médicale, moins agressive. L’hôpital va se rendre, par les soins de Pinel, plus hospitalier.
Mais l’intention thérapeutique se rapprochera de plus en plus d’un contrôle éthique. Le fou est l’objet d’une surveillance sociale et morale ininterrompue. Les techniques de traitement sont d’allure répressive. La douche n’est pas faite pour rafraîchir, mais pour punir. Devant cette erreur qu’est le malade, le médecin, investi de tous les pouvoirs et les dignités du normal, se présente comme le regard terrible de la vérité. Et la moderne psychanalyse elle-même risque toujours, quand elle ne veille pas à sa propre critique, de perpétuer de tels abus de pouvoir, dès lors qu’elle donnerait au malade le sentiment traumatisant qu’il est en train de confesser et de mimer ses errances devant un médecin à la stature de sorcier qui détient par devers lui la clef de toutes les énigmes.
Un tel traitement de l’anormal – traitement à tous les sens du terme – ne saurait lui-même passer pour normal. Et l’on peut se demander si telle ou telle culture primitive qui assigne au fou une place positive dans la cité, ainsi il tiendra l’emploi de devin, de mage, de sorcier ou d’amuseur, n’est pas plus chargée d’humanité que nos pratiques actuelles qui ne tiennent l’anormal que pour du morbide et retranche, élimine, fait disparaître la folie, comme un remords que l’on ne veut pas regarder en face. La pire aliénation ne serait en ce cas pas là où l’on pense. Une société est elle-même aliénée qui ne sait plus tenir ceux qu’elle n’assimile pas ou ne comprend pas que comme des aliénés. L’anormal n’était donc pas l’autre, mais l’idée même que l’autre est anormal. L’on n’a plus le choix alors qu’à considérer l’autre comme de l’insensé ou, sur le mode mineur, de l’insignifiant. C’est ce double et ambigu visage que pendant longtemps on a posé comme un masque sur le fou. Ou bien la folie est délire horrible, non-sens provoquant, ou bien, s’il est vrai que tout est fou dans la folie, elle n’est plus qu’un phénomène oiseux dont l’occupation ne ferait que perdre son temps à la raison. On remarquera au passage que cette ambivalence, ce constant glissement de sens de l’insensé à l’insignifiant caractérise également les rapports de notre culture avec une technique qu’elle n’a pas su intégrer, et cette aliénation qui est la nôtre en présence de nos machines. Tantôt, en effet, un certain humanisme peureux et perfide dénonce les périls du machinisme qui plongerait notre univers en pleine démence, c’est la machine comme inquiétante, terrible, tantôt il déclare que la technique ne constitue qu’un ensemble de moyens qui n’inclinent par eux-mêmes vers aucune fin, qui en tant que tels restent neutres, oiseux, dépourvus de toute portée propre, bref non plus du monstrueux, mais de l’inerte. Mais seul ce qui aliène est aussi capable de désaliéner. Si l’aliénation est le mal de la différence, la désaliénation consistera dans la consécration de la différence comme bien. Davantage, c’est le respect de la différence de l’autre qui introduit à l’élucidation de soi. Je ne suis un je que dans la mesure où je comprends les autres et où je me comprends par les autres. De ce point de vue, au travers de tant de tâtonnements, c’est le plus grand bénéfice des sciences de l’homme d’aujourd’hui que de s’être tournées à la lumière de l’autre. Ce n’est pas un hasard si la sociologie a progressé par le détour de l’ethnologie, si le civilisé, interrompant son long monologue, a, pour éclairer la structure plurivalente du fait social, confronté ses normes avec celles de la mentalité primitive. Ce n’est pas un hasard si l’étude de cet autre qu’est l’enfant a permis à la psychanalyse de mieux comprendre l’obscur destin de l’adulte, et c’est par un sûr instinct que dès sa constitution comme science, la psychologie a interrogé le pathologique. Les principaux ouvrages de l’introduction en France de la nouvelle psychologie, Ribot, ne s’intitulent-ils pas : 1881 : Maladies de la mémoire, 1883, Maladies de la volonté, 1885, Maladies de la personnalité. En 1904 Janet et Dumas fondant leur revue de psychologie l’intitulent « Journal de psychologie normale et pathologique ». C’est bien le pathologique en effet qui renseigne toujours sur le normal. Comme le rappelle encore Foucault : « C’est une analyse des dédoublements qui a autorisé une psychologie de la personnalité ; une analyse des automatismes et de l’inconscient qui a fondé une psychologie de la conscience ; une analyse des déficits qui a déclenché une psychologie de l’intelligence ; une analyse de l’oubli qui a introduit à une psychologie de la mémoire ». Et loin de prendre toute anormalité pour une erreur, nous sommes de plus en plus portés à estimer qu’elle contribue dans certains cas à une vision plus aiguë de la vérité. Nous ne souscririons pas à ce mot de Le Senne, selon quoi pour être philosophe, il faut être intellectuellement aussi bien portant que possible. Nous n’oublions pas qu’un Lucrèce, un Pascal, un Nietzsche, un Dostoievsky ont été, comme on a pu l’écrire, de ces malades flamboyants qui renversent la marche tranquille du progrès intellectuel. Ils n’ont pas réfléchi malgré leur anormalité, ni grâce non plus à elle mais la nuit même de leur disgrâce les a conduits à faire l’effort de découvrir une lumière plus perçante que le demi-jour où les autres se complaisent. Il ne viendrait plus à l’esprit de personne de sérieux de réduire, comme certains le tentèrent naguère, le génie à la folie, mais il est permis de voir dans la folie le risque même que prend le génie anxieux de dépasser nos fausses prudences et nos fausses sécurités.
Il est vrai que le sens commun, déboussolé par le spectacle de la différence et de la variété des cultures, pourra réagir, dans un réflexe de panique, dans un lâcher-tout généralisé, en cherchant refuge dans un relativisme total. S’il n’y a pas une culture, mais des cultures, avec leurs catégories et leurs cadres propres, si ce qui est anormal pour l’un est normal pour l’autre, loin d’éclaircir le normal la découverte de l’anormal ne contribuera qu’à sa dissolution conceptionnelle, dans un univers mental désormais désorienté. La psychologie court ce risque. Ou bien elle tient que les lois du pathologique ne sont pas les mêmes que celles du normal, et elle se condamne à rendre l’anormal incompréhensible, ou bien elle détruit les barrières qui les séparent, mais en ce cas on se prive de tout critère assurant de caractériser ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, on pourra dès lors estimer ou bien que tout homme prétendu normal est malade à sa façon, ou bien que le fou n’est tel que par ce que nous le définissons ainsi. Mais si Foucault a raison de protester contre l’humiliation de trop de traitements aliénistes [Toute/Si maladie : négative, déficitaire],
il n’en reste pas moins que traiter humainement un anormal, c’est s’employer à le guérir, mais à trop bien élucider la maladie, c’est la notion même de santé que l’on finit par pulvériser. La sociologie viendrait à ce moment à la rescousse en définissant l’anormal, non plus en soi, mais par rapport à un contexte collectif et historique donné. Anormal est alors le phénomène qui s’écarte d’une moyenne, qui dévie, ou bien une conduite sera socialement anormale, dans une dimension diachronique, si elle est restée attachée à un stade maintenant dépassé ou si elle anticipe sur un développement encore virtuel. Ainsi pour Durkheim être en avance sur son temps, comme l’était Socrate, est aussi morbide que d’être, comme tel demi-solde de l’intellect, en retard sur lui. Aux États-Unis, le culturalisme s’engage également dans cette voie. Dans son ouvrage intitulé Échantillons de civilisations, dont le titre même est hautement significatif, Benedict montre que l’anormal varie avec les cultures, et qu’il représente simplement ce qui est antipathique aux normes d’une civilisation donnée.
Ainsi telle culture primitive prend pour thème l’exaltation du moi individuel, tandis que telle autre l’exclut. L’agression est une conduite honorée chez les uns, réprouvée chez les autres. Est-il cependant très satisfaisant de concevoir l’humain comme une virtualité polymorphe d’innombrables et irréductibles réalisations ? S’il est exact par exemple que tout développement psychologique est soumis à des conditionnements sociaux qui peuvent différer, s’il est vrai par exemple que les schémas de la psychanalyse doivent être assouplis par une reprise sociologique, ainsi le complexe d’Œdipe, loin d’être universel, est lié à la contingence de certaines structures familiales, et par exemple dans telle île de l’Indonésie étudiée par Kardiner, les enfants ne vivant pas auprès de leurs parents qui travaillent dans des rizières sur le continent mais étant pris en charge par de vieilles personnes qui s’occupent peu d’eux, les processus de fixation au père n’ont pas lieu de s’effectuer, de là pas de formation d’un sur-moi et pour les indigènes un caractère qui exclut tout attachement, toute agressivité également, une absence aussi bien de ferveur que de violence. Mais, si tout cela est exact, la disparité des situations sociales et les conséquences psychologiques qu’elles suscitent n’entraînent pas que l’humain se fragmente en des îlots d’humanité irréductibles les uns aux autres, et la psychanalyse n’est nullement déboutée par le relativisme sociologique, car si le devenir de la personnalité se développera le cas échéant dans des schémas divers, il n’en reste pas moins que les mécanismes d’identification et de projection par quoi l’histoire d’un homme s’effectue au contact des autres qui forment son entourage restent les mêmes, que l’homme demeure partout cet être fragile, tourmenté par des instances opposées, exposé à des frustrations, à des régressions, à des angoisses, et qui a pour tâche de trouver la paix et l’équilibre en soi, en surmontant les complexes qui composent à la fois dynamisme et menace pour sa vie psychologique. Et s’il n’y a pas de nature humaine posée comme un modèle intangible et éternel selon le critère duquel on pourrait juger quelle est la civilisation normale et quelle est celle qui ne l’est pas, il n’en existe pas moins, rappelons-le encore une fois, une condition humaine qui partout astreint l’homme à la nécessité de conquérir sa liberté en transformant en moyens les obstacles qui l’entravent. Or, il n’est point sûr de ce point de vue que toutes les sociétés fournissent à l’homme les meilleures chances de réaliser son bonheur, et le culturalisme américain escamote naïvement ou hypocritement, comme on voudra, dans son brouillard relativiste, le fait qu’il y a des sociétés dont les structures sont plus oppressives que d’autres. L’anormal, est-ce le déviant, l’inadapté, celui qui ne parvient pas à se loger dans la société où il vit comme dans le meilleur des mondes possibles, et qu’il conviendra donc d’amener à une plus saine conception de ce qu’il doit à son groupe ? En langage de psychologie sociale, une telle opération s’appelle une normalisation. L’individu normalisé sera à nouveau le plus heureux des hommes dans la meilleure démocratie du monde. Mais il est clair, et on n’y insistera pas, que rien n’est plus louche qu’une telle normalisation. C’est notre monde, dit Sartre, qui est devenu aliénant, objectivement difficile à vivre, dans une société où règne l’exploitation n’est-il pas normal qu’il y ait des anormaux, en sorte que cette même société en traitant la maladie mentale comme du négatif, du morbide refuse simplement d’y lire le reflet de sa propre démence. L’homme que ces rapports humains faussés et brouillés conduisent à la névrose, faisant ainsi la preuve que décidément il ne peut s’y habituer, n’y a -t-il pas à l’origine même de ses balbutiements et de ses réactions malhabiles comme un réflexe de santé ? Non, en vérité, tout n’est pas normal dans l’idée que nous avons souvent tendance à nous former du normal.
Il convient donc à présent de reprendre notre analyse et d’affronter plus vigoureusement la notion fuyante que nous cherchons à saisir. Nous disions en commençant que la normalité telle qu’elle apparaît au sens commun ne correspond qu’à un degré zéro de rationalité. Il n’y a pas pourtant pas de degré zéro de la rationalité. La pensée la plus pauvre tient encore son peu de valeur de ce minimum d’exigences sans quoi il n’y aurait pas de pensée. Rappelons-nous encore, pour comprendre cela, nos premiers propos : le normal, c’est ce qui ne saurait surprendre, ce à quoi l’on est en droit de s’attendre. Or il est bien vrai que penser, c’est se donner des droits sur le réel. La nature, comme l’établit l’analyse kantienne, c’est l’ensemble des conditions auxquelles elle doit satisfaire, cela s’appelle l’a priori, afin d’être pensable, c’est-à-dire de devenir objet pour nous. Car la condition de l’expérience, c’est, dit Kant, la condition des objets de l’expérience. Ainsi je suis en droit de m’attendre que tout objet de l’expérience ait quantitativement une grandeur, qualitativement un degré, soit précédé d’une cause et soit suivi d’en effet. La nature, c’est le protocole de la raison. N’est-ce pas cela que nous voulons dire, quand nous disons pour ratifier un propos : naturellement. Naturellement signifie : cela est conforme aux règles mêmes de l’esprit. Et sur ce point la science est plus stricte encore que le sens commun. Car pour un esprit scientifique il est évident que tout dans la nature ne peut être considéré que comme normal. La science ne connaît pas de bizarrerie, d’étrangeté absolue, pour elle il y a de l’inexpliqué, il n’y a pas d’inexplicable, il n’y a pas de miracle. C’est toute la différence entre le fait qui est scientifique, c’est-à-dire qui dans les mêmes conditions se reproduira tel, et l’évènement, qui est de l’ordre du vécu, et non pas du conçu, qui étonne, sort de l’ordinaire, frappe ; ça, disons-nous, c’est un évènement. Scientifiquement, il n’est de fait que déterminé par une loi, c’est pourquoi il est inexact de dire que la démarche scientifique a pour propre d’aller du fait à la loi. Si nous étions, en effet, vraiment en possession des faits, nous n’aurions pas à chercher plus loin et le travail épistémologique serait superflu. Il faut être bien savant, dit Alain, pour saisir un fait. Mais c’est par la constitution de la loi que les faits peuvent apparaître dans leur vérité. L’évènement qui n’a pas de place dans la science, ce serait tout au contraire un fait qui ne serait dépendant d’aucune loi. Cet évènement introduirait le désordre dans le monde : il est refusé, exclu par la science, qui peut admettre de l’indéterminable, non pas avaliser de l’indéterminé. Sans doute, la mentalité scientifique a connu, au cours de son histoire, de profondes mutations. Les théories et les modes d’explication qui composaient la normalité scientifique d’une époque ont été l’objet de bouleversantes refontes. Les catégories de la raison sont, Bachelard y a insisté, mobiles, provisoires, toujours affinées et assouplies. L’audace de cette raison la conduit à remettre en question ses propres schémas d’intelligibilité. C’est qu’elle ne se contente plus, comme la physique du XIXe siècle qui, dit Bachelard, dormait d’un sommeil dogmatique, d’une vérité en gros. Ainsi, pendant longtemps, la physique a fait à ses théories, en l’occurrence au newtonisme, une confiance trop entière. Elle oubliait qu’une hypothèse n’est pas vraie en elle-même, mais seulement à proportion de sa fécondité. Or la physique d’hier entendait moins, grâce au newtonisme, progresser dans la connaissance du réel, que mettre le newtonisme à l’abri de tout démenti de la réalité. Elle préférait les théories aux faits. Elle avait tendance à donner a priori raison à la théorie sur le fait. Il y avait bien quelques points inintelligibles dans une perspective newtonienne, des faits récalcitrants, mais l’on minimisait ce résidu, on ne le prenait pas au sérieux, on supposait qu’en droit ils étaient parfaitement intégrables dans les cadres newtoniens et que quelque savant futur en ferait un jour la démonstration. Plus l’esprit scientifique devient exigeant, plus au contraire, il s’attache à ces faits récalcitrants, à ces faits polémiques, comme les nomme encore Bachelard. Ainsi Michelson et Morley avaient essayé par un dispositif ingénieux de mettre en évidence l’existence du mouvement absolu de la Terre. L’expérience ayant échoué, le rayon lumineux qui se propageait dans le sens du mouvement de la Terre n’allant pas plus vite que le rayon propagé en sens inverse, ils conclurent simplement que leur expérience avait échoué. Einstein lui prit davantage en considération l’insuccès de cette expérience : il jugea que c’était la théorie newtonienne elle-même, dans son ensemble conceptuel, qui se trouvait remise en question, et que l’expérience, loin d’être négative, avait établi positivement que la vitesse de la lumière constituait un seuil physiquement indépassable. De la sorte, il est exact que la science privilégie le fait anormal, le fait qui ne rentre pas dans l’ordre, c’est à lui que va son attention la plus intense. De la même manière, qu’un morceau de plomb que l’on brûle augmente de poids offrit à la chimie du XVIIIe siècle l’évènement le plus [étrangement] anormal.