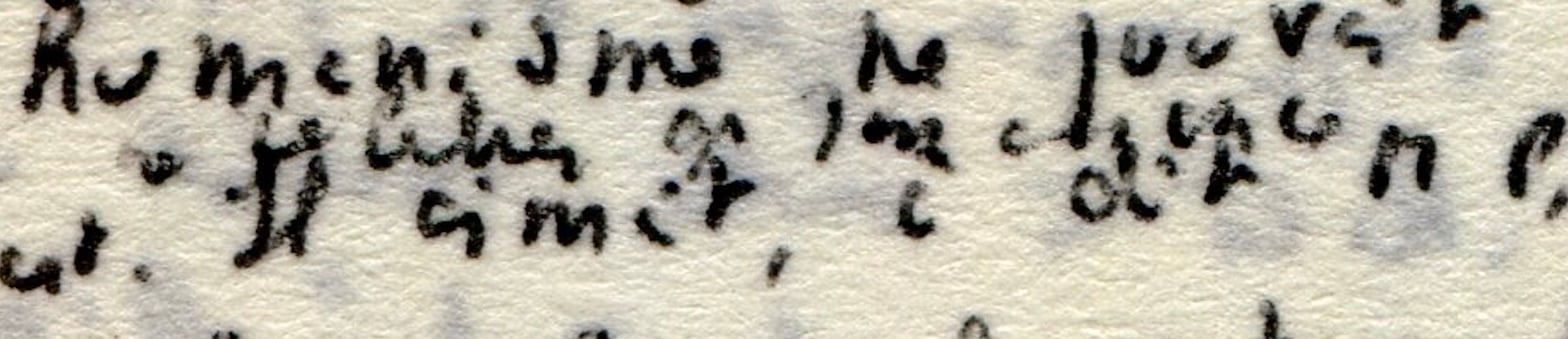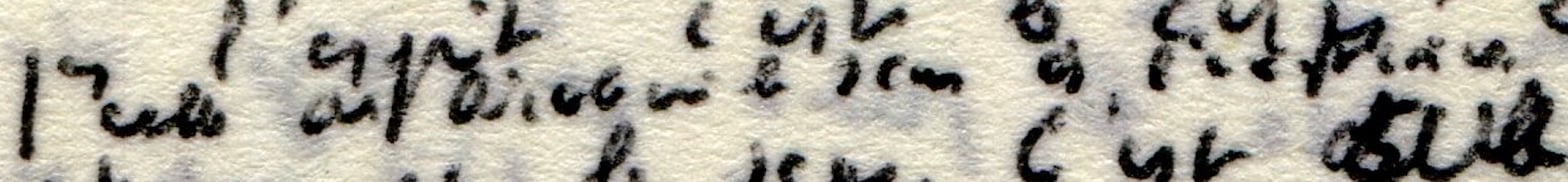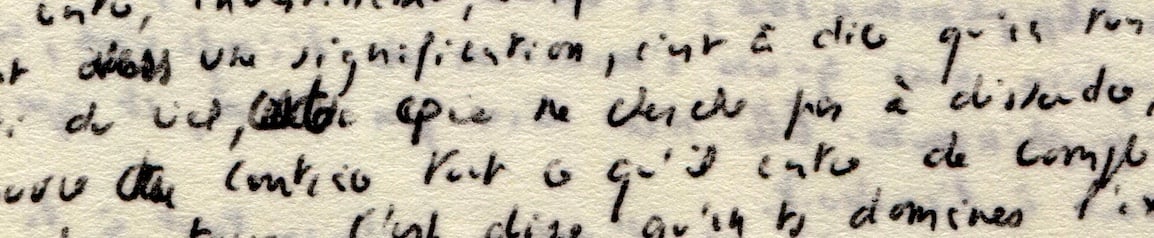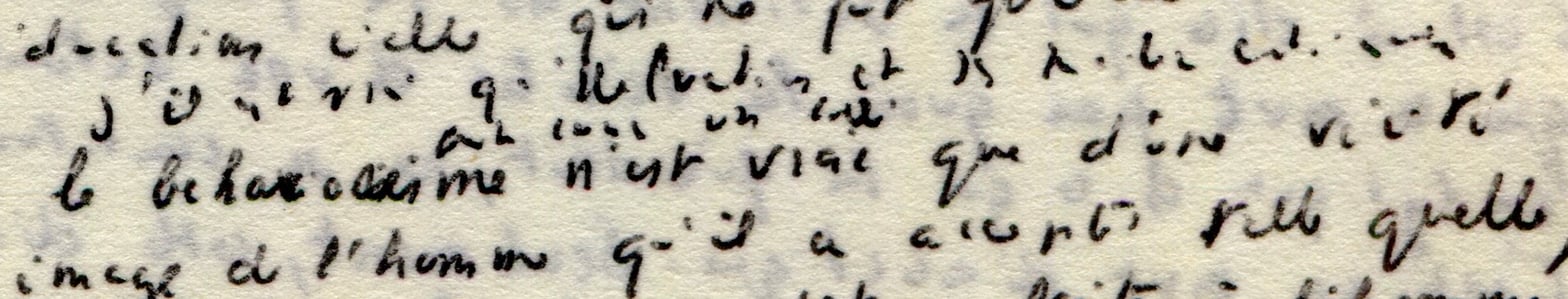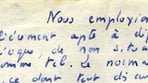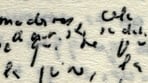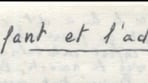matière et matérialisme (suite p. 6, 7 et 8)
vérification en atelier le 9 janvier 2025 de la transcription effectuée par Jean-Luc Demortier


Pour l’idéalisme, la matière n’était que l’entrave du sens, le corps la gêne de l’esprit. La matérialité ne pouvait plus dès lors apparaître que comme une disgrâce, un déficit, un résidu. Ainsi il y aurait toujours infiniment plus dans la pensée que dans la parole, dans l’intention que dans le geste. Un tel humanisme ne pouvait donc que diviser l’homme, le dédoubler, n’honorer en lui que le refus d’être ce qu’il est, ne célébrer que son absence. Il aimait, comme dit Merleau-Ponty, « l’homme contre son corps, l’esprit contre son langage, les valeurs contre les faits ». Aussi bien, le rationalisme dont il était porteur, était lui-même vide, inactif, intransitif. C’était un rationalisme sans rationalisation. Si l’on sépare en effet la conscience et la matière, tout perd son sens, et la conscience et la matière. Si le corps par exemple n’est qu’extériorité pure, il devient impossible de comprendre comment la pensée peut se lier à lui, en faire ce corps, le sentir comme son corps, l’éprouver comme unité et totalité. Ainsi l’âme cartésienne est une âme qui n’anime plus rien, et si l’âme et le corps sont considérés comme deux substances indépendantes, le problème de leur union devient insoluble, ce n’est plus qu’un fait, à accepter comme tel. De la même manière, si le mot dans sa matérialité, car la question de l’âme et du corps, et celle de la pensée et de la parole ne font qu’un, si le mot n’est qu’un instrument par lui-même vide de signification, il est impossible de comprendre comment de la pensée pourra s’y inscrire. Ainsi, croyant défendre la pureté du sens, cet idéalisme s’interdisait de donner sens à rien. « Ce qu’il y a de merveilleux, disait Nietzsche, ce n’est pas l’esprit, c’est le corps. » Le nouveau matérialisme se fixe donc une tout autre tâche : celle de réconcilier l’existence et le sens, celle de découvrir le sens dans l’existence.
C’est au corps lui-même, conformément au vœu de Nietzsche, qu’il assigne l’opération du sens. Il ne s’agit donc plus de nier le sens au profit de la matière, au sens où pour un Ribot la pensée n’était qu’un épiphénomène, un produit de luxe, au sens où elle n’aurait aucune influence réelle sur un comportement qui se passe d’elle et où tout s’explique mécaniquement, il convient au contraire de déterminer comment, par quelle organisation, quelle structuration, du matériel se réalise en signification, comment un système d’opérations sensorielles, par lui-même, en lui-même et sans qu’il soit besoin de supposer une conscience extérieure en lui, un petit homme dans le cerveau, se constitue en image du monde, comment un système de gestes se fait centre, investissement, conquête d’un milieu, comment un système de sons se développe en s’articulant dans une signification, c’est-à-dire qu’en tous domaines, et sans vouloir mutiler la richesse, la complexité du réel, cette philosophie ne cherche pas à dissoudre, à résorber le complexe dans le simple, mais elle découvre au contraire tout ce qu’il entre de complexe dans ce qu’on prenait à tort pour des mécanismes rudimentaires. C’est dire qu’en tous domaines l’explication par la structure prend le pas sur l’explication par l’élément où se complaisait un matérialisme périmé. Il y a un matérialisme abstrait et incomplet qui ne se définissait négativement que comme opposition à l’idéalisme, opposition encore elle-même idéaliste. Matérialisme = double abstraction.
Prenons-en un exemple emprunté à la psychologie. En psychologie, le matérialisme avait naguère donné ses faveurs à la théorie behavioriste qui lui semblait le mieux correspondre à ses exigences. Le behaviorisme, en effet, refusant à la conscience tout pouvoir causal, se proposait de rendre compte de toutes les formes du comportement, des plus rudimentaires aux plus fines, en privilégiant, comme unique principe d’explication, le réflexe, conçu comme une réaction automatique et parcellaire de l’organisme à l’action d’un stimulus extérieur. Les divers stimuli susciteraient ainsi de la part de l’organisme des réponses déclenchées automatiquement. Ainsi, tout serait mécanique et machinal dans le comportement, dans un comportement qui se constituerait par une addition, une sommation de réflexes qui peu à peu en se combinant constitueraient un montage d’ensemble. Or, une telle théorie qui faisait de l’habitude l’élément essentiel de la vie psycho-physiologique ne rendait même pas compte des caractères distinctifs de l’habitude elle-même. Il est clair, en effet, que dans cette perspective l’unique facteur de l’habitude ne pouvait être que la répétition, par l’effet de quoi s’enchaîneraient de mieux en mieux des éléments simples. Mais on ne voit pas en quoi la répétition de ce qui a déjà été fait représenterait la moindre cause de progrès. L’enfant qui a appris à écrire ne répète pas tels quels les gestes empruntés et gauches des débuts de son apprentissage. Comme l’écrivait Guillaume, dans son ouvrage intitulé La formation des habitudes, où il critiquait le mécanisme behavioriste au nom de la Gestalt-théorie : « Le nouveau mouvement n’est pas une simple juxtaposition des mouvements anciens… Il élimine les mouvements inutiles ou excessifs, il s’organise selon d’autres trajectoires et d’autres rythmes. » C’est ainsi qu’aucun ouvrier exercé ne conserve les gestes qui ont été enseignés à l’apprenti, ni aucun nageur ne reproduit purement et simplement les mouvements qu’on lui a enseignés par décomposition ». C’est non par l’effet d’une addition de gestes, mais par une réorganisation d’ensemble que progresse une habitude. Et c’est ce qui permet de comprendre pourquoi une habitude se développe par bonds, de façon discontinue, tandis que si la théorie mécaniste était exacte, elle se constituerait de manière régulière et linéaire. Le rat, par exemple, dans son labyrinthe, s’oriente soudain beaucoup mieux, s’installe d’une expérience à l’autre dans une sûreté nouvelle lorsqu’il a appréhendé, ce qui ne peut venir que d’un coup, la configuration d’ensemble des couloirs. Cela signifie que ce ne sont pas des stimuli isolés qui agissent sur l’organisme, mais que ces stimuli, loin d’être des réalités objectives, au sens physicaliste du terme, c’est-à-dire identifiables et repérables pour un témoin extérieur, n’ont d’existence pour le vivant, donc d’efficacité sur lui, que dans la mesure où ils sont intégrés dans la configuration générale d’un champ, elle-même formée par les besoins, les tendances de l’animal, qui se crée ainsi son propre milieu, ce que les naturalistes appellent son Umwelt. Le milieu, c’est donc d’abord pour l’animal un champ unitaire de signification vécue. Réciproquement, les réflexes n’apparaissent à l’état isolé dans la conduite que soit dans des conditions artificielles, ainsi au laboratoire où l’on peut, par un travail de séparation expérimentale, étudier un réflexe isolé, soit dans des conditions pathologiques : la grenouille décérébrée est un animal mutilé. En règle générale, comme Merleau-Ponty l’a établi à la suite de Goldstein, le réflexe, loin d’être une réponse indépendante et automatique est commandé par la conduite d’ensemble d’un organisme dont le détail est subordonné à son activité totale, c’est-à-dire à son adaptation active, à son débat avec un milieu qui lui offre un problème d’ensemble à quoi il doit répondre par une solution d'ensemble. Point de conduite donc qui ne soit signifiante. De la sorte, loin que la personnalité, dans la nouvelle psychologie, s’étrique aux simples dimensions de l’organisme, c’est l’organisme qui se révèle déjà comme personnalité. De ce point de vue, la différence esprit-corps ne correspondrait plus à une dualité substantielle mais à une différence de degré d’intégration de la conduite. « Plus, dit Merleau-Ponty, une conduite est grossière, éparpillée, plus elle est corporelle, plus elle se complexise, plus elle se spiritualise. »
Cette référence aux nouvelles explications épistémologiques ne nous a pas éloignés de notre thème central, selon lequel, dans la perspective de la dialectique du maître et de l’esclave, l’histoire et les progrès de la science seraient indissociables de cette prise de conscience par quoi l’homme se libère de ses entraves et s’approprie son humanité. C’est qu’il n’y a pas, en effet, de science neutre, purement objective, exempte de tout sens. La science ne s’objective qu’à travers des projets. Ce n’est pas un hasard de ce point de vue si la nouvelle psychologie, la psychologie scientifique, a pris naissance dans des pays ou des régimes eux-mêmes neufs, avec Watson et Pavlov, d’une part dans une nation qui n’avait pas de passé, les Etats-Unis, d’autre part dans une nation qui édifiait un avenir, l’URSS. Dans les deux cas, cette psychologie obéissait à des objectifs pratiques, pédagogiques, radicaux. La psychologie de Watson voulait offrir à une société les moyens de façonner à sa guise ses individus. « Donnez-moi dix enfants, disait Watson, choisis au hasard, pourvu seulement qu’ils soient normalement constitués, et je me charge de leur donner les aptitudes que je voudrais, je ferai de l’un un médecin, de l’autre un ingénieur, je transformerai le troisième en un voleur, etc. » La psychologie pavlovienne, grâce à la technique du conditionnement, était destinée de son côté à construire un nouveau type d’hommes, débarrassés des séquelles d’un passé périmé et aptes aux nouvelles tâches qui les attendaient. Ce souci d’une pédagogie radicale, originale, décisive est, observons-le, une des constantes de l’histoire du matérialisme. Si les pensées, les passions de l’homme dépendent, en effet, non d’une mystérieuse et immuable nature spirituelle, mais des conditions de son milieu, l’éducateur ne rencontrera rien dans l’homme qui puisse résister à son instruction, la connaissance des mécanismes naturels lui assurera de former les hommes en fonction de ses vues. Marx, on le sait, s’est toujours montré sévère à l’égard de telles tentatives. Il lui semblait, et il a écrit, qu’il n’y avait pas de réforme de l’éducation réelle qui ne fût précédée et commandée par une réforme de l’éducateur lui-même.
Or il n’est pas douteux, de ce point de vue, que le behaviorisme (s’il est vrai qu’Helvétius et ses nombreux continuateurs ont connu un oubli) n’est vrai que d’une vérité tronquée et mutilée. Le behaviorisme part, en effet, d’une image de l’homme qu’il a acceptée telle quelle, sans la remettre en question, et qui est simplement le reflet d’une certaine condition faite à l’homme. On reconnaîtra sans peine dans cette conception totalement mécanisée du comportement une copie, ou une transposition du travail automatique et parcellaire de l’usine, où les ouvriers ne sont que de simples rouages dans l’exécution d’un montage. Le behaviorisme, a pu dire Sartre avec raison, est la philosophie du taylorisme. C’est-à-dire qu’ici, sous prétexte de matérialisme, et d’un matérialisme mystifiant, l’ouvrier ne se voit que comme il est effectivement sous le regard de son maître. Car c’est bien le maître qui conçoit l’esclave comme une machine. L’opprimé, dans tout matérialisme mécaniste, continue donc de se penser comme l’Autre le pense. C’est pourquoi un déterminisme mécaniste ne saurait être l’unique ni le plus fécond schéma d’intelligibilité d’un matérialisme pur enfin de toute idéologie. On voit bien sûr en quoi ce déterminisme sert déjà d’instrument de libération. S’il est exact, le maître n’y échappe pas plus que l’esclave, tout entier soumis à ses conditions d’existence, le maître rentre comme l’esclave dans l’univers des choses où tout s’explique du dehors. Seulement, comme le rappelle encore Sartre, le vrai but du révolutionnaire n’est pas d’être chose mais de parvenir enfin à gouverner les choses. Et si l’esclave est l’homme du travail, l’homme que seul le travail a rendu humain, l’homme qui doit tout au travail, ce qu’il a appris du travail, c’est bien davantage que le déterminisme qui est la loi des choses. Ce déterminisme, c’est son travail d’abord qui lui a permis de le découvrir. Jamais il n’en aurait connu les lois, s’il n’avait eu le projet de transformer la nature, c’est-à-dire de dépasser un état actuel. Ainsi seules les fins que projette l’homme font surgir à son regard une vérité des choses qui sinon, dans le cas d’une pure contemplation, serait à jamais demeurée cachée et enfouie en elles. Ainsi le déterminisme ne se dévoile qu’à une praxis. On pourrait dire du déterministe que c’est l’homme dans la nature. Seulement, comme Sartre le rappelle encore, dans la Critique de la raison dialectique, les choses ne sont médiatisées par l’homme que dans la mesure où l’homme se trouve lui aussi médiatisé par les choses. Le champ de l’action est donc celui du pratico-inerte, où toute finalité s’accompagne, se leste d’une contre-finalité. Pour qu’il puisse agir sur les choses, il faut que l’homme se fasse chose lui-même et passe en elles. Aussi, du déterminisme on peut dire aussi que c’est la nature dans l’homme. Ainsi, comme dit Marx, « l’objet produit par le travail s’oppose à l’homme comme un être étranger, comme une puissance indépendante. » En même temps que l’homme, par le travail, se loge dans l’inhumain, l’inhumain s’implante dans l’humain. Comme il y a une nature physique, il y aurait une nature sociale, justiciable des mêmes catégories et selon Auguste Comte donnant lieu elle aussi à une statique et à une dynamique. De même l’économie politique se constitue en science : son objet abstrait, l’homo economicus, est régi uniquement par la loi des appétits, et les rapports économiques entre les hommes y sont assujettis à des lois strictes, immodifiables, irréfragables, offre et demande, etc., les célèbres lois d’airain. Or il apparaît à la critique marxiste que cet univers implacable n’est en fait qu’un produit de la pratique capitaliste. Ce que le capitaliste baptise du nom de nature, c’est en réalité l’effet historique de sa domination, effet qu’il tente d’éterniser. De ce point de vue, le concept de nature est la pièce maîtresse de la mythologie des classes ou des nations dominantes. La nature, c’est une confiscation de l’histoire. Sous l’affabulation de la nature, un groupe humain entend mettre à l’abri d’une histoire qui pourrait la défaire, l’œuvre, la conquête que lui-même a réalisée dans l’histoire. Le déterminisme des lois économiques apparaît alors comme de l’inerte, de l’état de fait. Comme tout déterminisme séparé des déterminations pratiques qui l’ont constitué, réalisé hors de l’action, inscrit dans les choses, il prend le visage terrible d’une fatalité, d’un destin. Les lois du marché semblent dès lors mystérieuses, impénétrables, c’est du chaos. Hegel n’appela-t-il pas le déterminisme : du hasard déchaîné ? Bref, là où un domaine de l’activité humaine se donne comme déterminé en soi, c’est que l’on a simplement affaire à un secteur encore non maîtrisé, c’est-à-dire dissocié et déchiré, qu’une praxis réellement révolutionnaire devra soumettre à l’appropriation.