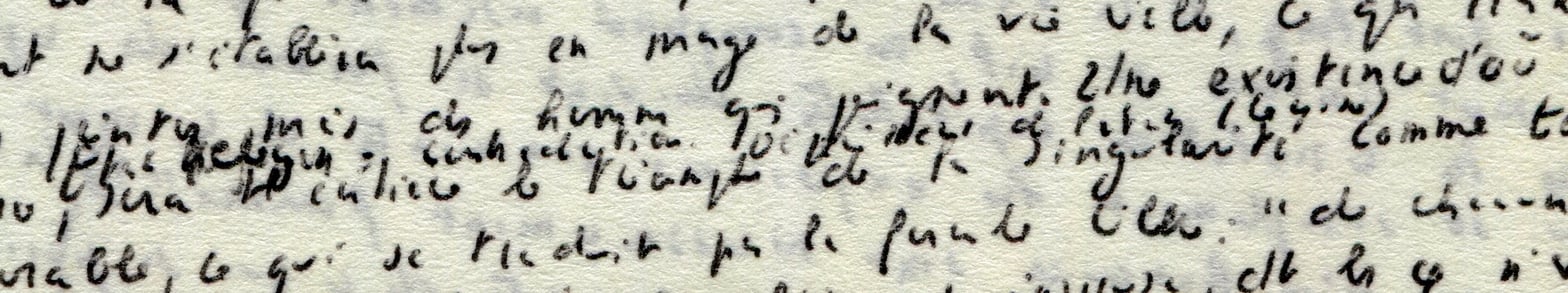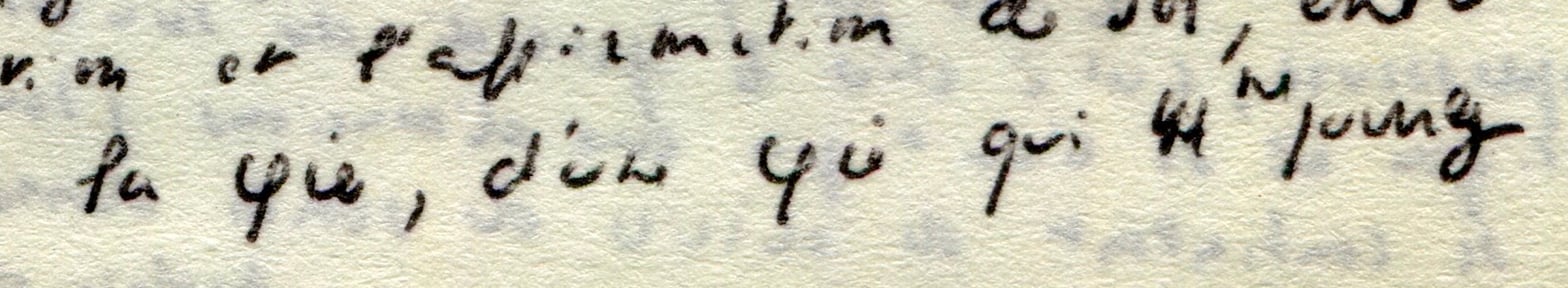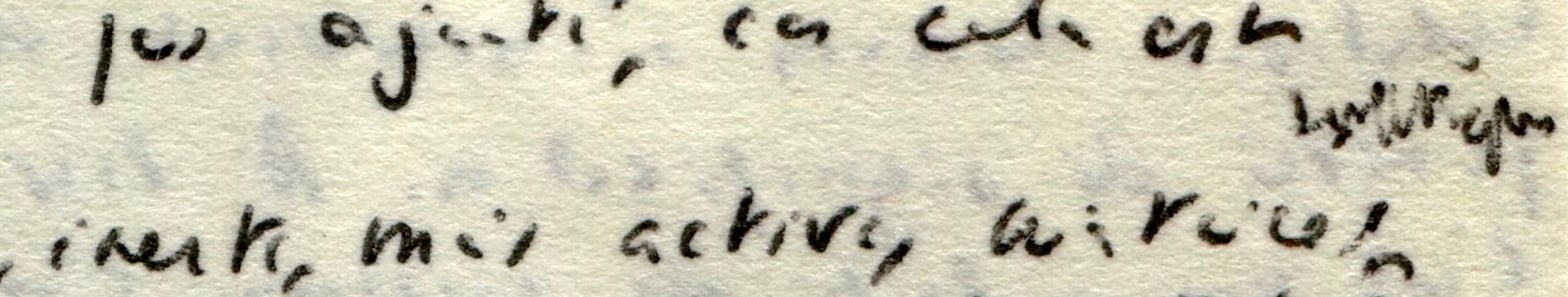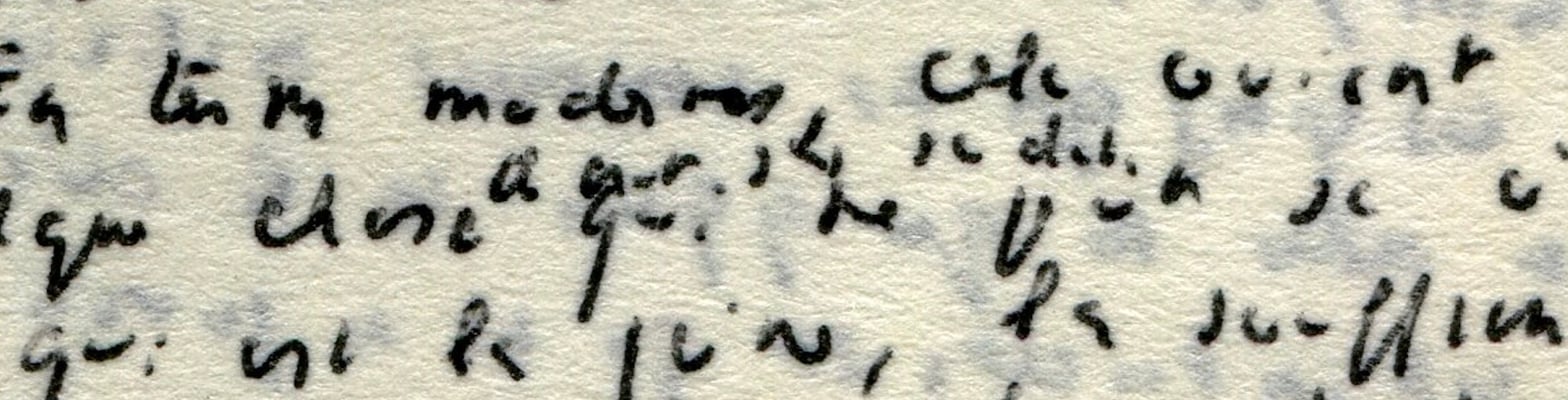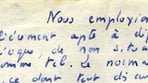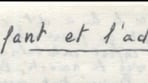matière et matérialisme (suite et fin p 12, 13, 14)
vérification en atelier du 23 janvier 2025


L’analyse marxiste ne se bornera donc pas à retracer des processus historiques, autre est l’histoire des faits, autre est leur explication. De là les deux dangers qui menacent toujours le marxisme : le premier, c’est en négligeant que le réel est tout entier pris dans l’activité pratique des hommes dont ce que nous appelons les faits n’est qu’une abstraction, une réification intellectuelle, de s’enfermer dans une pure théorie des faits qui ne sera qu’une théorie de l’apparence. Alors le marxisme devient un scientisme, un sociologisme, sans pouvoir critique. On se contente de collectionner des faits empiriques, d’utiliser des techniques parcellaires empruntées à telle ou telle science de l’homme à la mode, et bien vite, comme l’écrit Henri Lefebvre, des philosophes arriveront pour donner de l’unité spéculative à cette masse informe de faits, de techniques et de résultats. L’autre danger, c’est d’investir la praxis d’une portée mystique, surnaturelle, de s’imaginer que l’action révolutionnaire porte en soi sa propre théorie. Le marxisme n’est plus alors qu’un pragmatisme. On fait alors, comme chez Lukacs, de la science la sécrétion naturelle de la conscience prolétarienne. Sartre verse lui-même dans cette erreur quand il s’imagine que du fait même que l’opprimé nie, refuse sa condition présente, la dépasse vers l’avenir, il prend sur elle le point de vue quasi-leibnizien d’où elle apparaît dans sa totalité. Comme toute analyse véritable, l’analyse chez Marx ne s’amorce pas à partir des faits – domaine de l’apparence – mais à partir de principes. Elle ne saisit pas les principes dans les faits mais les faits par les principes. Marx lui-même a mis du temps à se dégager de l’empirisme. Que l’explication du fait ne soit pas donnée dans le fait lui-même, c’est ce qui se dégage du terme même dont se sert Marx pour désigner, dans le Capital, sa méthode : une exposition. Une exposition n’est pas une simple exhibition empirique. Exposition a un sens philosophique précis. Kant l’utilise dans l’esthétique transcendantale non pas pour constater que l’espace est le terrain des opérations de la géométrie, mais pour démontrer qu’il constitue le fondement de leur validité. Il n’y a rien finalement de plus abstrait que la pensée empiriste. Par induction, par généralisation, elle transforme un fait en une catégorie. C’est ainsi que l’économie politique dont Marx établit la critique ne saisit que des abstractions : argent, division du travail, valeur, etc, catégories qu’elle sépare du mouvement du réel et éternise indûment. La méthode marxiste consiste, elle, à reconstruire le réel dans son mouvement interne, dans la totalité de la praxis où il s’articule. Il s’agit d’étudier par exemple comment une catégorie économique, elle-même produite par un développement des forces productives, la valeur d’échange, se développera selon une logique interne, et non point au gré de desseins humains, en déterminations nouvelles : argent, capital, travail abstrait, comment donc chaque détermination sort dialectiquement des précédentes, comment se constitue peu à peu un système relativement stable, fixe et que l’on prend pour l’effet de lois économiques naturelles objectives, le système capitaliste, alors qu’il ne se comprend que rattaché au devenir dialectique du travail humain. Et il est vrai que ce système, et par là il révèle son origine dialectique, est contradictoire, puisque un antagonisme se fait de plus en plus jour entre le progrès des forces productives et les rapports sociaux de production, c’est-à-dire que l’équilibre se détruit entre la production et la consommation, plus s’enrichit le capital, plus diminue le pouvoir d’achat des travailleurs, d’où les crises économiques, crises que l’économie politique accepte comme une fatalité, et qui sont du reste conjurées par les guerres qui, en détruisant une certaine partie des forces productives, hommes et choses, restaurent un nouvel équilibre, guerres qui se présentent ainsi comme la manifestation d’une sagesse que la conscience mystifiée et réifiante attribue précisément à ce qu’elle appelle la force des choses.
Ainsi, de même que la conscience selon Spinoza ne pouvait qu’éprouver la contingence et l’adversité de la nature, tant qu’elle ne comprenait pas que cette nature était l’expression d’un seul et même principe, la substance nécessaire, dont elle-même, la conscience, est une modalité, en sorte que dans le savoir vrai s’abolit l’extériorité de la conscience et du monde, d’une façon évidemment très différente, mais au travers d’une analogie, la conscience selon Marx subit sa vie sous forme de déterminations étrangères, objectives, tant qu’elle n’a pas compris le principe unique du ressort de l’histoire, la production humaine. Au terme du savoir l’homme devient, selon l’expression de Spinoza, conscius sui, mundi, Dei. En un sens, il n’y a pas de philosophie de la conscience, et en un sens, il n’y a de philosophie que de la conscience. La méthode philosophique ne consiste pas à transformer la conscience en connaissance mais à transformer la connaissance en conscience, c’est-à-dire à concrétiser le savoir en une vie. Dans une société délivrée de ses aliénations, non seulement les activités créatrices, scientifiques, artistiques, poétiques pourront se déployer sans entraves puisqu’elles seront affranchies de toute subordination à une situation sociologique, puisque à travers elle, à leur insu comme c’était avant le cas, ne se reflèteront plus des conditions politiques, économiques, alors que dans la société de classes l’écrivain bourgeois reste tributaire de sa classe, qu’il en soit le complice ou qu’il tente de la nier, mais encore puisque toute classe aura disparu, puisque dans l’œuvre personnelle ne subsistera plus l’anonymat d’un groupe, les produits de la praxis seront enfin purement individuels, leur activité ne sera plus séparée, abstraite, leur art ne s’établira plus en marge de la vie réelle, ce que Marx exprime en disant qu’il n’y aura plus des peintres mais des hommes qui peignent.
Une existence d’où l’Etat oppressif et impersonnel aura disparu (Etat, religion : contradiction. Dépérissement de l’État (Lénine)), sera tout entière le triomphe de la singularité comme telle, c’est-à-dire du qualitatif, de l’immesurable, ce qui se traduit par la formule célèbre : « De chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins ». Ainsi cette vie singulière et joyeuse, dont les philosophes n’avaient fait que la théorie, c'est la praxis qui la réalisera, marquant cette fin, je cite Marx, de la querelle entre l’homme et la nature, entre l’existence et l’essence, entre l’objectivation et l’affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, fin qui était celle-là même de la philosophie, d’une philosophie qui XXX, dit Marx, qu’à condition de la réaliser ; il n’a pas ajouté, car cela est évident, qu’à la condition de la connaître.
Tout vœu philosophique est un vœu d’identité, non point d’identité morne, mais active, créatrice, synthétique de l’homme et de la nature, du sujet et de l’objet. De ce point de vue, la matière s’est toujours présentée comme l’incoercible obstacle de cette identité, comme un conceptuellement irréductible, comme le concept si l’on veut, où se limitent tous les autres, comme le fait brut où se termine toute rationalisation. Berkeley, dit Bergson, a eu l’intuition que la matière n’était que le mince, l’infime écran, la pellicule transparente qui séparait l’esprit de Dieu. « Ce que, écrit Bergson, dans La Pensée et le Mouvant, l’idéalisme de Berkeley signifie, c’est que la matière est coextensive à notre représentation ; qu’elle n’a pas d’intérieur, pas de dessous ; qu’elle ne cache rien, ne renferme rien ; qu'elle ne possède ni puissances ni virtualités d’aucune espèce ; qu’elle est étalée en surface et qu’elle tient tout entière, à tout instant, dans ce qu’elle donne » — puisque esse est percipi. « Le mot « idée », ajoute Bergson, désigne d’ordinaire une existence de ce genre, je veux dire une existence complètement réalisée, dont l’être ne fait qu’un avec le paraître, tandis que le mot « chose » nous fait penser à une réalité qui serait en même temps un réservoir de possibilités (fond des choses. Descartes, chose = objet). C’est pour cette raison que Berkeley aime mieux appeler les corps des idées que des choses. » Au sens donc où la matière serait une intériorité absolue, l’atome des physiciens grecs, matière immatérielle, extériorité de l’intériorité et intériorité de l’extériorité, en ce sens donc la matière est insaisissable. « La matière, écrit de même Kant, dans l’amphibologie des concepts de la réflexion, est substantia phaenomenon. Ce qui lui convient intérieurement, je le cherche dans toutes les parties de l’espace qu’elle occupe et dans tous les effets qu’elle produit et qui assurément ne peuvent jamais être que des phénomènes des sens externes. Je n’ai donc rien qui soit absolument intérieur, mais seulement quelque chose qui l’est relativement, et qui lui-même à son tour se compose de rapports extérieurs. » Dans la mesure par conséquent où l’entendement ne peut s’appliquer qu’aux données de la sensibilité, la matière n’est nulle part un objet pour l’entendement pur. « Quant à ce qui peut être le fondement de ces phénomènes que nous nommons matière, c’est simplement quelque chose dont nous ne pourrions jamais comprendre ce qu’il est alors même que quelqu’un nous le dirait, puisque cela supposerait un pouvoir d’intuition purement intellectuelle qui nous est interdit », et que nous ne pouvons comprendre, comme dit Kant, que ce qui implique dans l’intuition quelque chose qui corresponde aux mots dont nous nous servons. La matière, ce je ne sais quoi, ne serait ainsi qu’un simple flatus vocis, un signifiant vide de tout signifié. Seulement, cette critique par la connaissance se retourne en une critique de la connaissance elle-même. Si la matière n’est rien, notre esprit ne perçoit plus que de pures apparences, c’est-à-dire que les apparences de rien. Pour sauver donc la connaissance du phénoménisme, la philosophie réintégrait in extremis la matière, à titre de réquisit, en tant que le cela qui n’apparaît pas mais qui fonde tout ce qui apparaît : ce que Kant appelle l’objet transcendantal, ce quelque chose = x, cause non sensible de toutes nos représentations, et dont nous ne savons rien du tout. La matière était philosophiquement cet inconnaissable qui conférait paradoxalement sa validité à toute connaissance, ce néant sans quoi il n’y aurait pas d’être. La matière était en somme l’invérifiable vérité de l’idéalisme. Et nous prenons acte ici d’un nouveau paradoxe. C’est dans l’idéalisme que la matière se trouve le plus affirmée, c’est dans le matérialisme qu’elle se voit le plus niée. N’est-ce pas déjà le propre du matérialisme scientifique, comme nous l’a montré Bachelard, que de dématérialiser la matière, que de briser son inertie ? Non point au sens mineur où la matière serait conçue comme de l’énergie, car l’énergie est encore une chose à sa manière, mais au sens où aucune image matérielle, intuitive, réalisante, n’est apte à exprimer les théories de la physique moderne. « En fait, comme le rappelle Bachelard, les thèses qui, en mécanique ondulatoire, représentaient l’onde pilote dirigeant le corpuscule n’ont apporté que de mauvaises métaphores. Tout ce qu’on peut dire, c’est que cette association n’est ni causale ni substantive. Le corpuscule et l’onde ne sont pas des choses liées par des mécanismes. Leur association est d’ordre mathématique. L’onde est un tableau de probabilités dont le corpuscule est une chance. « Exprimons ainsi, écrit Bachelard, cette double suprématie du nombre sur la chose et du probable sur le nombre par une formule polémique : les substances matérielles ne sont que l’ombre d’un nombre. »
Etape de la pratique scientifique, la matière n’est également qu’un moment à l’intérieur de la philosophie marxiste, dont la part proprement philosophique est justement de déterminer comment, à travers le besoin, le travail, la matière se convertit en sens, dans un être qui ne se scinde de la nature que pour finir par se l’approprier, par la convertir en activité, abolissant cette distance entre lui et les choses où s’épaississait leur opacité. C’est de ce point de vue que le marxisme doit être considéré à la fois comme une philosophie de l’économique et une philosophie du dépassement de l’économique. La matière, en première analyse, c’est bien l’économique, sous la forme à la fois d’objet brut, à œuvrer, et de besoins. Et n’est-ce pas lorsque l’économique envahit brutalement et totalement le champ de l’activité humaine, au détriment, à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre, que l’homme, dans une détresse absolue, éprouve la matérialité à l’état pur ? Alors, dans ces cas extrêmes qui sont malheureusement les cas les plus fréquents, famine, etc., l’homme n’est plus nature humaine, c’est-à-dire nature niée, mais nature tout court. Il n’est plus rien d’autre que faim, soif… Et dans cette perspective on pourrait remarquer au passage que la sexualisation du besoin, le désir traité comme force purement sexuelle ne peut être que le fait d’une culture qui a déjà singulièrement reculé ses distances d’avec la nature. L’obsession, en l’homme, est d’abord alimentaire. La faim ignore les sexes. Au sens où Alain disait que la morale, c’est bon pour les riches, la psychanalyse c’est déjà une théorie de nantis. L’économique tient bien chez Marx le rôle traditionnellement conféré par la philosophie à la matière : c’est un principe de division, d’exclusion, d’éparpillement. C’est de l’inertie. C’est du négatif. Dire que l’économique est l’ossature de la praxis, au sens où Marx définit l’économie politique comme anatomie sociale, c’est dire que les rapports entre les hommes sont entravés, brouillés, qu’ils ne peuvent être directement des rapports d’esprit à esprit, c’est-à-dire des rapports de liberté, mais qu’ils doivent passer par le détour des choses, se constituant ainsi en force, en pression, en domination. Mais, de la sorte, dès que les relations humaines s’inscrivent dans, se rapportent sur l’économique, cet économique est déjà pénétré de signification. A travers la lutte des classes, ce ne sont pas simplement des appétits matériels, c’est une volonté de puissance, c’est du prestige, c’est un combat pour la reconnaissance qui se joue. L’économique est donc chez Marx moins le tout de la réalité que la réalité sur quoi tout se rapporte, que ce sur quoi les rapports humains prennent réalité et effectivité. L’économique est moins la vérité que le quelque chose qui sert de référence à la vérité, car c’est une illusion de l’idéalisme que de parler d’une vérité en soi, car la vérité est toujours relation d’elle-même à autre chose. Marxistement, il ne saurait y avoir de facteur causal unique, pour cette raison que rien n’est plus étranger à la dialectique que le causalisme. Hegel a montré que la causalité est l’instrument diviseur d’une philosophie de l’entendement qui sépare, c’est-à-dire maintient ceci hors de cela, assigne ceci comme cause de cela. Seulement, au terme de l’histoire, qui n’était rien d’autre que passage, acheminement dans la praxis de la matière au sens, l’économique cessera de former barrière, écran, désunion. L’économique s’évanouira de plus en plus. L’homme, grâce à son travail enfin souverain, pouvant accroître ses forces productives, ses techniques sans les empêchements, les entraves du politique, se délivrera de son joug. La victoire du travail, ce sera la suppression — en tout cas l’atténuation progressive — du travail. C’est ce qui se dégage d’un des rares textes où Marx a traité de la société future, sous le nom de règne de la liberté, à la fin du Capital III. « Le règne de la liberté commence là où finit le travail déterminé par le besoin et les fins extérieures ; par la nature même des choses, il est en dehors de la sphère de la production matérielle. Dans le travail, même libre, le règne de la nécessité subsiste toujours. C’est au-delà de ce règne que commence le développement des puissances de l’homme. »
Vous serez comme des Dieux. Telle était déjà la promesse que le matérialiste Épicure, dans la Lettre à Ménécée, faisait à ses disciples. Il reste à savoir si un sens totalement réalisé ne correspondrait pas à un évanouissement total du sens.
En termes modernes, cela revient à se demander si tout est dialectisable, s’il n’y a pas en l’homme quelque chose (de brut sans nul doute) qui ne peut se résoudre en aucune dialectique, qui est insusceptible d’aucune médiation, et qui est la peine, la souffrance, ce quelque chose de non travaillé sans quoi tout travail ne serait plus qu’un jeu. La matière, en dernière analyse, en ce qu’elle a d’insurmontable, ce serait bien cette mort dans la vie qui fait toute la vie, ce non-sens qui définit tout sens comme lutte, épreuve, labeur inépuisable, cette limitation qui fait selon Hegel que seul un être fini peut avoir le sens de l’infini, cette étrangeté dont l’épreuve seule peut nous rendre familiers à nous-mêmes. La matière, c’est bien pour l’esprit le paradoxe au sens kierkegaardien du terme, cet impensable sans quoi il n’y aurait pas de pensée. En sorte qu’il n’y a finalement qu’un danger, pour cette philosophie de vocation critique qu’est le matérialisme, c’est de se poser en une religion à rebours, c’est d’absolutiser la matière et d’appeler dieu ce qui nous interdit fécondement de l’être.