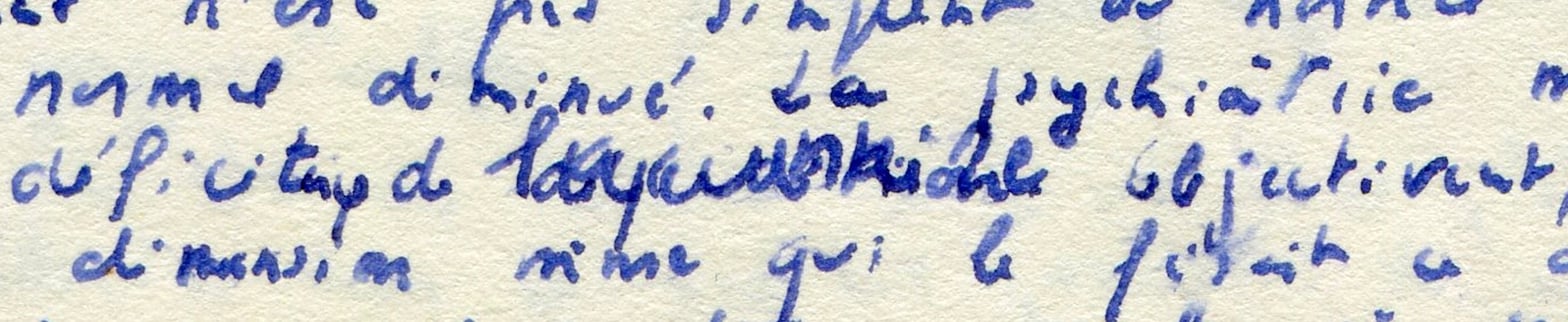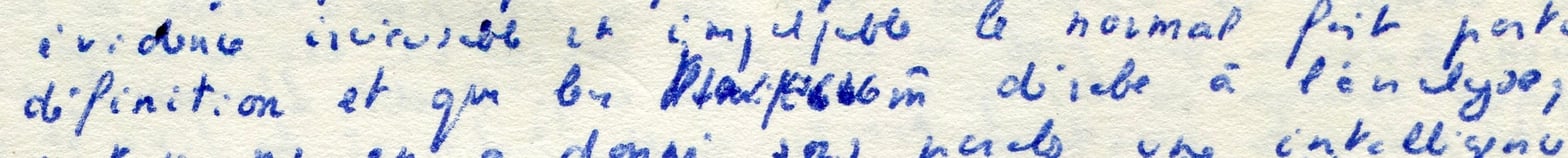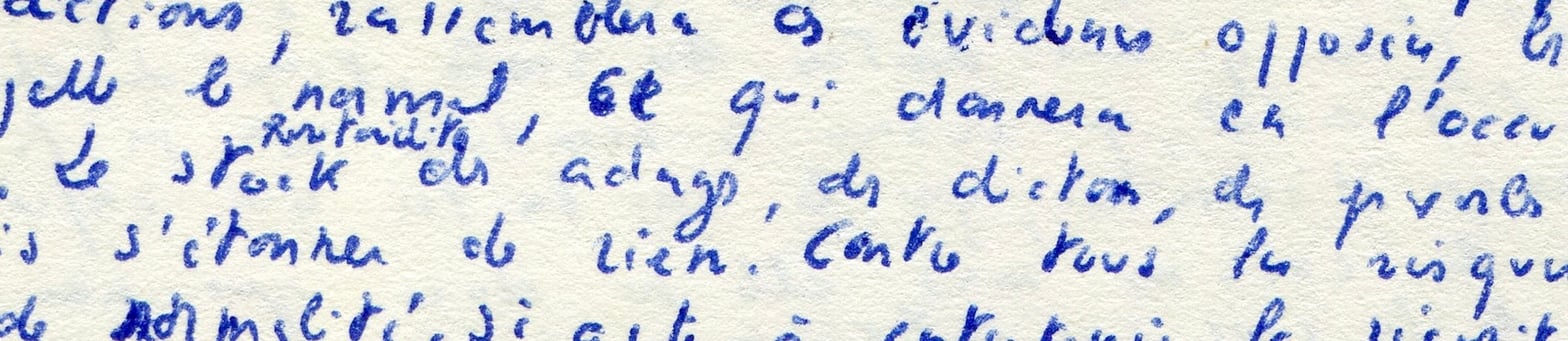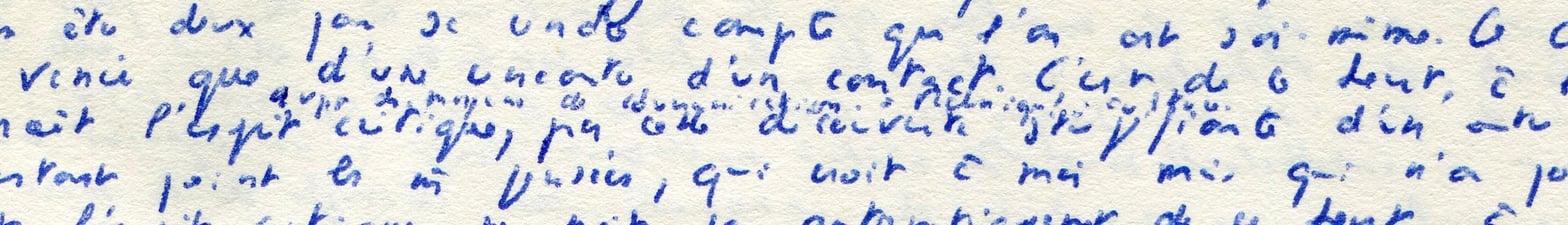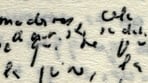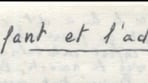Le normal (pages 1, 2, 3)
"Le normal" (pages 1, 2, 3). Vérification en atelier au lycée Louis-le-Grand le jeudi 13 février 2025


Nous employions à l’instant le terme d’élément : il est en effet particulièrement apte à définir l’être même de la normalité, qui présente bien toujours quelque chose d’atmosphérique, de non situable. C’est le sens ambiant, imprégnant de toutes choses, comme une totalité inanalysable, une globalité. [Le normal, ce diffus : on ne diffuse que du diffus ! on ne saurait l’isoler pour le considérer à part. On est à l’intérieur de lui. Lui faire face revient à se mettre hors de lui, et c’est une situation déjà aliénante. Analyser le normal, c’est l’effilocher, si une maille saute, tout file.] Aussi l’anormal n’est pas simplement du normal auquel il manquerait quelque chose, une pièce quelconque. Ce n’est pas du normal diminué. La psychiatrie moderne ne considère plus le pathologique comme un simple phénomène déficitaire de la [psyché].
Objectivement, tout peut paraître intact dans l’anormal : il a perdu simplement cette dimension même qui le faisait ce qu’il était. Ainsi une pratique anormale peut être en un certain sens, aussi complète que la même pratique normale qu’elle imite. Elle la mime intégralement, mais à vide, de la même manière que des illuminés peuvent, avec un rituel minutieusement élaboré, sacrifier aux rites secrets d’une religion abracadabrante. Seulement leurs actes n’ont pas de contenu, pas de sens, pas d’effectivité. L’anormal, c’est donc du normal qui s’est vidé de sa substance, qui ne consiste plus qu’en un dehors coupé de tout dedans. Ainsi le dément qui se prend pour Napoléon est tout entier dans ses postures et ses mimiques parodiques, à l’extérieur de lui-même. Il ne joue pas un rôle, ce qui implique encore un minimum de lucidité, il est joué par son propre personnage. L’anormal ne serait-ce donc pas l’envers même du normal ? du normal, mais en creux, en négatif ? ce qu’est à une œuvre le pastiche de l’œuvre ? Pasticher du tragique, comme on sait, revient à le rendre comique. N’est-ce point pour cette raison que les histoires de fous font cruellement rire ? Le distrait, le somnambule ne sont-ils, comme le remarque Bergson, des sujets éminemment risibles, pour cette raison que leur être est séparé de leur agir, et qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. Tout devient anormal et risible, dès lors que le signifiant s’absente de tout signifié. J’ai eu une absence, comme on dit si bien. Quelqu’un qui parle au téléphone derrière une cloison vitrée et dont on ne voit que les gesticulations, les mines, paraît comique dès lors qu’on ne sait ce qu’il dit. L’anormal, c’est du normal dont l’essentiel, c’est-à-dire l’enjeu, a été mis entre parenthèses. Est tragique toute situation où des fins sont privées de moyens, est comique toute situation où des moyens extrêmement minutieux, méticuleux ne s’agencent pour aucune fin. Ainsi un schizophrène accomplit avec soin des actes dont il a oublié le pourquoi. Beaucoup d’histoires drôles nous proposent l’absurdisme d’une vision schizophrénique. Je ne sais pas nager… moi non plus et je n’en fais pas une histoire. De même les gestes de l’équilibriste ne sont-ils perçus que comme de grotesques contorsions si l’on oublie le simple fil qui le sépare de la mort. Qu’est-ce que le normal, sinon cette assiette, cette assise, cet ancrage, cette position de toutes choses sans laquelle il n’est pas possible de prendre position. On vit donc dans le normal comme dans l’air qu’on respire, sans le ressentir comme tel. Le normal, c’est ce qui n’a pas besoin d’être saisi pour être, ce qui va sans dire, ce dont tout discours tire son origine mais qui ne saurait lui-même être mis en discours. Le normal, c’est ce que l’on comprend sans avoir besoin de l’expliquer, alors qu’on pourrait dire, en revanche, de l’anormal, que c’est ce que l’on explique sans pouvoir le comprendre.
Rien, disions-nous en commençant, n’est plus facile que de définir le normal. Il nous apparaît à présent que dans son évidence irrécusable et impalpable le normal fait partie de ces notions qui résistent à toute définition et que leur [transparence même] dérobe à l’analyse, « parce que, déclare d’eux Pascal, la nature nous en a donné sans paroles une intelligence plus nette que celle que l’art nous acquiert par ses explications ». Voir la lumière : folie. Il n’est pas normal de s’interroger sur le normal. Élément même de notre vie, le normal serait comme cette lumière à travers quoi nous voyions mais que l’on ne saurait voir elle-même. Le normal, en première et dernière analyse, ce serait donc tout ce qui va sans dire. Seulement, de ce qui va sans dire, avons-nous le droit, sauf imposture, de faire la condition même de ce que nous disons ? Quand nous affirmons, en présence de quelque fait, c’est normal, ne sommes-nous pas les dupes d’une opaque et trompeuse intelligibilité ? N’apportons-nous pas simplement, d’emblée, une réponse qui n’est faite que pour nous dispenser de poser une question ? Et ne sommes-nous pas ici au degré zéro de la rationalité ? Les catégories de la mentalité primitive sont si souples et vagues qu’elles peuvent de leur brouillard conceptuel recouvrir quoi que ce soit. Tel est bien (l’)effet de la notion de Mana. S’il faut en croire Lévi-Strauss, quand le primitif recourt au Mana pour rendre compte de quoi que ce soit, il ne fait pas appel, comme les ethnologues le prétendaient, à quelque puissance surnaturelle que l’on pourrait assigner comme origine de tous les faits naturels, de telles idées, en effet selon Levi Strauss, une semblable bipartition du réel, sont déjà beaucoup trop élaborées, en fait mana serait simplement synonyme de machin, de truc. C’est à cause du mana signifierait donc en fait : c’est comme cela. Le normal, n’est-ce pas notre mana ? Qu’un homme ait de la reconnaissance envers son bienfaiteur, nous trouverons cette attitude normale, mais qu’il lui témoigne du ressentiment, car le service qu’on lui a rendu fait de lui un obligé, nous jugerons cela tout aussi normal. Normal que les hommes se dévouent les uns aux autres, mais normal aussi que chacun s’occupe d’abord de sa propre personne. Et le sens commun, imperméable aux contradictions, rassemblera ces évidences opposées, les confondra dans cette même pâte amorphe et molle que l’on appelle le normal, ce qui donnera en l’occurrence : charité bien ordonnée commence par soi-même.
Le stock [héréditaire/hétéroclite] des adages, des dictons, des proverbes dont dispose le sens commun lui assure de ne jamais s’étonner de rien. Contre tous les risques il n’est donc pas de meilleure assurance que la notion de normalité, si apte à entretenir la sécurité et finalement à prolonger le sommeil. Cette normalité qui permet à une pensée de se protéger de toute réflexion, Hegel dans la préface de la Phénoménologie de l’Esprit la désigne et la dénonce du nom de bien-connu. Ce qui est bien connu, écrit Hegel, n’est jamais bien connu. Et en effet, quand nous nous référons à ces idées toutes faites que nous croyons posséder par devers nous comme la clef de toute compréhension, notre connaissance ne progresse en rien, ne s’accroit nullement et c’est contradictoirement à l’implicite que nous demandons le secret de toute explicitation. N’est-ce pas ainsi que procèdent, chez Platon, les interlocuteurs de Socrate ? Qu’est-ce que la justice, ou le courage, mais quoi de plus normal, ne savons-nous pas ce que c’est ? Réfléchir, c’est soulever le couvercle de cette normalité.
Quel est cet homme normal, qui n’a que des idées normales ? L’homme normal, estimera-t-on, c’est l’homme moyen, l’homme qui pense comme tout le monde, l’homme qui porterait en lui la forme de l’humaine condition. Tous parlent à travers ce qu’il dit. C’est n’importe qui. Étant n’importe qui, ce n’est plus personne, c’est le délégué anonyme de l’impersonnalité collective. En langage heideggerien, ce n’est pas un Je, c’est un On. Épris de toutes les conventions, il est lui-même un personnage de convention. Il n’existe pas, car il serait tout de même anormal qu’un homme puisse être aussi normal, mais tout le monde croit qu’il existe. Chacun se figure que l’autre est cet homme normal, et chacun tente alors de se conformer à cette normalité qu’il croit être celle des autres. Se mettre en évidence, n’est-ce pas le plus grand risque <?> Allons, s’écrie excédée la mère à son enfant : ne te fais donc pas remarquer. Mais, puisque cette normalité, chacun d’entre nous la prête à l’autre, ce terrain d’entente ne résulte-t-il pas somme toute de cet immense malentendu, de cet imbroglio qu’est le social ? N’y a-t-il pas tant de choses que nous ne pensons les uns et les autres que parce que nous supposons tous qu’autrui les pensant nous devons les penser nous-mêmes ? Tels sont bien les pièges du conformisme : tous y sont dupes de tous. Comme dans certaines histoires de fou, chacun croit que c’est l’autre qui lui a dit de faire ce qu’il fait et comme dans certaines intrigues de vaudeville, tous continuent, [comme] à la guerre, parce que chaque camp suppose que c’est l’autre qui a commencé. « Qui, demande Pascal, débrouillera cet embrouillement ? » Pour se disculper, car il n’y a pas de plus fantastique alibi que le normalité, l’homme normal sera tenté de dire : ce n’est pas moi, ce sont les autres. Ne suis-je pas contraint de faire comme les autres ? Il n’y a pas de méchanceté en moi, je suis bon, mais il y a les autres, comme nous serions bons si nous étions seuls ! Et je dois tenir compte des autres, ce sont des égoïstes, il faut que je m’assure contre leur égoïsme, que je réprime tous les louables sentiments que je porte en moi, et chacun en juge de même dans ce mélange inextricable de bonne foi et de mauvaise foi qu’est notre normalité. N’est-ce pas cette procédure pseudo-logique qui vicie, brouille, corrompt à la base enquêtes et questionnaires collectifs ? Interrogé, chacun répond non ce qu’il pense, mais ce qu’il pense que pensent les autres. Votez utile, lit-on sur certaines affiches électorales : ce qui signifie, ne votez pas pour qui vous aviez l’intention de voter, ne suivez pas votre idée, ne perdez pas votre voix, choisissez le candidat de la moyenne, du juste milieu, celui que les autres ont déjà choisi de choisir, de peur d’avoir le pire ne vous portez pas vers le meilleur. Ainsi, en tous domaines, nos suffrages vont, indirectement, obliquement, par voies détournées et labyrinthiques, vers ce qui n’a au fond la préférence de personne. Ou plutôt, il ne s’agit justement que d’une préférence. Craignant d’aller vers ce que nous aimons — qui ira jamais dire que l’amour est normal ? L’amour est outrancier, absolu, hyperbolique — nous nous rabattons, nous nous concentrons vers ce qui nous apparaît encore préférable au pire. Préférer n’est pas aimer.
Cette médiocrité, n’est-elle pas l’image même de la normalité sociale ? Ce qui est normal se tient prudemment à égale distance des extrêmes. Le bien absolu n’est pas plus normal que le mal radical. Il n’est pas normal de ne penser qu’à soi, il n’est pas normal de ne penser qu’aux autres. Au reste, trop de dévouement est socialement aussi préjudiciable que trop d’égoïsme. L’homme moral, qui dénonce les scandales est pour la collectivité aussi redoutable, par le chaos et l’anarchie qu’il risque d’entraîner, que le hors-la-loi qui enfreint ses règles. « L’humanité, disait Valéry, ne vaut que par les extrêmes mais elle ne dure que par les moyens ». L’homme normal, ce pilier de l’ordre, est le produit de la ruse sociale. Ce besoin de stabilité, de sécurité, de tranquillité, cette mise à l’abri de toute surprise dont ne nous assure pas le concept de normalité, ne constituent-ils pas l’exigence fondamentale de toute société ? Conserver, se conserver, tel est le mot d’ordre de tout groupe. Et ce mot d’ordre est d’ordre à tous les sens du terme. L’ordre, voilà le Dieu collectif. Normaliser, c’est toujours faire rentrer dans l’ordre. C’est pourquoi l’anormal est si péjoratif. Tout ce qui est anormal alarme, éveille la suspicion, qu’il soit anormal en bien ou en mal. Trop poli pour être honnête. Trop beau pour être vrai. La normalité nous place perpétuellement en état de soupçon. C’est que la société a à la fois besoin et peur de l’individu. Il lui a bien fallu, pour les besoins de sa technique, de ses travaux, inventer l’individu et sa spécialisation, son initiative irremplaçable, mais aussi bien la notion d’individualité porte en elle le remède à ses propres excès. Rien n’est plus banal que de ne pas être banal. Nous avons au moins ceci de désindividualisant que nous sommes tous pareillement des individus. Comme Sartre l’a montré dans un article de Situations III sur la mentalité américaine, le conformisme et l’individualisme ont fatalement partie liée. Soyez vous-mêmes devient un impératif collectif. Pour mieux développer leur personnalité, les midinettes adoptent toutes la coiffure de la même star. La publicité ne manque pas d’utiliser cette astuce : Vous Madame, dit la réclame. C’est pourquoi sur le chemin qui va du collectif au personnel l’individualité n’est encore qu’à mi-route. Cette normalité que nous venons de décrire, il est clair qu’elle consiste tout entière en un phénomène d’aliénation. Et toute aliénation est toujours une double aliénation, ce qui signifie que l’aliénant est lui-même aussi aliéné que ce qu’il aliène, si tant est, comme le montre Marx, que dans un système oppressif, les bourreaux aussi sont leurs propres victimes. Les ruses de la société que nous évoquions tout à l’heure n’en appellent à aucun machiavélisme transcendant. Elles se font toutes seules. N’allons pas, à la façon durkheimienne, concevoir la société comme une sorte d’entité, de puissance magique qui, par-delà les individus, aurait ses intentions et ses projets propres. Il n’y a pas de manigances de la société en tant que telle, et la notion de conscience collective dont participeraient les consciences individuelles n’était dans le positivisme sociologique qu’une survivance magique. La société, telle que nous la subissons, n’est l’ouvrière de l’aliénation que parce qu’elle en est le produit. Il en va de la société comme de l’histoire : nous ne sommes pas simplement aliénés parce que nous les subissons, nous sommes aliénés parce que ce que nous subissons n’est autre que ce que nous faisons. Ce que nous vivons selon le mode de la nécessité, c'est notre propre liberté. Ainsi cette croyance en un homme normal qui servira si bien l’emprise collective, c’est nous tous qui en sommes les auteurs. La tyrannie sociale n’est rien d’autre que la glu où nos libertés ne se sont prises que parce qu’elles l’ont elles-mêmes sécrétée. Chacun se conforme à l’idée que chacun estime que chacun se fait de chacun. Quand l’aliénation est totale, il n’y a plus d’aliénant, il n’y a que des aliénés.
À ce moment de notre dialectique, le normal est tout entier passé dans l’anormal. Rien n’est plus anormal que la normalité dont nous sommes pris au piège. Le comble de la folie, n’est-ce pas de ne jamais douter une seconde qu’il puisse y avoir quoi que ce soit de fou en soi ? L’aliénation, en ce sens, ne signifie pas du tout la menace de l’autre, car c’est déjà être aliéné que de considérer l’autre comme une menace, et qu’est-ce qui peut nous désaliéner sinon précisément autrui, qu’est-ce qui peut soigner le malade sinon le médecin, l’aliénation signifie l’absence de l’autre. Être aliéné consiste à ignorer l’altérité. C’est ce que font les sociétés primitives. Il ne leur vient pas à l’idée qu’il puisse y avoir d’autres rites que les leurs, d’autres dieux que ceux qu’elles vénèrent. Aussi vivent-elles dans la prison du mythe. Le mythe, c’est la solitude du logos. Tant qu’on est seul, comment savoir que l’on a raison ? Il faut au moins être deux pour se rendre compte que l’on est soi-même. Ce choc qu’est la raison ne pourra donc venir que d’une rencontre, d’un contact.
C’est de ce heurt, comme l’ont montré les sociologues, que naît l’esprit critique [développement des moyens de communication : technique, lois, culture], par cette découverte stupéfiante d’un autre homme qui pense comme moi et qui n’a pourtant point les mêmes pensées, qui croit comme moi mais qui n’a pourtant pas les mêmes croyances. Seulement l’esprit critique ne naît pas automatiquement de ce heurt, comme du feu jaillit du frottement de deux cailloux. La rencontre avec l’autre prend d’abord la forme d’un refus. Socialement, la première façon de converser, c’est de se faire la guerre. Une culture ne s’assure de sa normalité qu’en niant celle des autres. Il est clair qu’il n’y a pas d’anormalité en soi. L’anormal n’existe qu’en fonction du normal. Mais plus profondément, c’est le normal lui-même, dans cette relation dialectique, qui n’existe qu’en fonction de l’anormal. Le normal invente l’anormal pour se confirmer dans sa normalité. Puisqu’ils sont anormaux, c’est donc que nous sommes normaux. Ce n’est que parce que les autres ont tort que nous sommes susceptibles d’avoir raison. L’anormal ne serait donc tel que par le réflexe de défense qui le repousse et l’exclut, qui l’écarte décisivement du champ de validité d’une raison qui s’établit comme le nous d’un groupe, d’une civilisation posée en s’opposant à ce qui n’est pas elle. Il n’y a disait S. Weil qu’une chose qui soit plus haïssable que le moi, c’est le nous. Le nous a beau se dilater et s’étendre, ce n’est jamais qu’un je agrandi, durci, consolidé, incapable de se promouvoir en universel. Le nous, de par son essence, est exclusif. Limitatif, il trace des frontières. Nous, c’est nous autres, c’est une enceinte. Mais n’est-ce pas aller à contre-courant du mouvement même de la compréhension que de retrancher la raison dans une sorte de forteresse culturelle ? Une raison qui écarte l’irrationnel et le chasse au dehors de soi, c’est une raison qui se referme et s’isole elle-même, c’est à dire accomplit le geste même de la folie dans le moment même où elle essaie de s’en protéger. L’irrationnel n’est-il pas de voir partout de l’irrationnel ? Est-il normal de tenir pour anormal tout ce qui n’est pas soi ? En sorte que la raison qui institue pour la détacher de soi et consolider sa propre intégrité la notion de déraison se change elle-même du même coup en déraison ; et cette folie qu’elle croit bannir de soi elle la loge en soi-même. Il ne serait pas inutile d’examiner les rapports très divers qu’une normalité culturelle peut entretenir avec ces anormalités que lui paraissent les autres cultures. Ces relations parfois s’assouplissent, et il arrive au rejet de prendre l’apparence d’un accueil. Ici l’on étudierait les mythes de l’exotisme. Tout ce qui est inquiétant devient vite fascinant. L’autre alarme, mais il intrigue aussi. On a envie de connaître, de voir ceux que l’on a mis de l’autre côté de la barrière. Une culture s’enquiert des autres avec cette sorte de joie frissonnante que l’on ressent à s’acoquiner avec des individus louches ou encore à visiter un asile.