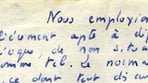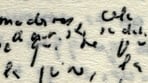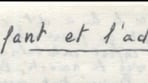Philosophie et humanisme
Transcription par Béatrice Ducroux, revue en atelier le 5 décembre 2024


Chers amis d’Hubert Grenier,
Vous recevez ce mail car vous avez manifesté de l’intérêt pour le travail sur les manuscrits d’Hubert Grenier. Je me suis permis de vous inscrire à cette lettre d’informations consacrée uniquement à partager avec vous les progrès de la transcription à laquelle certaines et certains d’entre vous participent activement.
Aujourd’hui, nous avons revu en atelier la transcription d’un cours intitulé “Philosophie et humanisme”. En voici la transcription intégrale, ainsi que la dernière page du manuscrit, sur laquelle demeurent quelques doutes. Si vous apercevez une erreur, merci de nous la signaler en commentaire !
Amitiés
Ollivier

Philosophie et humanisme
Pourquoi cette première série de leçons ? Eh bien, elles nous permettront, sur un exemple précis — le débat sur la définition, le sens, les limites de l’idée d’humanisme —, de commencer à comprendre en quoi peut et doit au juste consister la tâche de la philosophie. Cette tâche, en préliminaires, l’éclaircir. Cette tâche, le long des époques, demeure et demeurera la même. Car, au travers même de la variété, de la succession des philosophies, il existe une permanence de la philosophie. Les philosophies sont diverses, mais la philosophie est une. Une, non pas dans son contenu, dans ses thèses — et heureusement, car s’il n’y avait qu’une philosophie, il n’y aurait plus de philosophie, et une philosophie définitive, ce serait à tous les sens de ce terme l’achèvement de la philosophie, n’ayons donc pas la naïveté d’attendre un système ultime qui dénouerait toutes nos difficultés, quelle triste vérité ce serait qu’une vérité qui nous dispenserait de réfléchir, mais une vérité se reconnaît à ceci qu’elle nous en fait trouver d’autres. Chaque philosophie voudrait être la philosophie, et ne le peut. La philosophie = les philosophies. Allons plus loin, toute idée si elle est féconde porte en elle, appelle son propre dépassement, c’est pourquoi penser, c’est contester, le scepticisme, assurait Jules Lagneau, voilà notre pain quotidien assuré, bref, penser, c’est n’en n’avoir jamais fini avec ce que l’on pense —, la philosophie est une dans son entreprise même, son dessein, qui est de rendre compte d’une expérience, qui est de porter le vécu au niveau du sens. Le philosophe, disait Merleau-Ponty, c’est l’homme qui s’éveille et qui parle. S’éveiller, cela suppose que l’on était endormi. Et l’on est toujours endormi, le sommeil, la torpeur, tel est, si l’on n’y pense, notre état normal, l’état de notre machine assujettie à toutes les puissances de l’intérieur et de l’extérieur, je veux dire de l’humeur et de l’opinion. L’on est endormi, lors même qu’on croit le moins l’être. L’éveil, ce n’est pas un état, c’est un acte, à toujours renouveler, ce n’est pas une réalité, c’est une réalisation, toujours précaire et provisoire. Votre rêve, demandait-on à Valéry. Mon rêve ? me réveiller. Se réveiller, c’est se secouer. C’est secouer les préjugés, les habitudes, les dogmes de toutes sortes. Aussi n’y a-t-il de philosophie que critique. La fonction de la philosophie est d’abord de vigilance, de mise en garde. C’est la raison pour laquelle elle ne plaît pas, et n’a pas à plaire. Elle n’est pas là pour apaiser, consoler, réconforter. (On ne se gave pas du vrai. Asile / Aimer la vérité.) C’est pourquoi souvent le philosophe apparaît comme un intrus, un trouble-fête. Il rappelle à l’ordre, il nous invite à juger nos enthousiasmes, à dominer nos ivresses, à nous demander si ce que nous sommes est réellement conforme à ce que nous voulons être, si tous les succès dont nous sommes si fiers méritent vraiment le nom de succès. La philosophie, c’est avant tout notre examen de conscience. Cf Gorgias p. 488. Elle est donc prise de conscience (cf. peur), effort et mécontentement et inquiétude, comme la conscience. En quoi elle exprime si bien l’homme, cet être étrange que ses triomphes mêmes laissent insatisfait.
On ne s’étonnera donc pas que la philosophie, cette importune, soit l’objet de tellement d’attaques et de sarcasmes. De tous côtés, elle se voit contestée. Elle fait contre elle l’union des positivistes et des théologiens. Science comme religion entendent l’évincer. Et s’il est vrai que la philosophie est en état de crise, son existence même, ses institutions sont aujourd’hui menacées. Mais y a-t-il lieu de s’en affliger ? Remarquons qu’il en a toujours été ainsi. Les diatribes contre la philosophie sont aussi vieilles que la philosophie elle-même. Cf. Gorgias p.428. Et la mort de Socrate. Notre père. Nous sommes les disciples d’un maître qui a été bafoué, nous sommes les enfants d’un père qui a été tué. Et notons surtout qu’il est bon qu’il en soit ainsi. Le pire, pour la philosophie, ce serait d’être tolérée, et même fêtée, révérée. Offrir au philosophe dans la cité une place de choix, ce serait une manière de le tenir en laisse. Ainsi Denys le Tyran a voulu faire avec Platon, Frédéric avec Voltaire, de telles aventures se terminent toujours mal. Merleau-Ponty faisait observer avec raison que le triomphe de la psychanalyse n’avait pas été entièrement bénéfique pour elle. Vulgarisée, admise par tous, la psychanalyse perdait de son mordant, de sa virulence, elle risquait de s’affadir, de se banaliser, nous risquions d’être moins sensibles à son pouvoir de démystification. Puisse la philosophie continuer longtemps à inquiéter. Et puis, Bachelard nous l’a appris, critique est un adjectif dont le substantif est crise. Une philosophie critique doit être aussi une philosophie en état de crise. La crise, en tous domaines, est un signe de vitalité, de santé. Il n’y a que les cadavres qui ne soient plus menacés de crise. En somme, d’être contestée, mise en cause, la philosophie ne le craint pas, elle le réclame. C’est la preuve qu’elle est présente, agissante. S’en prendre à la philosophie, c’est encore faire le jeu de la philosophie, c’est s’intéresser à elle, se mettre à son niveau, entrer dans ses soucis. Sur ce point, Pascal, ce grand anti-philosophe — mais il est une anti-philosophie qui est comme le sel de la philosophie —, Pascal a tout dit. « Se moquer de la philosophie, a-t-il écrit, c’est encore philosopher. »
Au terme de ces quelques considérations, qu’il était bon de rappeler, nous retiendrons que si la tâche de la philosophie est de vigilance, de rappel — le philosophe n’est pas un propagandiste, un prophète, je n’ai, dit Jaspers, nul message à vous apporter ; Socrate n’imposait aucune doctrine, il ne faisait pas de porte à porte, ce n’était pas un placier en métaphysique, à chacun il disait : pense ce que tu veux, mais es-tu sûr de réellement penser ce que tu penses ? Il n’était pas l’homme d’une philosophie, mais l’homme de la philosophie — si donc la tâche de la philosophie est de vigilance, cette vigilance doit d’abord s’exercer à l’égard du langage. Rappelez-vous le mot de Merleau-Ponty : le philosophe, c’est l’homme qui parle. Tout homme dès qu’il parle est prêt pour la philosophie. En ce sens, toute philosophie est d’abord philosophie du logos. Le philosophe, c’est l’homme du logos. C’est, en effet, par le logos que tout prend sens. Tandis que l’impression, c’est l’animalité, dans l’impression, on coïncide avec soi, on ne fait qu’un avec soi, et avec toutes choses, par le sentir, qui nous immerge dans les choses : cf inconscience, torpeur, l’univers se répercute sur nous. Un rayon de soleil et l’oiseau chante. Son chant, c’est une réaction mécanique. Cf. Alain : ce n’est pas l’oiseau qui chante, c’est la nature. Tout autre le chant humain : l’homme peut chanter quand la nature ne chante pas, quand il fait froid. Noël, dit Alain, est une fête de l’esprit, une fête parlée. Parler, c’est annoncer. Puissance du langage. Tant on a chanté Noël, qu’à la fin il est venu. Qui parle sort de la prison naturelle. L’impression, c’est l’animalité, l’expression, c’est l’humanité. L’impression est solitude, ce que je sens, je suis seul à le sentir, l’expression est universalité. Parler, c’est sortir de soi. Ce que je dis, je le propose, ce n’est plus moi seulement qui le dis ; ne serait-ce que quand je dis moi, j’énonce tous les moi. Parler, c’est communiquer. Ainsi le singulier, par l’opération de la parole, se promeut en universel. « Cette voix, dit Hegel, qui se connaît, quand elle sonne, n’être la voix de personne. » Toute vérité n’est pas bonne à dire : c’est idiot. Il n’y a de vérité que dite. Seul ce dont on parle devient une réalité. C’est encore Hegel qui nous a le mieux appris cela. Non dite, la chose n’est que chaos. Si nous ne parlions pas, le monde serait plus flou, plus irréel qu’un rêve. Cf. le début de la Phénoménologie. « C’est la nuit maintenant. » La nuit qui descend, une bouffée de concret. N’est-ce pas la sensation, cette richesse inépuisable, qui nous fait saisir, comme toucher du doigt, toute la singularité de l’ici et du maintenant, qui nous met en communication avec la plénitude de l’être ? Et pourtant, tant que nous ne les avons pas nommés, tant que nous ne les avons pas désignés, tant que nous n’avons pas dit ce que c’était, ce maintenant et cet ici n’ont aucun contenu, ils ne sont rien parce qu’ils ne se distinguent de rien. Quoi, à y réfléchir, de plus abstrait, au sens péjoratif du terme, que ce prétendu concret, quoi de plus banal que le ceci sensible ? Sa profusion apparente se dissipe dans une totale et perpétuelle confusion. Ici, mais c’est partout ici, maintenant, mais c’est tout le temps maintenant. Comme dit Hegel, le pur être est parlé. L’homme qui parle se voit donc investi de la charge de tout.
Mais s’il n’y a de vérité possible que par la médiation de la parole, et cet art de l’énonciation s’appelle la logique, il ne faut pas oublier que de ce par quoi vient la vérité peut aussi venir l’erreur. Telle est notre condition : nous ne saurions nous mouvoir dans le vrai comme dans quelque élément. Si toute pensée, si tout logos étaient forcément vrais, à cette vérité nous serions purement et simplement déterminés, notre langage ne se distinguerait en rien de quelque fonction animale, on dirait vrai comme on respire, une pensée fatalement vraie ne serait donc plus une pensée du tout, si tant est que penser, c’est faire effort de penser, douter, critiquer, si tant est, comme disait Lagneau, que réfléchir, c’est se demander si ce qu’on pense on a le droit de le penser. Mais, dans ces conditions, le langage apparaît comme une arme à double tranchant. Ce qui dit le vrai peut aussi dire le faux. Il ne dit le vrai qu’à la condition de pouvoir dire le faux. Or, ce faux, il peut le dire délibérément, volontairement, le langage alors devient mensonge, tromperie. Ce mensonge, n’est-ce pas une étonnante marque de puissance ? Dire le faux, n’est-ce pas, en un bouleversant pouvoir, bouleversant à tous les sens du terme, être capable de subvertir l’ordre des choses, de donner réalité à ce qui n’en n’a pas, de conférer être au non-être, et inversement non-être à l’être, puisque le vrai se trouve nié ? Allons plus loin : si l’erreur est possible, n’est-ce pas du même coup la vérité qui se trouve disqualifiée ? Quelle est cette étrange vérité qui n’a pas le pouvoir de se faire reconnaître ? Rien donc, par suite même de l’existence du langage faux, ne saurait plus être vrai. Seulement, attention. S’il n’y a plus de vérité, par là-même, en un retournement dialectique, c’est l’erreur du même coup qui cesse d’avoir raison d’être. Si tout est faux, rien ne peut plus être dit faux. Simples jeux de langage, tout cela ?Non, il faut des philosophes qui virent dans ces pièges du langage le moyen aussi de pouvoir attraper les hommes au piège. Ces philosophes, ce furent les sophistes : Protagoras, etc. Comment se développait leur doctrine ? Résumons-la. S’il est exact qu’à chacun sa vérité, s’il n’y a par conséquent de science que la sensation, le malade en proie à la fièvre, qui grelotte quand les autres ont chaud, a raison, de même que les autres ont raison, et il n’est pas possible de nous départager. Tel est le relativisme sceptique où aboutissait la pensée des sophistes. D’où également elle prenait tremplin. Ce néant de la vérité offrait, en effet, aux menées des sophistes le plus robuste appui. Sur les ruines du savoir, ils croyaient être à même de fonder les triomphes de l’action. Car tout désormais va être permis à l’homme qui parle, à l’homme qui sait parler, à l’homme qui dispose de l’unique science qui a survécu aux autres, la rhétorique. Et les sophistes vont enseigner l’art oratoire. Si tout est à la fois vrai et faux, l’homme qui ment, du moment qu’il n’existe plus de critère de la vérité, qui sera capable de le démentir, qui le prendra en flagrant délit ? L’homme qui parle bien saura faire naître chez autrui les sentiments, les sensations qu’il voudra, s’il n’y a plus de démonstration possible, l’homme qui sait persuader aura les mains libres. Davantage. Le langage s’étend à toutes choses, l’homme qui parle bien peut parler de n’importe quoi, de ce fait le virtuose de la rhétorique est omniscient. C’est toujours lui qui l’emportera devant une foule. Il surpassera un chef d’armée s’il s’agit de débattre de projets militaires, un agriculteur s’il s’agit de problèmes agricoles. Aussi les sophistes ouvraient-ils des écoles d’éloquence, où se pressaient les jeunes Athéniens, ambitieux et avides de succès politiques.
L’adversaire des sophistes, ce fut Socrate. Socrate se fait le défenseur des mots. Socrate entend rendre au langage cette dignité que les sophistes ont avilie. « Honneur des Hommes, Saint LANGAGE » (Paul Valéry). Socrate, contre les sophistes, apprend à penser, c’est-à-dire à tenir un langage cohérent, à ne pas se contredire, à chercher sans cesse la définition. Qu’est-ce qu’il y a de juste dans la justice, qu’est-ce que le courage, la piété ? Socrate, dit Cicéron, a apporté aux hommes le concept. Socrate, contre les sophistes, montre que les hommes peuvent s’entendre — entendre, cela a donné entendement — et s’entendre, c’est s’entendre sur le sens des mots. Le langage vrai apparaît alors comme la médiation entre les hommes, comme l’unique source de concorde. Pas de morale, si l’on ne respecte pas les mots. « Sache-le bien, en effet, dit Platon, une expression vicieuse ne détonne pas seulement par rapport à cela même qu’elle exprime ; mais elle cause encore du mal aux âmes. » Le monde des sophistes est un monde de guerre, de haine. « Ne devenons pas des misologues, comme il arrive à certains de devenir misanthropes ; car il ne peut arriver à personne pire malheur que de prendre en haine le discours. » (Phédon) Prendre le parti du langage, c’est donc prendre du même coup le parti de l’homme. Justice est fille de justesse. Le philosophe, comme il se voit par Socrate, est le défenseur du langage juste.
Mais le langage, s’il est au service de la raison, est aussi l’instrument de la passion. Rien de plus raisonneur, comme on sait, que le passionné. Le mot grise, électrise, enflamme, tout fanatisme est parlé, ce ne sont pas pour des idées que les hommes tuent ou meurent, ce sont pour des mots. Il y a toute une magie du mot, et si la passion est si redoutable, c’est qu’avec les mots on peut, à la vérité, dire tout ce qu’on veut. Magie du mot, loin que l’expression ne soit qu’une suite de l’impression, c’est le mot le plus souvent qui en nous crée la chose. La Rochefoucauld : « Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux, s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour. » Et Stendhal. Le Comte Mosca (dans la Chartreuse de Parme, dit, en voyant s’éloigner son rival Fabrice en compagnie de la femme qu’ils aiment tous les deux) : « Si le mot amour est prononcé entre eux, je suis perdu. » Tels sont les prestiges du mot, qu’il soit mot de passe ou mot d’ordre. C’est le mot qui a toujours le dernier mot. Il est donc des mots lourds en harmoniques, en résonances infinies. Cf. Valéry (Fluctuations sur la liberté, 1938): « Liberté, c’est un de ces mots détestables qui ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus qu’ils ne parlent ; qui demandent plus qu’ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence ; aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchainent le tonnerre. »
Eh bien, au nombre de ces mots aujourd‘hui prestigieux, il est clair que le terme d’humanisme occupe une place de choix. Quelle philosophie, de nos jours, ne prétend pas être un humanisme ? Chacune voudrait même annexer, confisquer ce terme à son unique profit. Cf. naguère la querelle entre humanisme marxiste et humanisme existentialiste. Telle est la raison pour laquelle la critique philosophique doit étudier de près le sens de ce mot qui suscite tant de débats et de querelles. D’autant qu’il n’est pas sûr que cette signification soit univoque. L’humanisme, dans le marxisme, est-il identique à l’humanisme, chez Sartre ? Est-ce forcément du même homme que parlent les différents humanismes ? Et puis, comme nous le verrons, le mot d’humanisme peut être pris en un sens très large comme en un sens beaucoup plus précis.
Au sens large, serait humaniste toute doctrine, tout programme qui prend la défense de l’homme, qui entend que se développe en l’homme tout ce qu’il a d’humain. Il est évident, en ce sens qui ne fait pas problème, que toute philosophie authentique ne peut qu’être un humanisme. La grande tâche de la philosophie, c’est l’homme. La philosophie, vous le savez, à ses débuts enfermait en elle toutes les sciences. C’était un savoir unique et total. Peu à peu les sciences se sont détachées d’elle et ont conquis leur autonomie. L’immense domaine, le champ de la spéculation philosophique s’est donc trouvé en apparence de plus en plus rogné. Mais la philosophie n’y a pas perdu. Ce qu’elle a abandonné en extension, elle l’a regagné en compréhension. Sa destination s’est purifiée, qui est d’étudier non pas les choses, mais celui pour qui il y a des choses.
Mais n’était-ce point déjà là son origine socratique ? Cicéron : « Socrate a fait descendre la philosophie du ciel sur la terre. » De fait, avant Socrate, la réflexion grecque était captivée par des spéculations théologiques. Thalès, Empédocle, Démocrite s’intéressent à la composition des choses, au jeu, au mélange des divers éléments. Les présocratiques cherchent quelle est la loi de l’univers, son ressort. Est-il régi par une harmonie, un pacte, une loi d’amour, une sorte de connivence, de conspiration entre les choses, comme le pense Anaxagore ? Héraclite, pour sa part, enseigne que le monde ne se tient que par un jeu de contraires qui s’opposent et en même temps se maintiennent par leur opposition même, comme l’hiver, l’été, la vie, la mort, la nuit, le jour. Les Pythagoriciens préfèrent interroger la magie des nombres, arracher à l’arithmologie de fabuleux secrets. Socrate a peu de goût pour de telles spéculations. On peut parler, en ce sens, d’un positivisme de Socrate. Pas de vaine curiosité (pour le) monde, l’univers. Qu’il y ait du vide ou non dans la nature, et la forme des atomes, en quoi ceci concerne-t-il notre destinée ? Marc-Aurèle dira : « Si le monde est divin, c’est bien. S’il va au hasard, ce n’est pas une raison pour installer aussi le désordre en toi. » Avec Socrate, ce qui préoccupe l’homme, ce n’est plus que l’homme. Socrate refuse que la philosophie se cantonne dans l’étude de l’objet, qu’elle soit science ; son domaine, c’est le sujet lui-même, celui qui fait la science. Ce qui passionne Socrate, ce n’est plus la physique, c’est le stoïcien. Mais déjà, vous le voyez, cet humanisme prend un deuxième sens, un sens strict : est humaniste toute théorie qui pose qu’il y a assez dans l’homme pour comprendre l’homme, que les problèmes qui se posent à l’homme peuvent être résolus par l’homme. Cf. Marx : « l’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre. »
Ainsi Socrate. L’homme socratique ne cherche plus à découvrir le sens de sa vie au grand livre du monde, il ne cherche plus son salut dans l’obéissance aux lois de l’univers, il ne se considère plus comme un microcosme qui doit s’affronter à son immense modèle. L’homme socratique se détache du cosmos, sa conscience, c’est sa séparation. Au dehors, il ne trouve ni aide ni obstacle. Il ne se tient que de soi.
Or, il n’est pas douteux que de plus en plus, le long de l’histoire, la philosophie est devenue un humanisme en ce deuxième sens. Bien sûr, nous l’avons vu avec Descartes, la philosophie a toujours eu le sens de son indépendance, de son autonomie. Elle a entendu marquer ses distances d’avec la théologie. Trois solutions : Descartes. Spinoza : la théologie a raison sans le savoir. Malebranche : deux langages différents. Il n’en restait pas moins que cette philosophie restait théocratique. Les problèmes qui se posaient à elle, c’était en Dieu, par Dieu qu’elle s’efforçait de les résoudre. C’était une évidence pour cette tradition philosophique que nous ne pouvons être assurés de rien, si nous ne sommes pas sûrs de l’existence de Dieu. Cf. problème des maths (?). La philosophie classique a pu être définie comme un unique dialogue entre le philosophe et Dieu — Cf. les autres, absents chez Descartes —, dialogue, du reste, comme on l’a ajouté malignement, qui se réduisait à un monologue, puisqu’en fait le Dieu qui parlait au philosophe était le Dieu qui faisait parler le philosophe. Or, après la critique du XVIIIème siècle, ce recours divin a été de moins en moins de règle en philosophie. Davantage, l’homme a pris conscience — Nietzsche et Marx, auteurs si différents, s’accordent sur ce point — que le rôle naguère assigné à Dieu, celui de fondation du vrai, c’était lui qui devait en être investi. Ainsi l’homme selon Nietzsche ne reçoit pas ses valeurs, il ne les lit pas dans quelque ciel métaphysique, c’est lui qui librement les crée et les invente. L’homme, dira Marx, est l’origine de l’homme. Ce XVIIIème siècle, négateur, soulignait l’humanité de la religion, le XIXème visera plus haut : il proposera une religion de l’humanité. Cf. le schéma marxiste. Le prolétariat, figure terrestre du Dieu sauveur et souffrant. Pour l’humanisme moderne, l’homme n’est plus le serviteur de l’être, il devient l’agent de son propre destin.