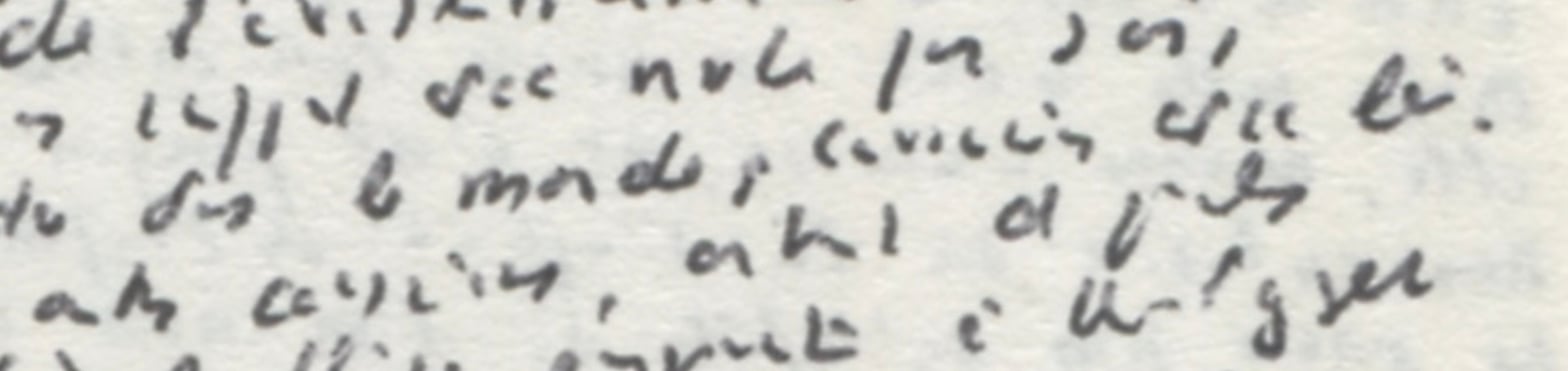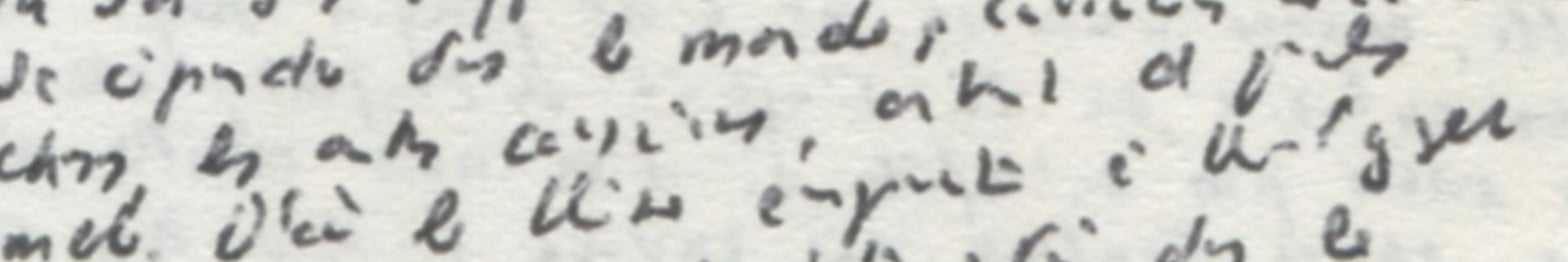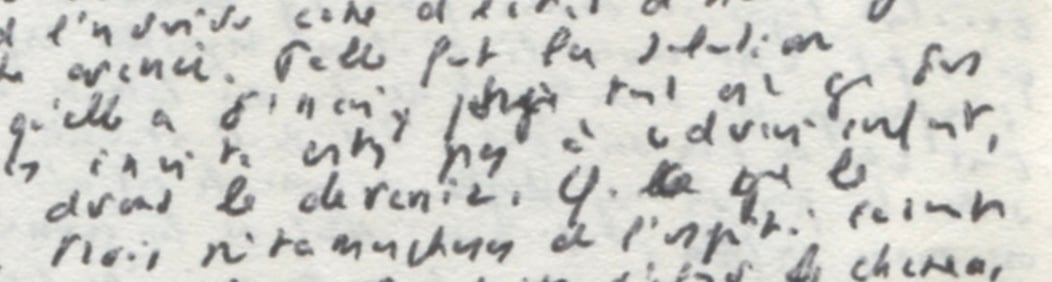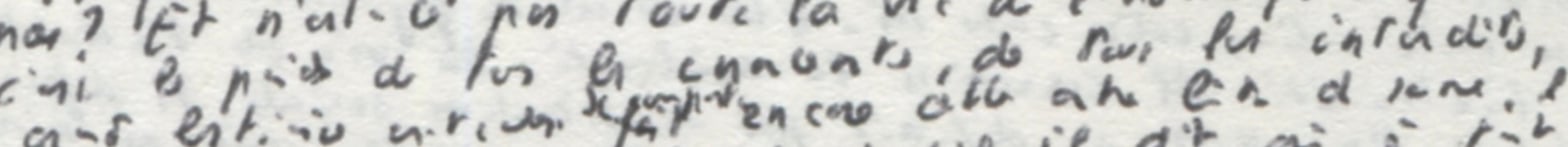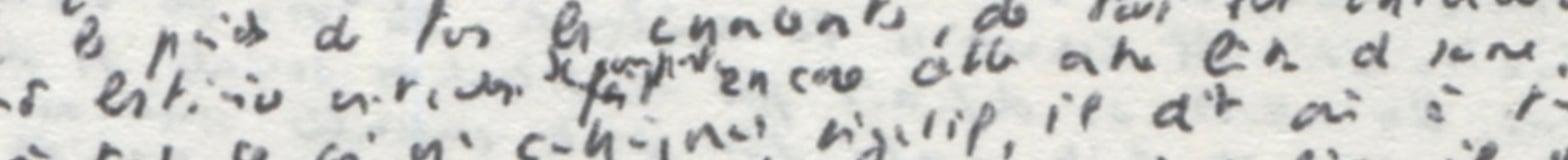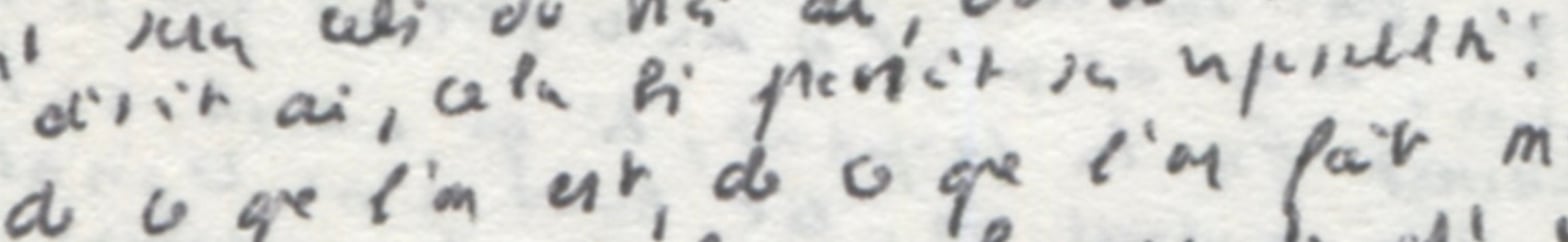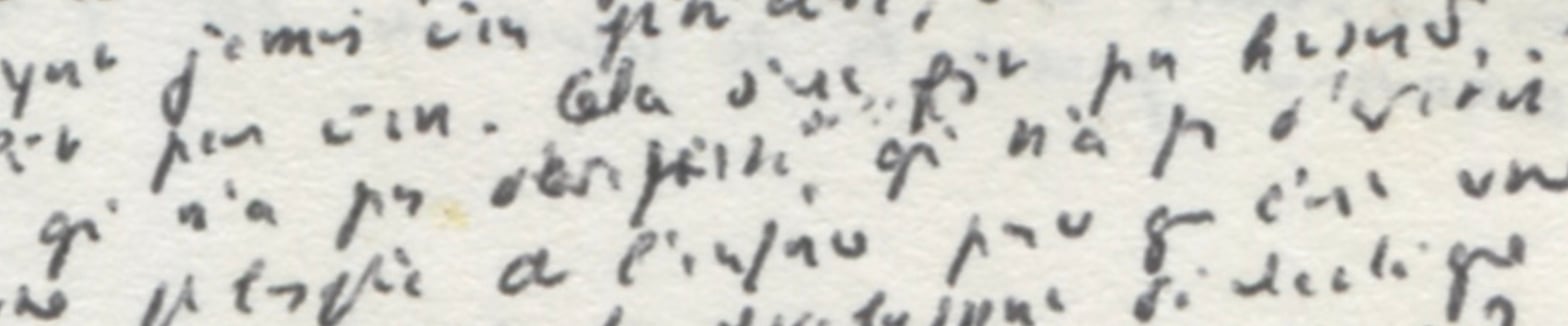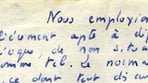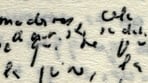L'enfant et l'adulte
Corrigé de dissertation "L'enfant et l'adulte"


Que dire donc sur l'enfant et l'adulte, j'entends qui ait une teneur philosophique, qui ne se réduise pas à une série d'évidences ou de banalités qui, sous cette forme, ne permettraient d'engager aucun débat sérieux ? Comme de dire par exemple que l'enfance joue un très grand rôle dans la formation de la personnalité du futur adulte ou encore que l'éducation doit tenir compte de la personnalité de chaque enfant. C'est souvent la question que je pose à la fin de chaque interrogation orale du vendredi après-midi. D'accord, mais où y a-t-il dans ce propos matière à discussion ? Ce qui permet d'engager une discussion, c'est une thèse. En philosophie il convient de proposer et de développer une thèse, et cette thèse ne sera philosophique, elle ne se distinguera de l'opinion que nous pouvons tous avoir spontanément sur le sujet en question, que si elle prend la forme d'un paradoxe. Un exemple : sur le problème de la valeur du plaisir, est-il bon, est-il mauvais de rechercher le plaisir ? L'opinion, qui aime les avis mitigés, répondra : c'est selon. Tel père, tel fils, mais à père avare, fils prodigue. Il y a des plaisirs bienfaisants et il y a des plaisirs nocifs, nuisibles. Mais lorsque Eudoxe, disciple de Platon, soutient que tout plaisir est bon par nature, il émet une thèse qui est un paradoxe, et de même Speusippe, autre disciple de Platon, qui, lui, déclare que tout plaisir est mauvais, et telles sont les deux thèses que dans l'Ethique à Nicomaque, Aristote, ayant à traiter de ce sujet, commencera par réfuter. Seulement il importe d'y prendre garde, pour éviter de croire qu'il suffirait de rudoyer le bon sens pour tenir un propos philosophique, un paradoxe ne doit pas être confondu avec une absurdité. Ainsi, si Zénon d'Elée avait professé, comme on l'interprète parfois, que le mouvement n'existe pas, il n'aurait proféré qu'une absurdité, et Diogène aurait alors eu raison de se contenter, pour le réfuter et ainsi qu'il s'est imaginé le faire, de marcher devant lui. Non, Zénon s'est proposé de montrer que le mouvement n'est pas intelligible, ce qui est très différent, et suppose l'existence du mouvement, car s'il n'était rien il n'y aurait aucun sens à le dire incompréhensible.
Sur l'enfance donc, ses conséquences pour la vie d'un homme, si l'on voulait chercher une thèse on ne peut plus radicale, on aurait pu l'emprunter à Descartes, auquel vous avez parfois dans les copies fait allusion mais sans toujours en tirer assez parti. Le peu d'estime de Descartes envers l'enfance pourrait être considéré comme typique d'un auteur du XVIIe siècle. L'attention à l'enfant, la faveur qu'il recevra, voire les panégyriques dont il pourra être l’objet, sont modernes. Ce n'est qu'à la lecture de la Nouvelle Héloïse que les jeunes mères de la bourgeoisie ou de l'aristocratie décidèrent de s'occuper de leurs bébés. Longtemps l'enfant fut tenu pour quantité négligeable, cet homme qui n'en était pas encore un ne paraissait pas digne d'intérêt, il n'y avait qu'à le laisser à ses enfantillages. Un philosophe aussi nourri de classicisme qu'Alain écrira à la première ligne de son livre Histoire de mes pensées : « De l'enfance je dirai peu ; car elle ne fut que bêtise. » Insignifiant simplement l'enfant, au regard des gens du XVIIe siècle ? C'est ce que laisserait penser ce propos de Bossuet, rapporté par l'un d'entre vous : la vie de l'enfant n'est que celle d'une bête. Seulement, et voilà qui est beaucoup plus grave que de l'indifférence, on sent percer à travers ce jugement sans nuances de la réprobation. Quand on fait partie du genre humain, on ne devrait pas, même tout jeune, se comporter comme un animal. D'être ce qu'il est l'enfant est coupable. De son irresponsabilité même il porte la responsabilité. En lui il doit y avoir quelque chose de mauvais, de foncièrement mauvais. C'est un être dont il convient de se méfier. Nous avons eu l'occasion de constater la fortune du thème lancé par Hobbes de la méchanceté enfantine. Entre l'enfant et le méchant il n'y aurait, comme le commentait l'historien de la philosophie Goldschmidt, aucune solution de continuité, les méchants étant simplement ceux qui à l'âge de raison continuent de se comporter en enfants. Pourquoi ne pouvait-elle que satisfaire les esprits religieux de l’époque, cette idée que la méchanceté est présente d'emblée, qu'elle est là immédiatement dans l'enfant, en puissance il est vrai et Dieu merci puisqu'il lui manque pour passer à l'acte la force physique, ce qui atténue la nocivité de cet être dangereux ? Ne serait-ce pas, cette méchanceté innée, atavique, la preuve flagrante de la vérité du dogme chrétien du péché originel ? À cause de lui, de la faute transmise par Adam à tous ses successeurs, l'homme naît mauvais, il naît coupable. Sa nature est corrompue : c'est pourquoi le rationalisme de ce siècle, doublé d'un pessimisme naturaliste, estimera que le salut pour l'homme, le redressement ne pourra venir que de l'éducation qui seule sera en mesure de conduire l'être humain à la raison qui lui fera connaître la loi divine et les devoirs qu'elle lui enjoint, permettant ainsi l'acquisition tardive et difficile d'une moralité que n'a pas préparée en nous une nature déchue. Et c'est précisément sur ce point qu'apparaît l'originalité de Descartes. Cet enseignement que tous considèrent comme si nécessaire et bénéfique, Descartes en craint pour sa part et en dénonce les dégâts. Il va de soi que l'enseignement de l'enfant ne peut qu'être le fait des adultes, qui lui inculqueront les bons principes, lui feront part de leur expérience.
Or sans même parler du fait que cet enseignement est dans son contenu — laissons de côté les questions morales — intellectuellement très défectueux, il ne transmet à peu près rien de solide, comme Descartes l'a expérimenté au collège de la Flèche, où pourtant, il leur en donne acte, exerçaient les meilleurs régents de l'époque, la dépendance à laquelle forcément est soumise l'enfant vis-à-vis des adultes qui l'instruisent n'aura immanquablement que les effets les plus dommageables sur sa formation mentale. L'enfant, en effet, qui n'a aucun moyen encore de vérifier ce qu'on lui apprend, qui est, au surplus, porté à croire tout ce qu'on lui dit, de par le prestige, l'ascendant qu'ont sur lui les grandes personnes, avalera en toute confiance n'importe quoi, il croira savoir ce que pourtant il ne sait pas, il le croira sans l'ombre d'un doute parce qu'il l'a lu ou qu'on le lui a dit, et l'adulte qu'il sera plus tard restera marqué à jamais par la crédulité et la docilité d'esprit qui furent celles de ses premières années. Ce que déplore donc Descartes, ce n'est pas la méchanceté de l'enfant contrebalancée heureusement pas sa faiblesse physique, c'est la faiblesse intellectuelle qui sera si longtemps sienne, avec la naïveté, la candeur dont elles s'accompagnent. L'enfance est le moment de réception de tous les préjugés. Préjugé toute croyance dont on va jusqu'à ignorer qu'elle n'en est qu'une, toute idée passivement introduite, sans contrôle de notre part, sans même que soit envisagée l'éventualité de sa fausseté — préjugé, comme le terme l'indique, ce qui, antérieur à tout jugement qui l'aurait ratifié, s'est implanté sans son accord. Et, puisque ce jugement est un acte qui ne peut être qu'intérieur, préjugé tout ce qui en l'âme ne vient que du dehors, soit de cette extériorité qu'est pour elle le corps, et cela par le canal des sens, soit de cette seconde extériorité pour nous que représente autrui, et cela par le canal de l'enseignement. L'enfant, dont l'esprit n'a pas encore de puissance, est entièrement livré à son corps. Penser pour lui n'est que sentir. Ainsi des sens nous tirerons le préjugé que des réalités qui pourtant n'existent qu'en nous, à titre de sensations qui ne sont que des modifications subjectives, comme le lourd, le léger, le chaud, le froid, appartiennent aux choses elles-mêmes, qu'elles en seraient des propriétés, des qualités. Ainsi croyant que c’est l'objet lui-même qui est chaud, ce qui est lui prêter de façon absurde et occulte une sorte de conscience de soi, nous transportons, nous projetons au-dehors ce qui n'est qu'au dedans, nous nous envoûtons nous-mêmes. De là la physique puérile que la scolastique a héritée d'Aristote. Et ce sont encore nos sens desquels nous sommes persuadés spontanément qu’ils nous mettent au contact des choses mêmes, qui nous font nous imaginer que le plus réel, c'est ce qui est matériel, en sorte que nous aurons tant de mal, et c'est la principale résistance rencontrée par la philosophie vraie, à concevoir les réalités spirituelles, nous prendrons l'âme elle-même pour une sorte de corps, mais très délié, très subtil, une espèce de souffle. L'imagination est une pensée asservie au corps, elle est prisonnière des sens, et de ne faire qu'imaginer, c'est ce à quoi nous aurons passé notre enfance où il nous était encore impossible d'exercer notre entendement. Préjugé, c'est emprise. Il y a l'emprise des sens, il y a celle d'autrui. Relève du préjugé aussi tout ce qui dans nos pensées ne nous a été apporté que par autrui. En elles, leur part est immense, elle occupe même pratiquement toute la place. Combien de choses ne connaissons-nous que par ouï-dire, c'est-à-dire sans les savoir réellement ? Même si elles sont vraies, c'est comme si elles étaient fausses. Pourriez-vous par exemple démontrer que la terre tourne ? Si vous ne le pouvez, et moi pas davantage, vous êtes scientifiquement aussi nuls que tous ceux qui jusqu'à Copernic l'ignoraient, vous ressemblez à ce petit écolier qui déclare à son camarade plus jeune : mais non, imbécile, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est le contraire, le maître nous l'a appris ce matin.
Tous ces préjugés venus de l'enfance — cf le début de la première Méditation, « Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables… » — et l'habitude de n'évoluer que dans le préjugé, l'adulte les traînera toute sa vie. D'avoir été enfants, d'avoir vécu tout le début de notre vie si fragiles, si vulnérables psychiquement, nous risquons intellectuellement de ne pas nous remettre. C'était mal commencer, ce ne fut pas un bon départ pour un homme que d'avoir été enfant, et ce qui a mal commencé ne peut pas continuer bien. L'enfance est dans le cartésianisme une tare. La seconde Méditation comporte cette remarque : « comme nous avons été enfants avant que d'être hommes ». La même formule chez Aristote indiquerait un passage tout à fait naturel et normal de la puissance à l'acte. Chez Descartes elle a valeur de regret. On doit la lire comme un soupir. Quel désagrément ce fut là ! L'état d'enfance chez Descartes achemine moins à l'état d'adulte qu'il n'en éloigne. D'avance, il le compromet. D'où les mesures radicales que devra plus tard prendre Descartes. Dans sa décision philosophique de repartir à zéro, de faire table rase du passé, entre bien le projet de liquider une enfance, d'en effacer les dégâts. À quoi s'emploiera le doute universel qui, balayant les préjugés, remettra l'esprit à neuf. Ce sera une recréation intégrale, une auto-genèse d'où jaillira le Je du cogito. Ainsi la raison cartésienne apparaîtra adulte, en possession de tous ses moyens intellectuels, comme Athéna sortant de la tête de Zeus. Descartes va se donner mentalement une seconde naissance, la bonne, la vraie. Aristote disait que l'enfant est le père de l'homme. N'est-il pas catastrophique d'avoir été formé par un père aussi novice, aussi inexpert ? N'est-il pas aberrant d'avoir un père plus jeune que soi ? Descartes entend donc n'être le fils que de lui-même. Il reprend les choses en main. Nouvel Œdipe, il défait ce qu'avait fait — si malencontreusement — le temps. On pourrait comparer avec Rousseau. Il y a aussi dans la pédagogie négative de l'Emile le souci d'empêcher l'enfance, de l'empêcher d'avance d'avoir des répercussions si néfastes sur la vie future de l'adulte, ce qui se produit inévitablement si trop tôt on munit l'enfant d'un savoir qui ne convient qu'à des adultes et qu'il ne pourra que mal assimiler, en sorte que rien plus tard ne pourra être construit sur des bases aussi mal assurées, [aussi] à cette fin, et c’est là l’argument rousseauiste, il ne faudra pas écourter l'état d'enfance, au moyen d'une pédagogie accélérée toujours désastreuse qui trop vite fait de l'enfant un adulte, et un adulte raté — le temps dira Hegel se venge de ceux qui n’ont pas voulu compter avec lui —, mais il conviendra de laisser toute l'enfance s'écouler selon sa durée naturelle et ne rien apprendre à Émile, touchant les sciences ou la morale, avant qu'il ne soit en mesure de le comprendre, avant qu'il n'ait atteint cet âge de raison que Rousseau fixe vers les 15-16 ans. Mais faute d'avoir pu bénéficier d'un pédagogue aussi avisé que le précepteur d'Emile, et qui jamais pourra avoir un maître aussi extraordinaire, car le principal handicap de l'enseignement, ce n'est pas l’enseigné, c'est l’enseignant — comme dira Marx : qui éduquera les éducateurs ? — et du fait que la pédagogie rousseauiste réclame constamment un adulte qui se dévouera entièrement à son élève, ne le quittera pas une seconde afin de le préserver de tout contact pernicieux par quoi la société contaminerait Émile, l'on remarquera que cette éducation naturelle de part en part ne peut être menée que sous le couvert d'un artifice, celui du précepteur, où le trouver, et qui consentirait à pareil labeur et pareil sacrifice ? Descartes donc, faute d’avoir connu un précepteur rousseauiste, devra, lui, se dépouiller de son enfance. C'est qu'il ne lui doit que des chaînes. Et ne sont-ce pas des chaînes pour l'adulte que toutes ses habitudes qu'il a contractées, enfant — notre caractère, la coloration même de notre vie affective, avec toutes ses bizarreries, son irrationalité ? Pourquoi avons-nous tels penchants et telles aversions, telles sympathies, telles antipathies, tout cela n'est-il pas l'œuvre de toutes ces expériences oubliées que nous avons subies enfants, quand nous étions tellement sous influence ? Notre enfance, ce fut un vaste conditionnement. Descartes rapporte, dans une lettre, qu'il avait toujours été étonné de l'attirance inexplicable qu'il avait pour les femmes louches, entendons les femmes victimes de cette très légère infirmité oculaire que l’on appelait naguère une coquetterie, jusqu’au jour où ayant revu sa vieille nourrice, elle lui apprit que dans ses jeunes années il aimait jouer avec une petite fille qui louchait. Le Traité des passions, appuyé sur la connaissance que donne la vraie philosophie des lois de l’union de l’âme et du corps, assurera un déconditionnement. En tous domaines, intellectuels, affectifs, Descartes veut reprendre la direction de lui-même. De ses rêves eux-mêmes, cette résurgence nocturne de l’irrationalisme enfantin, n’aura-t-il pas la maîtrise, puisqu’il se flattait d’avoir réussi à ne plus avoir jamais que des songes agréables, que les songes qu’il voulait ?
Ce refus de l’enfance, si net dans le cartésianisme, c’est une philosophie qu’on a pu appeler positivisme, n’a-t-elle pas pour ambition par l’espérance dans les progrès illimités de ses branches, la mécanique, la médecine, de refondre la condition humaine ? Ce refus de l’enfance se justifie dans une philosophie de l’esprit pur, un homme peut être enfant, pas un esprit. Il est bien vrai que la raison ignore l’enfance. Tout ce qui est pré-rationnel, anté-rationnel, ne saurait être qu’anti-rationnel. Il n’y aurait sans doute aucun dommage – tout au contraire – à ce que l’enfance soit épargnée à un pur esprit, mais en irait-il de même pour ce vivant qu’est un homme ? Une philosophie de l’esprit peut rayer l’enfance, en faire l’économie, pas une philosophie de la vie. Le vivant qu’est l’homme doit grandir, il faut qu’il pousse comme une plante, selon les termes de Platon dans le Théétète qui nomme le philosophe un jardinier des âmes. Qui aurait été privé de cette croissance, de ce long développement, de cette germination, de cette nécessaire maturation, ne ferait qu’être planté là, fiché là à la façon d’un décor de théâtre. Vous auriez donc pu vous demander : que serait un homme qui n’aurait pas eu d’enfance, comme ce fut le cas au 19ème siècle de tous ceux qu’on envoyait à l’usine passés les dix ans, comme c’est le cas dans certaines contrées actuelles du globe des enfants-soldats ? Est-il bon de devoir trop vite avoir des soucis d’adultes, comme celui de gagner son pain ? Longtemps l’enfant, dans les conditions normales, sera protégé des rudesses du monde des adultes, il ignorera l’âpreté des compétitions, des rivalités, il n’aura pas à lutter pour la vie. La famille l’en dispense, l’école aussi à sa façon. Ce mot école ne vient-il pas du mot grec σκολη qui veut dire loisir ? À l’école, c’est à loisir qu’on fait ce qu’on fait, car on n’y travaille pas au sens strict du terme, au sens où travailler, c’est produire, avoir un rendement. Quelle différence du tout au tout sur ce point entre un écolier et un apprenti. Si l’écolier fait mal ce qu’il fait, s’il se trompe, ce n’est pas grave, l’école est faite pour cela, est fait pour cela son symbole le tableau noir, on n’y écrit pas simplement, on y efface. Mais on pardonnera beaucoup plus difficilement ses erreurs à ce petit adulte qu’est un apprenti. Il ne doit pas gâcher le matériau, ou abîmer par maladresse l’outil. C’est donc une plaisanterie sinistre que de parler d’un enseignement technique ou encore de dire que l’école est destinée à préparer à la vie, entendons celle que vivent les adultes. C’est son honneur que de retarder cette échéance. Elle viendra toujours assez tôt. À l’école on a le droit de rater, on a le droit et le devoir d’essayer, et l’on peut s’offrir ce luxe : penser, ce qui exige une sorte d’enjouement propre à l’enfance et comme d’irrespect. On doit savoir jouer avec des idées comme on joue aux billes. Et tant pis si à ce jeu elles se cassent. Ce sera un triomphe de la dialectique. Même intellectuellement, l’enfance est donc indispensable, l’intelligence est quelque chose qui doit être éveillée, elle est alerte, comme un chiot, elle est espiègle, comme un enfant, elle est joueuse — alors que le sérieux qui caractérise l’univers des adultes a quelque chose de morne, d’écrasant. Les hommes même sérieux évitent de réfléchir à ce qu’ils font. Ils le font, un point c’est tout. Descartes dit, dans le Traité des passions, de l’admiration, c’est-à-dire de l’étonnement, que c’est la première des passions, c’est la passion de l’enfance, pour qui tout est nouveau, tout intrigue. N’y a-t-il pas là un état de disponibilité mentale qui manquerait à celui qui aurait été immédiatement adulte ? Ce fut une période d’émerveillement que l’enfance, on y partait à l’exploration d’un monde étrange, on goûtait le plaisir de l’initiation, et l’on pouvait y faire des bêtises. Malheureux celui qui aurait été privé de cette expérience ou en qui elle n’aurait laissé aucun vestige. Bergson, au début de La pensée et le mouvant, observe que le tort des systèmes philosophiques est de ne pas être taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. « Ils sont, dit-il, trop larges pour elle, ils s’appliqueraient aussi bien à un monde où il n’y aurait pas de plantes ni d’animaux, rien que des hommes ; où les hommes se passeraient de boire et de manger, où ils ne dormiraient, ne rêveraient, ne divagueraient, où ils naîtraient décrépits pour finir nourrissons. » Tout ne se passe-t-il pas effectivement dans certaines philosophies comme si l’enfance n’avait jamais existé ? On a pu le reprocher à l’univers de l’existentialisme sartrien qui était celui d’une immense solitude. Les choses nous y sont étrangères, c’est de l’en-soi sans rapport avec notre pour-soi, aucune rêverie possible donc, car rêver, comme l’enfant sait si bien le faire, c’est sortir de soi, se répandre dans le monde, concourir avec lui.
C’est un être cosmique, dit Bachelard, que l’enfant. Dans l’univers sartrien, tout est hostile, les choses, les autres consciences, autant de poches d’aliénation pour moi, leur regard me pétrifie, me chosifie, dit Sartre, est hostile le monde dans son ensemble.
D’où le thème emprunté à Heidegger de ce délaissement, de cette déréliction que serait l’existence. À quoi Bachelard répondait : nous n’avons pas été jetés dans le monde, comme le veulent les métaphysiques rapides, nous avons été déposés dans un berceau. Sartre a oublié les cigognes.
Il est vrai que l’enfance peut être manquée, est même toujours manquée dans la mesure où toutes ces vertus de l’enfance, l’étonnement, l’émerveillement, la confiance, l’homme ne prend conscience de leur prix que lorsque l’enfance est passée. En somme, nous aurions été enfants trop prématurément, quand nous n’étions pas encore en état d’en profiter. Eh bien qu’à cela ne tienne, puisque l’enfance n’a pas vraiment été du passé, puisque nul n’a pu la vivre comme il aurait convenu — d’où ce vide que peut ressentir l’adulte qui a perdu ce qu’il n’a jamais eu, puisqu’il en est de l’enfance de l’individu comme de l’état de nature chez Rousseau, elle n’a que l’être d’une rature, d’une espèce de rature originelle —, faisons-en notre avenir. Telle fut la solution proposée par Nietzsche, dont ceux qui l’ont mentionnée dans leurs copies auraient dû souligner tout ce qu’elle a d’inouï, [si] tant est que dans la perspective nietzschéenne l’enfance ne se trouve pas derrière nous mais devant. Nietzsche ne nous invite certes pas à redevenir enfant, ce qui ne consisterait que dans la plus calamiteuse régression, il nous indique qu’enfant nous devons le devenir.
Cf. ce que le Zarathoustra appelle les trois grandes métamorphoses de l’esprit : « Je vais vous énoncer trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Nous sommes d’abord le chameau, qui s’agenouille et réclame les fardeaux les plus lourds. Le chameau aime qu’on le charge, c’est son courage à lui, son endurance. Que ne supporterait-il pas ? Et n’est-ce pas toute la vie de l’homme, tel qu’il est, tel qu’enfant on lui a appris à porter tant de poids, c’est le poids de tous les renoncements, de tous les interdits, de tous les impératifs, on nous a enseigné à les aimer.
Ainsi, dans le grand bestiaire nietzschéen se [comporte] encore cette autre bête de somme, l’âne.
L’âne dit hi-han, c’est-à-dire deux fois oui, mais à quoi dit-il oui ? À tout ce qui est contraignant, négatif, il dit oui à tout ce qui dit non. Que le chameau devienne donc lion. « Dans le désert, écrit Nietzsche, où il s’est hâté, l’esprit devient lion, il veut conquérir la liberté et être le maître de son propre désert. Il cherche son dernier maître, il veut être l’ennemi de ce maître et de son dernier Dieu ; pour la victoire il veut lutter contre le grand dragon. Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut plus appeler Dieu ni maître ? « Tu dois » s’appelle le grand dragon. » Qui dit : « Tu dois » ? C’est l’adulte, l’adulte qui en nous parle à l’enfant. « Mais l’esprit du lion dit : « Je veux ». » Donc l’esprit cesse d’être la bête robuste qui renonce et se soumet. Il se débarrasse de toutes les valeurs qui pesaient sur lui. Créer des valeurs nouvelles, le lion même ne le peut pas encore, mais se rendre libre pour des créations nouvelles, c’est là ce que peut la puissance du lion. « Mais dites-moi, écrit plus loin Nietzsche, que peut faire l’enfant que le lion n’ait pu faire ? Pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant ? L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. » Le premier moment, c’était celui du oui aliénant — le chameau dit oui à tout ce qui le nie —, le second moment sera celui du non, c’est celui du lion, le troisième moment sera celui du vrai oui, du oui à soi-même, c’est-à-dire de l’affirmation. Ce oui n’est plus une réponse, ainsi l’homme enfantin disait oui, cela lui prouvait sa responsabilité : dans responsabilité, n’y a-t-il pas réponse ?
Être responsable, c’est pouvoir répondre de soi, de ce que l’on est, de ce que l’on fait mais auprès d’un autre, que cet autre soit la société ou soi-même, car c’est bien dans la sphère de la morale que Je est un autre, cet autre en moi que moi qui me dit : tu dois. Toute opposée à la docilité de ce oui la joyeuse et libre affirmation de soi du lion métamorphosé en enfant. Ce oui est second, on dit oui à quelque chose ; l’affirmation est première. Je dis oui à quelque chose, mais c’est moi que j’affirme.
Seulement, il ne suffisait pas de rapporter ces lignes du Zarathoustra, il fallait expliquer ce que l’enfance représente, symbolise chez Nietzsche afin de comprendre ce paradoxe que le surhomme nietzschéen aura tous les traits d’un enfant. Y aidera une formule d’Héraclite que Nietzsche aimait citer : « Le devenir est comme un enfant qui joue aux dés. » Deux questions. Pourquoi le devenir est-il un enfant, pourquoi cet enfant joue aux dés ? Le devenir est un enfant parce que sur rien il ne s’attarde, chacun de ses moments aussitôt il l’efface, il n’en portera pas le poids, il n’a donc pas de passé, il est toujours jeune, le devenir, toujours neuf parce que c’est le contraire d’un état, comme la maturité par exemple, où l’on s’installerait et où [tranquille] l’on vieillirait, et le devenir-enfant joue aux dés parce que, comme ses moments disparaissant sitôt apparus ne forment pas une suite — ils ne s’enchaînent pas, ils ne nous enchaînent pas à un passé dont notre présent ne serait que le prolongement, la continuation —, chacun de ses moments, comme au jeu de dés, indépendants du précédent, nous offre une combinaison nouvelle, une chance nouvelle. C’est un jeu de hasard, le grand jeu du hasard dont nous devons faire notre vie. Belle irresponsabilité du hasard, il est toujours innocent, n’ayant jamais rien prémédité, il ne s’asservit à aucun but, il est insouciant, ce qu’il fait n’ayant aucune cause ni aucune intention, il le fait pour rien. « Cela s’est fait par hasard, écrit Nietzsche dans La Généalogie de la morale, peut-on concevoir parole plus noble ? » Enfants, nous qui l’avons si mal été, on a fait aussitôt de nous des petits adultes, accablés de charges, d’impératifs, nous avons à le devenir. Nous avons à devenir cet être du devenir qu’est l’enfant. Le devenir est comme un enfant qui joue aux dés. Le vrai devenir est pour Nietzsche du hasard pur. Il n’est rien de plus noble. Rien de plus noble que le devenir et l’enfant. Le devenir que théorise Nietzsche ne va pas quelque part, il n’est pas rectiligne, il n’a pas un sens, il n’a même pas de sens, il pivote sur lui-même. Tel est l’enfant.
L’enfant qui n’a pas de passé, [du coup] qui n’a pas d’avenir, puisqu’il n’aurait pour avenir que de cesser d’être un enfant, est bien cette roue qui ne roule que sur elle-même. Être un enfant, c’est jouer. Le nietzschéisme est une philosophie de l’enfance parce que c’est une philosophie du jeu. C’est en quoi principalement il s’oppose au hégélianisme qui est une philosophie du travail. Le développement dialectique du concept n’est-il pas tout un travail de soi sur soi, et n’est-il pas significatif que Hegel identifie vérité et résultat ? Tout travail doit avoir un résultat, sa valeur s’apprécie à celle de son résultat, un travail inutile serait absurde, on travaille pour qu’il y ait un gain, il faut que le travail rapporte, il est intéressé et la philosophie qui s’intitule elle-même spéculative est une philosophie qui spécule aussi au sens boursier du terme. Elle apparaît donc à Nietzsche comme le comble de la bassesse, de la médiocrité, de l’affairement mesquin. C’est la gloire du jeu que de ne rechercher aucun résultat. On joue pour rien, c’est-à-dire pour le plaisir. C’est une finalité sans fin kantienne. Le jeu ne laisse aucune trace. Dans le monde du travail, du devenir enchaîné, on continue toujours mornement, dans celui du jeu on recommence, c’est bien plus beau. Faire et défaire, tel est le devenir, tel est aussi le jeu qui est dionysiaque. Soit un enfant qui a édifié un superbe château de sable, avec quelle patience, quel soin ! Que fait-il avant de quitter la plage ? D’un coup de pied il le renverse. C’est la destruction nietzschéenne, un acte de seigneur, mais destruction — cf. les valeurs — de ce qu’on a soi-même, avec tant d’amour, créé, car les destructeurs que souhaite Nietzsche, les vrais, pas les casseurs, sont destructeurs de leurs propres œuvres et Nietzsche enseigne que l’on ne détruira bien que ce que l’on a soi-même construit. Dans cette insouciance, cette innocence cruelle Nietzsche a logé toute la liberté. Et l’on peut alors rêver, comme a fait l’anarchie, d’un accord spontané, immédiat, d’un libre accord de nos libertés. Qu’on songe à l’abbaye de Thélème de Rabelais, dont la règle n’était que cette clause : fais ce que tu voudras, et n’est-ce pas l’idéal de l’enfant ? Faire ce qu’on veut, voilà la définition du caprice. Rabelais écrit : « Par cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire tous ce qu’à un seul voyaient plaire — imiter, n’est-ce pas aussi un désir d’enfant ? — Si quelqu’un ou quelqu’une disait : « Buvons », tous buvaient. Si disait : « Jouons », tous jouaient. Si disait : « Allons à l’ébat ès champs » — allons nous ébattre aux champs —, tous y allaient. » Mais que se serait-il passé, si quelqu’un avait dit : « Travaillons » ? On ne travaille pas dans la société des grands enfants de l’abbaye de Thélème. Seulement si on ne travaille pas, si on n’en a pas le besoin, c’est parce que d’autres dans l’ombre le font. Tel est l’envers aussi de l’utopie aristocratique de Nietzsche — le noble d’ancien régime ne passait-il pas son temps à jouer ? —, les uns ne peuvent jouer que parce que les autres travaillent. Ce fut effectivement notre état d’enfance, merveilleux, un conte de fées. Les parents, ou la domesticité, ne sont-ils pas les bons génies, les lutins à l’œuvre dans la maisonnée ? L’enfance se déroule en pleine mythologie. Les dieux de sa mythologie, ce sont les adultes, ces puissants serviteurs, et garde une mentalité mythologique l’adulte qui s’imagine que vivre, c’est vivre du travail des autres. En somme il y en a qui voudraient être portés toute leur existence comme, enfants, quand ils n’avaient pas appris à marcher, ils le furent par leur mère. C’était là être rois et nous avons commencé par être rois, et même tyrans. Les enfants, écrit Rousseau dans L’Emile, sitôt qu’ils peuvent considérer les gens qui les environnent comme des instruments qu’il dépend d’eux de faire agir, ils s’en servent pour suivre leur penchant et suppléer à leur propre faiblesse. En ce sens, rompre avec l’enfance, avec ce moment de la vie où l’on ne faisait pas, où l’on faisait faire — faire, c’est la condition technique, faire faire c’est l’attitude magique —, couper avec l’enfance, c’est comme tuer le tyran qu’on fut.
Des enfants ne pourraient vivre tout seuls, une société qui ne serait composée que d’enfants indépendants et libres — c’est au fond le vœu de toute utopie politique — est inconcevable. Toute utopie (en grec : non-lieu) est, selon un néologisme forgé par Renouvier, une uchronie. C’est dans le temps que les utopies n’ont pas de place. Uchronie — ce fut avec Descartes notre première partie — qu’un adulte qui n’aurait pas été un enfant ; uchronie — ce fut avec Nietzsche notre seconde partie — qu’un adulte en route vers une enfance ; comme un adulte n’en serait pas un s’il n’avait été un enfant, car l’homme en nous doit se développer, la vérité de l’enfant est elle-même dans l’adulte qu’il deviendra. Ce sont là deux moments. Ils ne se cumulent pas. Uchronique aussi et surtout donc l’idée que l’on pourrait concilier les avantages de l’un avec ceux de l’autre, être les deux à la fois. Il n’est pas plus déplacé qu’un adulte qui fait l’enfant, qu’un adulte qui ne serait qu’un enfant attardé, si ce n’est un enfant qui fait l’adulte, le singe, et veut penser, parler et agir en grande personne. Cela signifie-t-il pour autant que l’état d’enfance et celui d’adulte seraient entièrement isolés, que l’enfant en nous disparaît quand apparaît l’adulte, que l’enfance ne serait, bon ou mauvais, qu’un simple moment à passer ? Il n’est pas à passer, il est à dépasser au sens hégélien du terme, c’est-à-dire qu’il doit être tout entier aboli et tout entier maintenu. Qu’est-ce qui est à supprimer dans l’enfance ? Son immédiateté. L’immédiateté, c’est l’apparition d’un être. Il est là, entièrement là, ce n’est pas une moitié d’homme qu’un nouveau-né, mais cette réalité est encore tout entière à réaliser. Sous sa forme immédiate, elle est ineffective. Il n’y a encore aucune profondeur en elle, aucune richesse, et c’est pourquoi Hegel la dit simple, comme ce qui est encore réduit à sa plus simple expression. N’allons donc pas nous extasier sur la simplicité de l’enfant ; elle est nue, ce n’est que du dénuement. Hegel déclare que si nous désirons voir un chêne, nous ne serons pas satisfaits si l’on nous montre à sa place un gland. Pas davantage un enfant ne peut tenir lieu d’un homme. Hegel est sévère, non envers l’enfant, mais envers l’image trop complaisante que nous nous en faisons. L’enfance n’est pas pleine de trésors, elle n’abonde pas en promesses, ce ne sont là que des mirages, des illusions rétrospectives. Ah ! tout ce que j’aurais pu être, comme si tout enfant était un génie en puissance, ainsi que le croit la pédagogie anti-pédagogique qui s’imagine qu’éduquer l’enfant, lui imposer le moule d’un adulte, serait réduire sa richesse, attenter à son originalité. Sans l’éducation qui nous forme en nous transformant, en faisant accéder d’un état de nature à un état de culture, l’enfant, tout raisonnable qu’il est potentiellement, resterait un animal. Seulement si l’enfant n’est pas un petit adulte, il est un petit homme, il y a en lui un désir d’être homme, une volonté de devenir quelqu’un, c’est le but de l’enfance, et c’est lui qui doit être maintenu mais sous la forme d’un résultat. Ce qu’est un adulte doit correspondre à ce que l’enfant qu’il fut voulait être ; si cet enfant existait toujours, il devrait pouvoir s’y identifier. C’est pourquoi il n’est pas plus tragique pour un adulte que d’avoir le sentiment d’avoir trahi l’enfant qu’il fut. C’est devant lui qu’il est responsable, responsable de ce qu’il l’a fait devenir. Ce n’est pas, comme certains d’entre vous l’ont écrit, la vie de l’enfance qui est dialectique, c’est la vie humaine dans son ensemble. Elle doit passer par les trois moments de tout processus dialectique. Le premier, c’est celui de l’en-soi, c’est-à-dire de l’intériorité. Je signale, pour que des confusions soient évitées, que la terminologie de Hegel n’est pas celle de Sartre. Le pour-soi, chez Sartre, désigne la subjectivité, Hegel l’appelle de l’en-soi. C’est ce qui est enfoui en moi. Ainsi la vérité de l’enfant est encore enfouie en lui-même. Nul ne la connaît, et pas plus lui-même. Il se sent riche mais uniquement de virtualités vagues, mais pour l’instant il est pauvre, il a de quoi être tout mais il n’est encore presque rien. En langage hégélien, la certitude qu’il a de soi n’est pas encore vérité, vérité objective, vérité reconnaissable par tous. L’enfant n’a pas encore fait ses preuves, il lui manque d’être au-dehors ce qu’il est au-dedans, or, selon la célèbre formule de Hegel, ce qui n’est qu’intérieur n’est même pas intérieur. Ce décalage entre soi et soi, c’est ce que ne cesse d’éprouver douloureusement l’adolescent, aussi est-il mal en lui-même, aussi est-il volontiers coléreux, mais cette colère qu’il promène sur tout ce qui l’entoure, est aussi et surtout, comme toute colère, colère contre soi. Elle en est la projection. Le deuxième moment de la vie d’un homme, c’est celui du pour-soi, c’est-à-dire de l’extériorité. Il caractérise la maturité. La vie de l’adulte est essentiellement, en effet, une vie extérieure, une vie qui se distribue selon le dehors. Un adulte se définit par sa situation sociale, les différentes fonctions, les différents rôles qu’il a à jouer, tout cela lui est assigné par les autres et fait partie d’un vaste ensemble dont on n’est qu’un rouage. L’adulte ne s’appartient plus. Il a extériorisé son intériorité. Ce qui pourra souvent être éprouvé comme une aliénation. Il semble qu’on n’est plus soi-même, que son être ne tient plus que dans un apparaître, l’on a le sentiment aussi d’une perte, d’une déperdition : enfant, j’aurais pu être tant d’hommes différents et je ne suis plus que celui-ci. Selon un mot de Valéry, j’étais né plusieurs et je mourrai un. Tous les possibles – l’enfance est le lieu des possibles – se sont réduits à une seule réalité, et enfin tout ce devenir m’a l’air de s’être fait sans moi, toujours selon l’extériorité, par des concours de circonstances dont je n’étais pas le maître, j’ai été pris dans de multiples engrenages, j’en fus la victime. Le troisième moment, le plus difficile, il est réflexif, est celui de l’en-soi pour-soi, si un homme, dans cette vie qu’il mène qui peut lui paraître si étrange, si étrangère, se redécouvre enfin lui-même, et intériorisant cette extériorité, apprend au dehors de lui, dans ce qu’il a fait, sa vérité qu’il ne pouvait immédiatement lire en lui-même. Cette vie, apparemment faite de hasards ou de contraintes subies, c’était mon œuvre, je l’avais voulue, je m’y révèle, c’est moi et non pas le fait d’un destin extérieur. Le destin, a écrit Hegel, c’est soi-même vu comme un autre, vu comme un ennemi.
Ainsi la vérité de la vie d’un homme est celle d’une auto-réalisation, si tant est que nul ne sera ce qu’il est qu’à la condition de le devenir. En la comprenant, lui qui adulte s’était opposé à l’enfant qu’il était, il était enfant encore indéterminé, il s’est défini, il était plusieurs, il est maintenant un, cet homme s’est rejoint, il est revenu à soi comme dit Hegel, il s’est égalé à lui-même, ce qu’il ne pouvait faire que dans le temps. Au sujet que nous traitons pourrait parfaitement s’appliquer cette formule de Hegel : « C’est seulement cette égalité se réinstaurant, la réflexion en soi-même dans l’être-autre qu’on est devenu qui est le vrai et non une unité originale comme telle ou une unité immédiate comme telle. » Il y a donc l’enfant, il y a l’adulte, mais il y a aussi et surtout l’homme dans lequel, sans s’identifier, ils se réunissent. Si je suis l’intermédiaire entre moi et moi-même, l’homme n’est ni l’enfant ni l’adulte mais leur médiation. Faire passer l’enfance dans son être-autre, l’état d’adulte, mais pour qu’en s’y perdant elle s’y sauve, elle s’y retrouve, c’est notre réalité humaine. Un homme peut se dire qu’il n’a pas manqué sa vie s’il a la conviction que ce qu’il voulait être, sans le savoir, enfant, il l’a, adulte, accompli. Son enfance est derrière lui, il n’y retournera pas, mais sa tâche est de l’accomplir. Il y a donc mieux à faire de la part de l’adulte que de ménager dans quelques recoins de lui-même on ne sait quels restes de fraîcheur enfantine, tout est perdu de l’enfance, rien ne s’en conservera tel quel, rien n’en sera préservé, mais tout peut être sauvé d’elle, si l’adulte n’a rien renié de l’enfance qu’il lui a fallu vivre, s’il a agi en sorte que l’enfant qu’il fut et dont il ne refera jamais la connaissance pourrait lui se reconnaître dans l’homme qu’il est devenu.